Report du vote sur le Brexit : « Theresa May a fait une terrible démonstration de sa faiblesse »
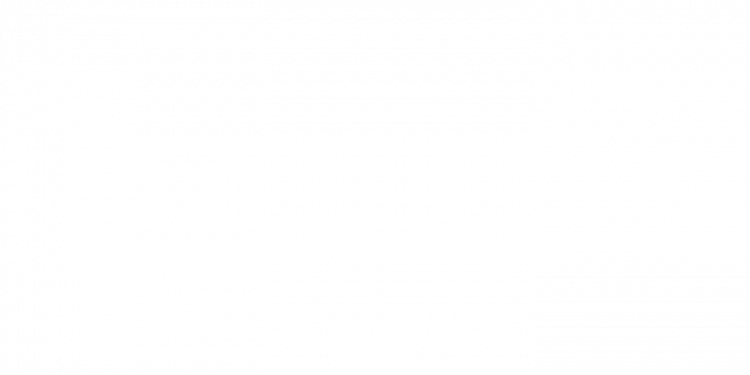
Report du vote sur le Brexit : « Theresa May a fait une terrible démonstration de sa faiblesse »
Après le report du vote britannique sur le Brexit, l’issue du processus est plus qu’incertaine. Notre correspondant à Londres a répondu à vos questions sur le sujet.
Manifestants pro-Brexit, devant le Parlement britannique, le 11 décembre 2018, au lendemain de la décision du premier ministre Theresa may, de reporter le vote sur le projet de Brexit. / HENRY NICHOLLS / REUTERS
Après la décision de Theresa May de repousser le vote sur l’accord de Brexit, quel est l’avenir du processus de sortie de l’Union europénne ? Au lendemain de ce retournement de situation, Philippe Bernard, notre correspondant à Londres, a répondu à toutes vos interrogations.
Moudong : Theresa May espère-t-elle réellement une évolution ou des concessions supplémentaires des Européens sur le sujet du backstop irlandais ? Ou s’agit-il d’une manœuvre politique interne pour convaincre les parlementaires qu’il n’y a pas d’autre choix que son « deal » ou un nouveau référendum ?
Philippe Bernard : Sa décision de reporter le vote des députés me semble désespérée et à haut risque, surtout dans un pays où on ne badine pas avec la souveraineté parlementaire, qui est vraiment au centre de la vie politique.
Elle cherche à gagner du temps, pensant probablement qu’elle pourra arracher un vote en janvier sous l’effet de la panique d’un « no deal » (droits de douane rétablis, produits de consommation contingentés, transports aériens menacés).
C’est un choix dangereux, car il conforte l’illusion selon laquelle l’Union européenne pourrait faire de nouvelles concessions après dix-huit mois de négociations. Sa stratégie renforce deux hypothèses : un « no deal » et un second référendum.
Guillaume : Les jours de Theresa May à la tête du gouvernement sont-ils comptés ? Le cas échéant, quel (lle) remplaçant(e) ? Avec quel programme pour le Brexit ?
P. B. : Theresa May a fait une terrible démonstration de sa faiblesse hier en ajournant le vote sur l’accord de Brexit. Son face à face avec une Chambre des communes chauffée à blanc faisait penser à une professeure incapable de tenir sa classe.
Elle est désormais sous la menace soit d’un vote de défiance du Parlement lui-même (mais il serait extravagant que les députés conservateurs torpillent leur propre gouvernement), soit surtout d’un vote de défiance des élus conservateurs. Il faudrait pour cela que 48 des 315 députés (15 %) en fassent la demande par écrit. Un vote suivrait. Si Mme May, qui est à la fois première ministre et chef du parti conservateur, était alors mise en minorité, une campagne pour sa succession s’ouvrirait.
Les ultrabrexiters, comme Boris Johnson et Dominic Raab, sont déjà à la manœuvre. Ils prôneraient un « no deal » car ils souhaitent ce choc pour provoquer une nouvelle révolution thatchérienne. Leur projet consiste à « libérer » le Royaume-Uni des règles européennes pour le transformer en un paradis fiscal ignorant les règles fiscales, sociales et environnementales de l’UE. Une sorte de Singapour déréglementé pratiquant le dumping aux portes de l’UE.
C’est pourquoi les Britanniques proeuropéens, qu’une telle perspective alarme, sont pour l’instant réduits à espérer que Theresa May tienne !
Nicolas : Si l’accord de sortie n’était pas voté, un nouveau référendum serait-il possible ?
P. B. : Oui, à condition que cette option réunisse une majorité de députés puisque le Parlement doit voter la loi organisant un référendum. Ce n’est pas le cas pour le moment. Mais cela pourrait changer.
Tout dépend de si ou quand le Labour basculera vers le second référendum. Pour l’instant, Jeremy Corbyn et un petit nombre de dirigeants du parti travailliste, en réalité hostiles à l’UE, vue comme un « club de capitalistes », résistent à cette idée qui est pourtant soutenue par une écrasante majorité des adhérents. Ces dirigeants craignent de « désespérer » la partie de leur électorat populaire qui a voté pour le Brexit et qui pourrait accuser les politiciens de « trahison ».
Ils privilégient l’option de nouvelles élections législatives, qu’ils n’ont, en réalité, guère les moyens de provoquer. Hier, après le report du vote, ils auraient pu appeler à un vote de défiance contre Mme May. Le Labour ne l’a pas fait, car cela l’aurait obligé à afficher une position claire, qui ne peut être que le second référendum.
Leur position officielle actuelle consiste à prétendre qu’une fois au pouvoir, ils obtiendraient de Bruxelles un accord qui, tout en respectant le Brexit, procurerait « exactement les mêmes avantages » que l’adhésion à l’UE. Un pur leurre.
Chat teigneux : Que montrent les sondages récents sur un éventuel référendum ? Le « Remain » l’emporterait-il cette fois ? Y-a-t-il eu un basculement dans l’opinion britannique ?
P. B. : Il n’y a pas de basculement net de l’opinion britannique, mais un léger glissement vers le « Remain » (rester dans l’UE). Actuellement, les remainers sont entre 51 % et 55 %. En témoigne par exemple ce sondage. Mais une majorité de Britanniques (de 50 % à 60 %) demeurent hostiles à l’idée même d’un second référendum.
Agneaux : Bonjour, sans être Madame Irma, à combien évaluez-vous le risque d’un « no deal » ?
P. B. : Ah ! Pas facile de quantifier, mais il le faut bien au pays des bookmakers ! Je dirais qu’il y a 30 % de chances que Mme May finisse par faire voter son deal, 35 % que le Brexit s’effectue sans accord (vide juridique), soit par volonté politique soit par accident, et 35 % que le conflit que les députés ne parviennent pas à trancher le soit par un second référendum.
Benny : Bonjour, sait-on ce que pensent les Écossais du report ? Nicola Sturgeon s’est-elle exprimée sur les conséquences d’un « no deal » pour l’Écosse ?
P. B. : Oui, comme vous le savez, les Ecossais ont voté à 62 % contre le Brexit. La première ministre, Nicola Sturgeon (indépendantiste), est tout à fait opposée à l’accord passé avec Bruxelles par Theresa May et favorable à un second référendum.
Hier, elle a tenté en vain de pousser le Labour à reprendre ce dernier mot d’ordre, assurant qu’un tel basculement des travaillistes pourrait susciter un élan et permettre à une majorité de se constituer en faveur de ce nouveau vote populaire (« People’s vote »). Les conséquences d’un « no deal » seraient catastrophiques pour l’ensemble du pays (jusqu’à 9 % de PIB en moins à terme) et en particulier en Ecosse.
Penkalet : Ce Brexit totalement ahurissant ne va-t-il pas accélérer la réunification de l’Irlande et l’indépendance de l’Ecosse ?
P. B. : La tendance est nette pour l’Irlande, nettement moins évidente pour l’Ecosse.
Les Nord-Irlandais (comme les Ecossais) ont voté majoritairement (56 %) pour rester dans l’UE. Le Brexit menace non seulement la fluidité des échanges économiques, mais le processus de paix. Ce dernier, et la disparition de la frontière qui l’accompagne, reposait largement sur l’adhésion à l’UE des deux pays (République d’Irlande et Royaume-Uni – dont l’Irlande du Nord est une des « nations »).
La réunification de l’île (coupée en deux depuis 1922) apparaît de plus en plus comme une « solution » au Brexit. Les obstacles sont très nombreux, mais le Brexit a rouvert cette perspective sans que Londres, où l’intérêt pour l’Irlande est minime, l’ait vu venir.
Wechalors : Quels sont pour l’instant les effets sur l’économie britannique ?
P. B. : Il n’y a pas eu d’effet instantané sur l’économie, en dehors d’une brutale chute de la livre sterling (-10 %) après le référendum de 2016, qui a relancé l’inflation et handicapé les importations sans vraiment booster les exportations. Plutôt une dégradation progressive de la conjoncture. Le Royaume-Uni, qui caracolait en tête du G20 pour la croissance avant le référendum, est aujourd’hui l’une des lanternes rouges. Le moral des ménages, et surtout des entreprises, est en berne et les investissements se tassent. Un certain nombre de firmes financières ont annoncé des délocalisations à Paris, Francfort, au Luxembourg ou à Dublin.
De nombreux industriels sonnent l’alarme sur les risques pour leur chaîne d’approvisionnement liés à un « no deal » ou à tout nouveau contrôle à la frontière. Le brouillard de plus en plus épais sur les conditions du Brexit, à trois mois de l’échéance (29 mars 2019), nourrit énormément d’inquiétudes.
Emilie : En cas de no deal, quelles conséquences pour les 27 ?
P. B. : Elles seraient moins catastrophiques que pour le Royaume-Uni (dont 45 % des exportations partent vers l’UE) mais potentiellement néfastes également pour le continent (15 % des exportations de l’UE vont au Royaume-Uni).
La région des Hauts-de-France serait en particulier touchée. Les expatriés européens au Royaume-Uni et les Britanniques installés sur le continent risqueraient aussi de voir leur statut dévalué.
Agneaux : En cas de « no deal », les expatriés européens au Royaume-Uni vont-ils effectivement être « mis dehors », comme on l’entend partout ?
P. B. : Certainement pas. Mais leur droit au séjour sera réduit. Londres a déjà annoncé qu’en cas de « no deal », seuls les ressortissants européens ayant vécu au moins cinq ans au Royaume-Uni au moment du Brexit (29 mars 2019) bénéficieraient facilement du statut de résident permanent. L’accord passé par Mme May fixe cette date au 31 décembre 2020.
D’autres obstacles seraient posés, notamment en matière de regroupement familial.
Brunchou : Question un peu hors sujet, mais la sociologie électorale des brexiters ne recoupe-t-elle pas assez fidèlement celle des Gilets Jaunes français ?
P. B. : Votre question n’est pas du tout hors sujet ! Il est très tentant de dresser ce parallèle. Le vote pro-Brexit a été interprété comme un « coup de gueule » des Britanniques laissés-pour-compte, victimes des conséquences de la crise financière, de la massification des emplois précaires, et de l’austérité financière drastique imposée par les gouvernements conservateurs depuis 2010. Une révolte des habitants des villes du nord de l’Angleterre désindustrialisées et défavorisées contre les « riches » de Londres et des autres villes prospères du Sud.
Les opposants à un second référendum agitent d’ailleurs aujourd’hui la menace d’émeutes populaires si le vote de 2016 était remis en cause.
Mais le tableau britannique est plus complexe, car le vote du Brexit résulte de l’alliance inattendue entre d’une part ces laissés pour compte, souvent hostiles à la main-d’œuvre étrangère, considérée comme concurrente, et plutôt en demande de « davantage d’Etat », et d’autre part des catégories au contraire favorisées de la population séduites par les arguments de souveraineté et une perspective ultralibérale en matière d’économie hors de l’UE.
Un contenu de cette page n'est pas adapté au format mobile, vous pouvez le consulter sur le site web







