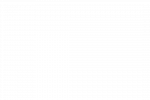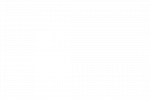En Afrique, les femmes en première ligne du combat pour les droits humains

En Afrique, les femmes en première ligne du combat pour les droits humains
Par Fabien Mollon
Dans son rapport 2018, Amnesty International rend hommage aux figures féminines qui luttent contre le harcèlement, les violences et les inégalités.
Des Sud-Africaines manifestent contre les violences basées sur le genre, à Pretoria, le 1er août 2018. / WIKUS DE WET / AFP
Pour célébrer les 70 ans de l’adoption par les Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le 10 décembre 1948 à Paris, Amnesty International a choisi de placer son rapport 2018 sous le signe des droits des femmes, soulignant, sous la plume de Kumi Naidoo, son secrétaire général, que « dans le monde entier » et notamment en Afrique, nombre d’entre elles « ont été en première ligne du combat pour les droits humains ».
C’est notamment le cas en Afrique du Sud, où, après que la vague #metoo a déferlé sur les Etats-Unis et l’Europe en 2017, « des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre les violences sexuelles endémiques », écrit M. Naidoo. C’est aussi le cas au Nigeria, où « plusieurs milliers de femmes déplacées se sont mobilisées afin de réclamer justice pour les violences qui leur ont été infligées par des combattants de Boko Haram et par les forces de sécurité », poursuit le patron sud-africain de l’ONG de défense des droits humains.
Règles d’héritage « discriminatoires »
Violences sexuelles au Soudan du Sud, mariages précoces et violences domestiques en Somalie… En creux, cet hommage aux combattantes africaines, parfois réprimées par les pouvoirs en place, dessine la carte des violations des droits humains sur le continent. Ainsi, au Kenya, Wanjeri Nderu est à la tête d’une campagne contre les exécutions extrajudiciaires ; au Nigeria, Aisha Yesufu et Oby Ezekwesili, arrêtées en janvier lors d’un sit-in à Abuja, sont les cofondatrices du mouvement #bringbackourgirls (« ramenez nos filles ») réclamant la libération de plus de 200 lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014 ; en Afrique du Sud, Nonhle Mbuthuma, militante des droits à la terre, « continue de défendre les intérêts de sa communauté malgré les mauvais traitements que lui ont infligés des policiers lors d’une manifestation en septembre », constate le rapport d’Amnesty.
« Si vous prenez mes terres, vous prenez mon identité », dit Nonhle Mbuthuma, qui se bat contre une compagnie minière cherchant à exploiter du titane. Malgré les intimidations, les menaces et même une tentative d’assassinat, la militante reste déterminée à empêcher que quelque 5 000 personnes soient expulsées de force si la compagnie était autorisée à exploiter le terrain. « Ils ont essayé de nous intimider mais ils ont échoué, poursuit-elle. Je suis toujours debout. Rien ne nous séparera de nos terres. »
En Afrique du Nord, Amnesty International s’inquiète de la situation en Egypte, où, après que la militante des droits des femmes Mahienour Al-Massry a été libérée en janvier, une autre femme, Amal Fathy, a été condamnée en septembre à deux ans de prison pour avoir publié sur Facebook une vidéo dénonçant l’inaction du gouvernement face au harcèlement sexuel. Au Maroc, Nawal Benaissa, l’une des figures du mouvement « Hirak », a été condamnée à dix mois de prison avec sursis pour avoir « réclamé publiquement une plus grande justice sociale et de meilleurs services de santé dans la région du Rif », note l’ONG. En Libye, Mariam Al-Tayeb, qui avait dénoncé les groupes armés responsables d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et d’actes de torture, a été enlevée et battue par des miliciens à Tripoli.
Amnesty International rappelle par ailleurs que partout dans le monde, les femmes sont les premières victimes des inégalités et que de nombreux obstacles les empêchent de jouir de leurs droits économiques et sociaux. L’ONG pointe notamment les « règles d’héritage discriminatoires » et les « lois relatives à la propriété » ; comme au Swaziland, où le système traditionnel d’attribution des terres favorise les hommes. Des inégalités encore aggravées par « les coupes budgétaires qui réduisent les principaux services publics dans de nombreux pays » tels que le Tchad, par exemple, où « les mesures d’austérité ont de graves répercussions sur le secteur public de santé et compromettent l’accès des femmes et des filles aux soins médicaux de base ».
Entraves à la liberté d’expression
Plus globalement, Amnesty fait le point sur les trop nombreuses violations des droits humains en Afrique, sans considération de genre : répression de manifestations pacifiques en République démocratique du Congo (RDC) ; arrestations de militants pour la démocratie au Togo, contre une nouvelle loi de finances au Niger, contre l’esclavage en Mauritanie, contre la hausse du coût des denrées alimentaires et des médicaments au Soudan ; « persécutions persistantes » contre les militants écologistes à Madagascar ; « probable disparition forcée » d’une figure de la société civile, Franklin Mowha, au Cameroun ; harcèlement de ceux qui critiquent le gouvernement en Zambie…
L’ONG décrit aussi les entraves à la liberté d’expression. Au Mozambique, elle déplore l’imposition de « frais d’accréditation exorbitants » aux médias, « dans le but de mettre un frein au journalisme indépendant ». En Ouganda, elle dénonce la mise en place d’une taxe sur l’utilisation des réseaux sociaux, tandis que l’Erythrée continue de « ne tolérer aucune forme de liberté des médias ».
Cela ne l’empêche pas de relever « quelques bonnes nouvelles malgré tout ». Comme en Angola, où, après l’arrivée au pouvoir de Joao Lourenço en 2017, « des mesures sans précédent ont été adoptées pour combattre la corruption endémique ». Amnesty se félicite de la libération ou de l’acquittement de défenseurs des droits humains dans plusieurs pays : les journalistes Rafael Marques et Mariano Bras en Angola, le militant Tadjadine Mahamat Babouri au Tchad, le dessinateur Ramon Esono Ebalé en Guinée équatoriale, l’enseignant Matar Younis au Soudan, l’opposante Victoire Ingabire au Rwanda…
Mais les progrès les plus importants ont été observés en Ethiopie, où plusieurs milliers de détenus ont été libérés en 2018, dont le journaliste Eskinder Nega, « incarcéré depuis 2011 sur la base d’accusations liées au terrorisme forgées de toutes pièces », selon Amnesty. L’organisation se réjouit des réformes lancées par le nouveau premier ministre, Abiy Ahmed : autorisation de plusieurs partis d’opposition, révision de lois répressives, suppression des restrictions qui pesaient sur des médias en ligne. Autre avancée : c’est une femme, Sahle-Work Zewde, qui a été désignée présidente du pays en octobre. Une fonction essentiellement honorifique, certes, mais qui témoigne de la montée en puissance des voix féminines, non seulement sur le terrain militant mais aussi sur la scène politique. Au niveau mondial, seulement 17 % des chefs d’Etat ou de gouvernement sont des femmes.