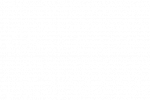Un conte bouleversant, un polar historique, des nouvelles carcérales : une semaine de lectures
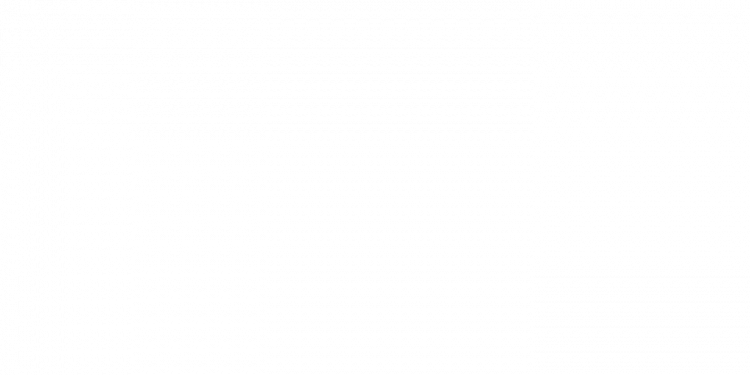
Un conte bouleversant, un polar historique, des nouvelles carcérales : une semaine de lectures
Chaque jeudi, la rédaction du « Monde des Livres » vous propose ses coups de cœur de la semaine.
« L’Hôtel aux barreaux gris » (The Graybar Hotel), de Curtis Dawkins, publié chez Fayard. / FAYARD
LES CHOIX DE LA MATINALE
Cette semaine, les fans d’Elena Ferrante la découvriront sous un jour nouveau avec la publication de Frantumaglia, un recueil de textes aux formats divers ; Jean-Claude Grumberg revient sur son enfance dans un conte mémoriel émouvant ; un taulard-écrivain raconte la vie dans une prison américaine ; le philosophe des médias Maurizio Ferraris se penche sur l’âge « documédial » ; Hervé Le Corre signe un lumineux polar au temps de la Commune de Paris.
CONTE : « La Plus Précieuse des Marchandises », de Jean-Claude Grumberg
Né à Paris en 1939 dans une famille juive, Jean-Claude Grumberg a vu, trois ans plus tard, son père être arrêté pour être emmené à Drancy, puis déporté à Auschwitz, où il a péri.
C’est une œuvre d’orphelin, hantée par la disparition de ce père et par la destruction des juifs d’Europe, que bâtit l’« auteur tragique le plus drôle de sa génération » (selon les justes propos de l’écrivain Claude Roy). Elle est peuplée d’enfants privés de leurs parents. De parents amputés de leurs enfants. C’est du côté de ces derniers que se place le terrible « conte » d’amour et de cendres La Plus Précieuse des Marchandises.
Son « héros » est l’homme sans nom qui, dans un train de marchandises acheminé depuis Drancy, décide en un instant de faire passer par la fenêtre l’un des jumeaux Henri et Rose nés quelques mois plus tôt – avec l’espoir que ce sacrifice permette au reste de la famille de survivre, et que le bébé soit recueilli par une femme aperçue le long de la voie.
Cette dernière, « pauvre bûcheronne » sans enfant, va chérir et élever l’enfant. Le livre se construit sur cette alternance. D’une part, les passages (les plus longs) consacrés à « pauvre bûcheronne », narrés sur le mode appuyé du conte, qu’une acerbe tendresse pour ses personnages empêche de tomber dans le simple pastiche. D’autre part, ceux, très courts, extraordinairement saisissants, centrés sur « l’ex-père des jumeaux », dont la femme et le fils restant, dès l’arrivée au « terminus », « s’affranchirent de toute pesanteur en gagnant les limbes du paradis promis aux innocents », et qui devint un survivant « malgré lui ».
Il y a quelque chose de bouleversant à voir Jean-Claude Grumberg, tenaillé par la peur de l’effacement de la mémoire, recourir au conte pour lutter contre l’oubli – le conte, cette forme qui s’exhibe comme fiction, mais qui s’est aussi imposée à travers les siècles comme la plus apte à se transmettre de génération en génération. Raphaëlle Leyris
« La Plus Précieuse des Marchandises ». Un conte, de Jean-Claude Grumberg, Seuil, « La librairie du XXIe siècle », 128 p., 12 € / SEUIL
NOUVELLES. « L’Hôtel aux barreaux gris », de Curtis Dawkins
Les corps tatoués et les âmes couturées. Avec L’Hôtel aux barreaux gris, titre qui reprend un sobriquet ironique donné à la prison aux Etats-Unis, Curtis Dawkins (lui-même incarcéré) signe une collection d’histoires courtes très réussies, par l’économie du style, la variété des situations et la galerie de portraits qu’elles dressent.
L’attente interminable, les manies des uns, des lubies des autres, l’amitié mêlée de défiance entre codétenus, leur dépendance à la télévision, les trocs divers auxquels ils se livrent forment la trame routinière du pénitencier de Coldwater (Michigan).
Il y a là des dépressifs et des bonimenteurs ; Tom qui rédige et vend des textes de rap érotiques pour les gays ; Arthur le barjot ; Catfish qui, dans le civil, était nettoyeur d’appartements souillés par des suicides à l’arme à feu ; Micky qui s’était déguisé en clown pour un cambriolage et que sa mère a dénoncé aux autorités ; George revenu du parloir en sachant que sa petite amie est atteinte d’un cancer ; ceux qui sont des gloires locales car leur affaire a été médiatisée ; celui qui téléphone à des numéros piochés dans l’annuaire, dans l’espoir que quelqu’un veuille bien accepter un appel en PCV… Le temps passe ainsi, entre résignation et mélancolie. Macha Séry
« L’Hôtel aux barreaux gris » (The Graybar Hotel), de Curtis Dawkins, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jean-Luc Piningre, Fayard, 244 p., 19 €. / FAYARD
PHILOSOPHIE. « Postvérité et autres énigmes », de Maurizio Ferraris
Sous l’impulsion d’Internet, nous sommes passés, explique le philosophe italien Maurizio Ferraris, de l’âge des médias, c’est-à-dire de la communication verticale, à la dynamique horizontale de l’âge « documédial », où nos « documents » (l’ensemble des données que nous faisons circuler) se médiatisent à travers nos milliards d’échanges numériques quotidiens.
En résulte un « tissu social (…) composé de monades : individus ou micro-communautés » pour lesquels « énoncer une vérité ne signifie pas reconnaître un état de choses, mais affirmer sa propre identité » – position qui fonde le phénomène désormais universel de la postvérité. « Je suis moi, voilà le refrain. »
Mais au nom de quelle morale serait-il mal de vouloir être soi ? « Nous sommes devenus plus sensibles, plus personnels, plus individuels », et de cela rien ne doit pouvoir nous priver. L’enjeu dès lors est de dénouer la « monadisation » et la postvérité. Cela demande une manière de thérapeutique conceptuelle au terme de laquelle la vérité ne sera ni une évidence ni un pur artefact, mais quelque chose « qui se fait », le fruit d’une « technologie » mentale nous reliant aux objets extérieurs, l’instrument ne se confondant pas avec ce qu’il instrumente : le réel, qui nous permet de penser et de dire autre chose que nous-mêmes, tout en affirmant notre existence avec force, là où elle se tient – en ce monde. Florent Georgesco
« Postvérité et autres énigmes » (Postverità e altri enigmi), de Maurizio Ferraris, traduit de l’italien par Michel Orcel, PUF, 192 p., 15 € (en librairie le 16 janvier). / PUF
POLAR HISTORIQUE. « Dans l’ombre du brasier », d’Hervé Le Corre
Dans l’ombre du brasier est la suite de L’Homme aux lèvres de saphir (Rivages, 2004) qui, auréolé de plusieurs prix, fit connaître Hervé Le Corre.
Hier en effervescence, Paris est, au printemps 1871, en état de siège. Le gouvernement d’Adolphe Thiers, à Versailles, passe à l’offensive pour mater la Commune. En marge de cette guerre civile, réapparaît le tueur en série Henri Pujols. Le voilà qui kidnappe, drogue et séquestre des jeunes filles afin de satisfaire des pornographes puis des clients de bordels.
Trois auxiliaires de police, ainsi qu’un soldat du 105e bataillon fédéré – dont l’amoureuse vient de disparaître –, enquêtent dans les rues, entre bivouacs et hôpitaux de fortune. Le récit d’Hervé Le Corre est divisé en dix chapitres. Autant de jours crépusculaires incluant la « semaine sanglante » (21-28 mai 1871) qui anéantira les rêves des insurgés. Il n’y aura pas de lendemains qui chantent.
Le Corre est un aquafortiste. D’un bout à l’autre, dans ce roman éblouissant, il creuse des ombres. Dans les cieux et sur les visages. Dans un Paris de suie et de nuit. Çà et là, des touches de couleur : le rouge sang du drapeau communard, l’incandescence d’un incendie, la flamme d’une lampe-tempête. Les lueurs d’espoir vacillent et ne s’éteignent pas. Macha Séry
« Dans l’ombre du brasier », d’Hervé Le Corre, Rivages, « Noir », 384 p., 22,50 €. / RIVAGES
RECUEIL. « Frantumaglia », d’Elena Ferrante
Vous aurez beau chercher dans les dictionnaires, vous ne le trouverez nulle part, ce mot étrange, frantumaglia, dont les sonorités, en français, évoquent vaguement les fantômes et le mal. Emprunté au dialecte qu’utilisait naguère la mère d’Elena Ferrante, ce terme « fourre-tout » désigne selon l’écrivaine un « matériau hétérogène difficile à définir », quelques notes de musique, un souvenir mouvant, « des petits et des grands morceaux dont il est ardu de déterminer la provenance et qui font du bruit dans la tête ». D’où ce titre.
Rassemblant lui aussi des « morceaux » – lettres, interviews, réflexions sur la fiction… –, Frantumaglia est un recueil composite. Elena Ferrante y parle de sa démarche, de ses livres, des films qui en ont été tirés. Elle revient sur ses héroïnes, Delia, Olga, Leda, Lenu… et aussi sur les femmes en général, le féminisme et les grandes figures qu’elle aime en littérature – Jane Austen, Virginia Woolf, Anna Maria Ortese, Clarice Lispector, Alice Munro et bien sûr Elsa Morante, pour qui elle a toujours nourri une vive admiration.
Elle s’y montre tout en humilité, foi dans les textes, ouverture d’esprit, noble distance et maturité. Frantumaglia dit, avec une sagesse et une finesse dont on ne se lasse pas, les valeurs hors du commun d’un écrivain qui ne l’est pas moins. Florence Noiville
« Frantumaglia. L’écriture et ma vie » (La Frantumaglia), d’Elena Ferrante, traduit de l’italien par Nathalie Bauer, Gallimard, « Du monde entier », 464 p., 23 €. / GALLIMARD