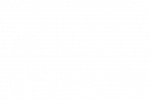Nicolas Maduro : l’illégitimité au pouvoir au Venezuela
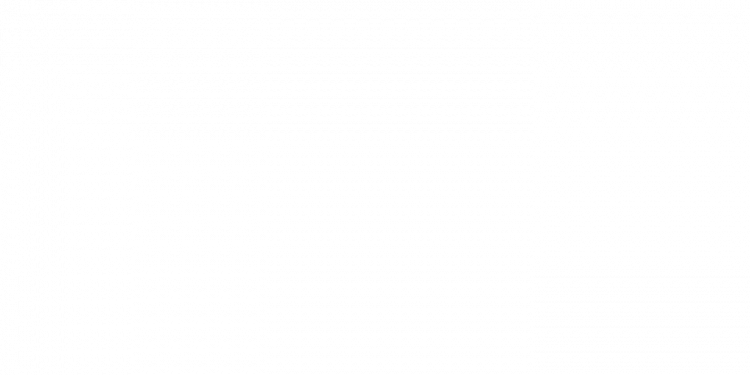
Nicolas Maduro : l’illégitimité au pouvoir au Venezuela
Editorial. Le successeur d’Hugo Chavez a été investi le 10 janvier pour un deuxième mandat. Après l’élection présidentielle sanglante de mai 2018, le pays traverse une crise dangereuse pour toute la région.
Editorial du « Monde ». Le 10 janvier, Nicolas Maduro a été officiellement investi pour un deuxième mandat à la tête du Venezuela. De manière symbolique, et contrairement à ce que prévoit la Constitution, l’héritier d’Hugo Chavez a choisi de prêter serment non pas devant l’Assemblée nationale, contrôlée par l’opposition et qu’il a dépouillée de ses prérogatives, mais devant la Cour suprême, composée de juges à ses ordres.
Cette cérémonie d’investiture aura surtout été l’occasion pour le président Maduro de constater son isolement diplomatique, tant les rangs des dignitaires étrangers étaient clairsemés. Les Etats-Unis, le Canada et les pays membres de l’Union européenne brillaient par leur absence, de même que la majorité des pays d’Amérique latine. Quelques jours plus tôt, douze d’entre eux avaient appelé le président vénézuélien à renoncer et à transférer le pouvoir au Parlement. L’UE, considérant que l’élection présidentielle de mai 2018 n’avait été « ni libre ni crédible », a demandé l’organisation d’un nouveau scrutin, « libre et juste ». Seuls les dirigeants de Cuba, du Nicaragua et de Bolivie avaient fait le déplacement, aux côtés de représentants de la Chine et de la Russie.
Paria de la communauté internationale, Nicolas Maduro, 56 ans, règne sur un pays en ruines. L’économie du Venezuela, pays producteur de pétrole, s’est totalement effondrée. Le FMI prévoit que l’inflation atteindra 10 millions pour cent en 2019. Le pays est désormais si misérable et dans une impasse politique et institutionnelle si totale que 2 millions et demi d’habitants l’ont quitté depuis trois ans. Jamais en Amérique latine un pays ne s’est autant vidé de sa population. Jamais les pays voisins du Venezuela n’ont été confrontés à un tel mouvement de population, supérieur à celui que l’Europe a vécu depuis 2015 avec l’arrivée de réfugiés et de migrants d’Afrique et du Moyen-Orient.
Flux migratoire exceptionnel
L’un des voisins du Venezuela, le Brésil, est dirigé depuis le 1er janvier par un président d’extrême droite, Jair Bolsonaro, qui n’a pas caché au cours de sa campagne qu’il considérait Cuba et le Venezuela comme des régimes hostiles : ce n’est pas auprès de lui que M. Maduro pourra chercher de l’aide. Mais c’est surtout en Colombie et, dans une moindre mesure, en Equateur, que l’arrivée massive de migrants vénézuéliens risque de provoquer une crise grave. La Colombie, qui en a déjà accueilli 1 million, a demandé aux institutions internationales de l’aider à supporter le coût de ce flux migratoire exceptionnel.
Rien ne permet de penser que cette fuite va se tarir, au contraire ; selon plusieurs experts, plus de 5 millions de Vénézuéliens auront rejoint les routes de l’exode d’ici à la fin de l’année. A mesure que leurs conditions de vie se détériorent, les Vénézuéliens se détournent chaque jour un peu plus de celui qui se réclame de la révolution bolivarienne lancée par le président Chavez, mort d’un cancer en 2013. Selon l’institut de sondage local Datanalisis, près des trois quarts des Vénézuéliens souhaitent le départ de Nicolas Maduro et 42 % voudraient le voir évincé par un coup d’Etat militaire. L’armée, cependant, semble continuer à le soutenir.
Quatorze pays d’Amérique latine ont constitué, en 2017, le « groupe de Lima » pour tenter de trouver une solution à la crise vénézuélienne. Il est aujourd’hui, plus que jamais, de leur responsabilité de surmonter leurs divergences politiques et de renouveler leurs efforts, afin d’éviter que ce qui est déjà une crise régionale ne s’aggrave encore.