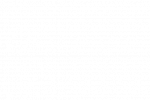En Tunisie, le syndicat UGTT défie le gouvernement

En Tunisie, le syndicat UGTT défie le gouvernement
Par Frédéric Bobin (Tunis, correspondant)
La principale organisation de salariés du pays conteste les choix économiques inspirés par le Fonds monétaire international.
Manifestation à Tunis lors de la grève générale du secteur public, le 17 janvier 2019. / Zoubeir Souissi / REUTERS
Il est là, à tenter de se frayer un passage vers la place de la rue Mohamed Ali, au pied de la médina de Tunis. La foule compacte, infranchissable, a empêché Abdelafattah Hajji, béret-casquette en coton piquant sur des lunettes fines, de se rendre sous le balcon du siège de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). Qu’importe, l’enseignant à la retraite, venu spécialement de la région montagneuse d’Aïn Draham, située dans le nord-ouest du pays, se contentera d’écouter à distance sur un bout de trottoir les harangues enflammées de Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’UGTT.
Ce jeudi 17 janvier, jour de grève générale en Tunisie, le dirigeant du principal syndicat de salariés défie ouvertement le chef de gouvernement Youssef Chahed qu’il accuse, en substance, de brader les « acquis de la souveraineté nationale ». L’épreuve de force, âpre, farouche, ajoute un nouvel élément d’incertitude à une transition démocratique tunisienne de plus en plus grevée par les hypothèques socio-économiques.
Ne pas « s’endetter davantage »
La veille, lors d’une réunion de la dernière chance, MM. Taboubi et Chahed avaient échoué à s’entendre sur les augmentations salariales dans la fonction publique revendiquées par l’UGTT. Le chef de gouvernement a invoqué « l’équilibre des finances publiques » qui interdit à la Tunisie, selon lui, de « s’endetter davantage ». Mais l’argument est irrecevable pour les troupes de l’UGTT – près de dix mille personnes – rassemblées jeudi au cœur de Tunis dans une ambiance pacifique mais surchauffée.
« Nous demandons seulement de compenser l’inflation actuelle [7,5 %] qui détruit notre pouvoir d’achat, clame Abdelfattah Hajji. Les gens sont en train de s’appauvrir. » L’ancien professeur d’anglais en souffre lui-même au premier chef. « Il y a quelques années, je pouvais m’offrir de la viande deux fois par semaine, précise-t-il. Aujourd’hui, c’est deux fois par mois, pas plus. »
Et lorsqu’on objecte à Abdelfattah Hajji les engagements internationaux de Tunis vis-à-vis des bailleurs de fonds, notamment la nécessité de discipliner la masse salariale dans la fonction publique – aujourd’hui à 15 % du PIB –, il s’indigne subitement : « Cette pression du Fonds monétaire international [FMI] met gravement en cause notre souveraineté ». Autour de lui, flottant au-dessus de la foule, les pancartes exhibant une photo gribouillée de Christine Lagarde – la présidente du FMI – témoignent de la sensibilité de la corde patriotique sur laquelle joue puissamment l’UGTT. Juché sur le balcon de la centrale syndicale, le secrétaire général Taboubi s’époumone : « Ce qui me fait le plus mal, c’est quand le gouvernement nous dit qu’il n’a pas pu obtenir le feu vert du FMI. »
Désenchantement quasi général
L’atmosphère est électrique en Tunisie au seuil d’une année électorale. La mobilisation de l’UGTT n’est en effet pas anodine alors que le petit pays d’Afrique du nord, terre d’éclosion du seul « printemps arabe » à avoir survécu au reflux général ayant suivi les bouleversements de 2011, s’apprête à retrouver le chemin des urnes – parlementaires et présidentielle – à la fin de 2019.
Huit ans après la révolution, les acquis démocratiques se sont accompagnés d’une stagnation, voire d’une régression, sur le terrain social et économique, et la fronde attisée par l’UGTT exprime un désenchantement largement partagé dans la population. Si le taux de croissance a rebondi à 2,8 % après le trou d’air provoqué par les attentats djihadistes de 2015, l’horizon reste obscurci par de vives tensions inflationnistes, une érosion continue du dinar, un alourdissement de l’endettement public (à 71,5 % du PIB), et surtout un taux de chômage élevé (15 % de la population active).
Dans ce contexte, l’UGTT, omnipotent syndicat qui a toujours joué depuis l’indépendance de 1956 un rôle à la fois syndical et politique, s’impose comme le canal naturel d’expression des doléances populaires. Mais les 750 000 adhérents du syndicat sont pour l’essentiel des salariés de la fonction publique et des entreprises d’Etat qui passent pour des « inclus » aux yeux de la masse des jeunes chômeurs désœuvrés.
Un gouvernement qui devrait finir par reculer
Inorganisés ou non encadrés, ces derniers, issus des régions intérieures du pays, sont en général à l’origine des troubles sociaux qui secouent rituellement le pays, contestant parfois les « privilèges » des syndiqués UGTT tous salariés. « L’UGTT a peur que cette “deuxième Tunisie” non structurée et donc incontrôlable puisse la déborder lors des grandes manifestations de protestation, souligne Khayam Turki, analyste fondateur du think tank Joussour. Et si la grève générale s’est plutôt bien passée, c’est parce que cette “deuxième Tunisie” ne s’est pas exprimée ce 17 janvier. »
Selon un cadre de l’UGTT s’exprimant sous le sceau de l’anonymat, le gouvernement devrait finir par reculer face à la pression du syndicat afin de neutraliser une partie de ce risque social. « A la limite, la grève générale de l’UGTT arrange le gouvernement, estime cette source, car elle lui donne un argument pour convaincre le FMI que des concessions salariales sont nécessaires. » D’autant que l’UGTT est consciente qu’une contestation durable du gouvernement peut être exploitée par les adversaires du chef de gouvernement Youssef Chahed. L’attitude du chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi, brouillé avec M. Chahed, ancien protégé qui s’est affranchi de sa tutelle, illustre ce risque d’instrumentalisation partisane. M. Essebsi n’a cessé ces derniers mois d’encourager discrètement l’UGTT à défier M. Chahed.