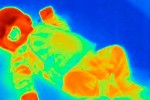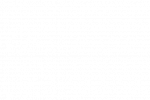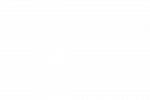Ebola : les militaires s’intéressent de près au virus

Ebola : les militaires s’intéressent de près au virus
Par Emmanuel Freudenthal (Kindia (Guinée), envoyé spécial), Chloé Hecketsweiler
S’il est connu que les armées russes et américaines étudient le virus Ebola depuis des années, le risque bioterroriste a été pris très au sérieux durant la dernière épidémie.
Un militaire américain à l’entraîmenent, à Fort Campbell (Kentucky), avant son départ pour l’Afrique de l’Ouest, le 9 octobre 2014. / Harrison McClary / REUTERS
En Guinée, à quelques heures de routes sinueuses de Conakry, la petite ville de Kindia a hébergé à partir de 1925 l’un des premiers instituts Pasteur d’Afrique, dont les expériences sur les primates ont permis le développement du vaccin contre la tuberculose. Aujourd’hui, une rangée de cages délabrées renferme quelques singes multipliant les allers-retours frénétiques d’un mur à l’autre. Ils ont vue sur un laboratoire flambant neuf composé de conteneurs gris. Une clôture surmontée de fils barbelés en interdit l’accès. Au-dessus, sur deux poteaux métalliques, flottent les drapeaux russe et guinéen.
Nous sommes ici au Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et en soins médicaux (Crems), construit par la Russie durant l’épidémie d’Ebola de 2014-2016 et financé à hauteur de 10 millions de dollars (8,8 millions d’euros) par la compagnie minière russe Rusal, qui exploite en Guinée le plus grand gisement de bauxite au monde. Peu après le début de l’épidémie, en août 2014, la Russie y a dépêché deux laboratoires mobiles ainsi que des spécialistes chargés de faire des tests pour déceler Ebola dans le sang des patients. Quelques mois plus tard, un centre de traitement permanent était construit, ainsi qu’un laboratoire, où travaillent actuellement une douzaine de scientifiques qui testent un nouveau vaccin contre le virus.
Ces recherches se font en secret. Même les hauts cadres du ministère guinéen de la santé se plaignent de ne pouvoir visiter les lieux. « Avec les Russes, c’est le black-out total », regrette l’un d’eux. Un habitué guinéen du Crems accepte de partager les bribes d’informations dont il dispose, mais confie ignorer ce que sont devenus les nombreux prélèvements sanguins effectués pendant l’épidémie. « Les Russes font ce qu’ils veulent », estime-t-il, en précisant qu’eux seuls ont le droit d’accéder aux laboratoires où ont lieu les recherches sur le virus. Pour lui, il ne fait aucun doute que ces chercheurs sont des militaires.
L’intérêt de l’armée russe pour Ebola n’est pas nouveau. Dans les années 1970, les Soviétiques se passionnaient déjà pour ce virus mortel, avec l’espoir de l’utiliser comme une arme. Malgré de multiples tentatives, le programme de développement d’armes biologiques, baptisé « Biopreparat », n’y est cependant pas tout à fait parvenu, comme le raconte Ken Alibek, l’un des scientifiques qui le pilotait, dans son livre autobiographique, Biohazard (Delta, 1999, non traduit).
Des recherches « à double usage »
« Avec la chute du rideau de fer, de nombreux transfuges de l’ex-URSS ont émigré aux Etats-Unis, et c’est ainsi que nous en avons appris davantage sur leurs projets, précise John Dye, virologue à l’Usamriid, une division de l’armée américaine spécialisée dans les recherches sur les maladies infectieuses. Je ne sais pas s’il serait facile de créer de telles armes – cela n’a jamais fait partie de nos objectifs – mais nous devons nous tenir prêts. » Ce scientifique connaît bien le sujet : pendant l’épidémie des années 2014 à 2016, il a contribué aux essais sur le médicament ZMapp, un cocktail d’anticorps monoclonaux, et sur le vaccin VSV-Ebov, aujourd’hui testé en République démocratique du Congo pour enrayer la propagation de la maladie dans les régions du Nord-Kivu et de l’Ituri.
Le virus se transmet exclusivement par contact corporel, ce qui limite sa propagation. Sauf que cela pourrait changer s’il évoluait, soit de manière naturelle, soit de manière intentionnelle. Pour se préparer à une telle éventualité, l’Usamriid a par exemple développé une technologie permettant d’inoculer le virus par voie respiratoire afin d’évaluer l’impact de ce mode de transmission sur le cours de la maladie et sur sa prise en charge. « Si le virus commence à se répandre par voie aérienne dans un hôpital, nous avons besoin de savoir si nos contre-mesures marchent », poursuit John Dye. Ces recherches dites « à double usage » – elles peuvent être utilisées aussi bien à des fins d’attaque que de défense – n’ont rien de secret. Elles font l’objet de publications scientifiques, et sont partagées avec des chercheurs civils. Ceux du National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL), affilié à l’université de Boston (Etats-Unis), s’en sont servis pour infecter des primates et ainsi évaluer l’efficacité d’un nouveau test diagnostic.
La décision de doter l’armée française d’un laboratoire de haute sécurité – un « P4 » dans le jargon – répond au même objectif d’anticipation de la menace. Situé à Brétigny-sur-Orge, en région parisienne, il devrait être opérationnel cette année. Si les militaires français ne croient pas trop à l’utilisation d’un virus comme Ebola par des armées, ils s’inquiètent davantage de ce que des terroristes pourraient en faire. « Quand il y a une épidémie avec des virus comme Ebola, on souhaite s’assurer que n’importe qui ne récupère pas des souches », souligne le médecin chef Eric Valade, responsable du département de biologie des agents transmissibles de l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA).
Durant l’épidémie de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest, ce risque bioterroriste avait été pris très au sérieux par les autorités françaises. « Les services de renseignement nous questionnaient là-dessus, des rapports du ministère de la défense circulaient, témoigne un scientifique français désireux de rester anonyme. Evidemment, vous ne faites pas un attentat au gaz sarin avec ça, mais des gens mal intentionnés avec un peu de bagage scientifique peuvent très bien cultiver le virus dans un garage et l’utiliser pour infecter des gens. On peut même imaginer un kamikaze qui va se l’inoculer et toucher des passagers dans le métro pour les contaminer. »