Le règne des « hommes forts »
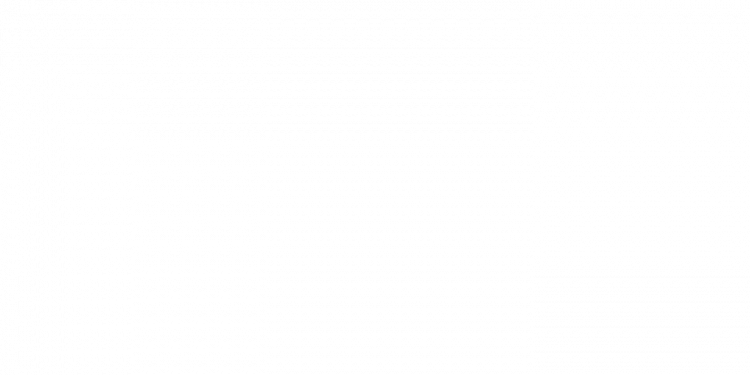
Le règne des « hommes forts »
Bilan du Monde
Chine, Russie, Turquie… les régimes autoritaires dominent l’agenda géopolitique, profitant du recul des démocraties occidentales minées de l’intérieur par les succès des partis ou des idées d’extrême droite populistes et nationalistes, jusqu’au cœur même de la Maison Blanche, analyse le journaliste du « Monde » Alain Salles.
Analyse. En septembre 2016, au sommet du G20 à Hangzhou, en Chine, le monde commençait à changer de couleur. Barack Obama comptait les dernières semaines de sa présidence, François Hollande aussi (même s’il ne le savait pas…). Mais Matteo Renzi n’avait pas encore perdu son référendum constitutionnel en Italie et faisait encore illusion, tout comme Justin Trudeau, le nouveau premier ministre canadien, et la chancelière allemande, Angela Merkel, continuait à régner sur l’Europe.
Pourtant, les « hommes forts » commençaient à occuper le terrain, avec une assurance de plus en plus grande. Xi Jinping était un hôte triomphant, même s’il n’était pas encore président à vie. Vladimir Poutine avait annexé la Crimée en 2014 et entamé depuis un an son soutien fructueux à Bachar Al-Assad en Syrie. Recep Tayyip Erdogan, enfin, venait d’échapper à une tentative de coup d’Etat et, renforcé comme jamais, menait une campagne d’arrestations sans précédent pour détruire l’opposition. On voyait apparaître au grand jour les prémices d’un renversement du monde, où les représentants fatigués des vieilles démocraties occidentales se faisaient voler la vedette par des autocrates en pleine puissance.
Droits de l’homme « à la chinoise »
Deux ans plus tard, au G20 de Buenos Aires, les 30 novembre et 1er décembre 2018, le camp des démocrates semble s’être réduit comme peau de chagrin. L’étoile du jeune président français, Emmanuel Macron, a brutalement cessé de briller sous l’effet des « gilets jaunes », des émeutes de Paris et de son impuissance européenne. L’avion de la chancelière allemande, à bout de souffle, est resté cloué au sol et Angela Merkel a raté la triste photo de famille, qui fait la part belle aux contempteurs du libéralisme éclairé de l’Occident. L’hôte du sommet, le libéral Mauricio Macri, est à la tête d’un pays en faillite. Xi Jinping, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan étaient encore plus rayonnants que deux ans auparavant.
Surtout, dans ce genre d’assemblée, ils paraissent désormais mesurés et diplomates par rapport au président américain, Donald Trump, qui se fait un plaisir de saboter les grandes messes multilatérales que les Etats-Unis dominaient jusque-là, laissant leurs alliés occidentaux désemparés pendant que les « hommes forts » triomphent.
Xi Jinping a réformé la Constitution en mars 2018 pour devenir président à vie. Il construit une gigantesque sphère d’influence et d’expansion économique à travers ses « nouvelles routes de la soie », constitue un vaste réseau de surveillance intérieure et bâtit des camps d’internement pour la minorité ouïgoure musulmane. Profitant de la mauvaise image et du protectionnisme de Donald Trump, il se fait à Davos le chantre du multilatéralisme et de l’ouverture de l’économie, alors que le marché chinois reste fermé aux entreprises occidentales.
Il prétend même vouloir défendre une conception des droits de l’homme « à la chinoise », pour le moins éloignée de la Charte de l’ONU. Plus grave pour le camp occidental, il fait mentir une vieille espérance, qui voulait que l’augmentation du niveau de vie entraînerait une progression des idées démocratiques et un désir de liberté dans les pays autoritaires. « Un nouveau monde émerge en Asie, mais ce n’est pas un monde libre », écrit l’historien Peter Frankopan dans Les Nouvelles Routes de la soie (Nevicata, 2018).
« High five » rigolard avec Poutine
Après l’annexion de la Crimée, Vladimir Poutine est en train de privatiser la mer d’Azov, jusque-là partagée entre la Russie et l’Ukraine. Peu avant la réunion de Buenos Aires, les forces russes ont arraisonné un bateau ukrainien, embarquant vingt-quatre marins, détenus désormais comme otages, sans provoquer de grands émois occidentaux, sauf l’annulation d’une rencontre avec Trump au G20. Ses services sont soupçonnés d’avoir réalisé une attaque chimique au Royaume-Uni contre leur ancien agent Sergueï Skripal.
Identifiés par les services occidentaux et les médias, les auteurs présumés paradent à la télévision russe et sont défendus par le président. Les sites prorusses déversent leur propagande sur Internet et sont soupçonnés d’avoir influencé les élections américaines. Poutine poursuit sa partie d’échecs avec l’Occident, exploitant la moindre faille de ses adversaires et nourrissant à son avantage la mégalomanie de Donald Trump, comme en a témoigné la pénible conférence de presse commune à Helsinki, le 13 juillet, quand le président américain a désavoué ses propres services devant son homologue russe.
Erdogan continue à enlever, enfermer et torturer des gülenistes – désignés comme les uniques responsables du coup d’Etat de 2016 – en utilisant ses réseaux d’agents des Etats-Unis à la Russie, en passant par Téhéran. Enfin, le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman (MBS), a réussi en Argentine son grand retour sur la scène internationale malgré le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien d’Istanbul, le 2 octobre 2018. Les images de son « high five » rigolard avec Poutine ont fait le tour du monde. Deux ans auparavant, à Hangzhou, il incarnait encore l’image d’un prince qui voulait moderniser la monarchie pétrolière…
Ils sont d’autant plus triomphants qu’ils sont de moins en moins seuls. En Inde, Narendra Modi a fait prendre, depuis 2014, à « la plus grande démocratie du monde » un virage nationaliste hindou, au détriment des musulmans et des défenseurs des droits de l’homme. Au Brésil, un candidat d’extrême droite, Jair Bolsonaro, totalement marginal jusque-là, a remporté l’élection présidentielle d’octobre 2018, bénéficiant de l’écroulement du système politique symbolisé par l’emprisonnement de l’ancien président charismatique de gauche Lula, de la corruption généralisée de nombreux partis et de l’impuissance à résoudre la crise économique qui a brisé l’essor de ce pays émergent.
Crise migratoire prétexte
Mais le camp de la démocratie occidentale est aussi miné de l’intérieur en Europe et aux Etats-Unis. L’effondrement des partis traditionnels est à l’œuvre dans plusieurs pays européens (France, Italie, Espagne, Grèce, etc.), et s’accompagne souvent d’une montée des partis populistes d’extrême droite, prompts à incarner le mécontentement lié à la crise économique et à celle des migrants, en 2015, quand un million de personnes ont traversé l’Europe par la Grèce et la route des Balkans.
« La crise de 2008 a accentué la défiance à l’égard des institutions européennes, et cette défiance se traduit par le rejet culturel des élites comme des immigrés, les deux faces de l’ouverture des frontières », souligne le politologue Ivan Krastev. Des partis d’extrême droite sont au pouvoir en Autriche, en Italie et en Bulgarie, sans susciter la réprobation des partis traditionnels, qui parfois gouvernent avec eux. La crise migratoire de 2015 a servi de prétexte à des gouvernements ultranationalistes en Hongrie et en Pologne pour s’affranchir des règles libérales de Bruxelles.
Tous ces mouvements de raidissement idéologique aux quatre coins de la planète se sentent désormais confortés par l’ancien leader du monde libre, les Etats-Unis. La victoire de Donald Trump a, en effet, bouleversé les équilibres du monde. Sa doctrine « America first » s’applique à la Chine, contre qui il s’est lancé dans une guerre commerciale, sans chercher véritablement d’appuis. Car l’autre principal danger, selon le président américain, vient de ses propres alliés, accusés à longueur de Tweet de vouloir profiter de l’argent américain.
Les accusations visent là aussi les déséquilibres commerciaux avec le Japon, et surtout l’Allemagne d’Angela Merkel, qui s’était présentée dès novembre 2016 comme la championne de la démocratie libérale. « Celui qui dirige ce grand pays [les Etats-Unis], compte tenu de sa puissance économique considérable, de son potentiel militaire et de son rayonnement particulier, a une responsabilité vis-à-vis du reste du monde », avait-elle déclaré, en rappelant les « valeurs communes » à l’Allemagne et aux Etats-Unis : « La démocratie, la liberté, le respect du droit et de la dignité humaine, quels que soient l’origine, la couleur de peau, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle ou les opinions politiques. »
L’Europe se lézarde de toutes parts
Deux ans plus tard, après treize ans de pouvoir, contestée en interne au sein de son propre parti, elle n’a plus l’énergie pour incarner l’opposition à Trump. Et ses discours ont pris un tour crépusculaire, à l’image de celui du 11 novembre, à Paris : « il est facile de détruire les institutions internationales, mais difficile de les reconstruire. » Avant de s’interroger : « Serions-nous aujourd’hui capables, en tant qu’Assemblée des nations, d’approuver comme en 1948 la Déclaration universelle des droits de l’homme ? Je n’en suis pas si sûre. »
Elle faisait ainsi écho aux propos tout aussi pessimistes du président français, le même jour : « L’histoire retiendra une image, celle de 80 dirigeants réunis sous l’Arc de triomphe, mais ce qui est incertain est de savoir comment elle sera interprétée dans l’avenir : le symbole d’une paix durable entre les nations, ou bien le dernier moment d’unité avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre. » Un mois plus tard, l’Arc de triomphe a été le lieu des violences et de contestations anti-Macron lors des manifestations des « gilets jaunes », affaiblissant un peu plus l’image internationale d’un président français qui prétendait soutenir les poignées de main vigoureuses de son homologue américain et espérait le faire changer d’avis.
L’Europe n’est plus en position de force. Elle reste la deuxième puissance économique du monde, mais elle doute d’elle-même et se lézarde de toutes parts. La crise grecque a été la première fissure, de 2010 à 2015. Deux Europe se sont affrontées, celle du Nord et celle du Sud, dans des visions caricaturales de la cigale grecque dépensant l’argent des travailleurs du Nord et de la fourmi allemande, acharnée à imposer une Europe de l’austérité à ces pécheurs incapables de se repentir. Le langage a été souvent guerrier, dans ce qui ressemblait à une « désunion » européenne, impuissante à répartir les maigres fruits de l’absence de croissance. Qui plus est, l’UE s’est refusée au moindre mea culpa, alors que le Fonds monétaire international (FMI) a reconnu qu’il avait sous-estimé les risques d’impact négatif des mesures d’austérité imposées à Athènes.
C’est dans cette Europe déchirée qu’est survenue la crise migratoire de 2015 et l’impossibilité pour l’Europe d’y faire face. L’Allemagne, l’Autriche et la Suède ont accueilli une bonne partie des réfugiés, provoquant une montée de l’extrême droite dans leur électorat. Le reste de l’Europe s’est montré peu solidaire, laissant ces trois pays essayer d’intégrer les migrants, et l’Italie et la Grèce gérer le flot des arrivées.
Une vaste partie de poker
Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, dont la popularité baissait, s’est alors fait le chantre de la lutte contre « l’invasion » des migrants et des musulmans, appuyé par d’autres pays d’Europe centrale. En accusant l’UE de mettre en cause l’identité européenne – sous-entendu chrétienne –, la Pologne et la Hongrie ont utilisé la crise migratoire pour provoquer Bruxelles sur d’autres valeurs fondamentales de l’UE : le respect de l’Etat de droit et la liberté de la presse. Viktor Orban a fait alliance avec le vice-premier ministre d’extrême droite italien, arrivé au pouvoir le 1er juin, Matteo Salvini, tout en restant au sein de la famille de la droite européenne, le Parti populaire européen, qui n’a jamais critiqué l’alliance du chancelier autrichien avec le parti d’extrême droite, le FPÖ.
Le vote des Britanniques en faveur d’une sortie de l’Union a fait comprendre que l’Europe était mortelle. Si la gestion désastreuse du Brexit par le Parti conservateur et le chef des travaillistes, Jeremy Corbyn, a permis à l’UE de rester ferme et unie face aux demandes contradictoires du gouvernement britannique, cette unité de façade ne peut cacher les lézardes du reste de la maison Europe.
Pendant ce temps, Donald Trump poursuit son travail de sape. Il se réjouit du Brexit, tout en attaquant la première ministre, Theresa May, trop complaisante à l’égard de l’UE. Après avoir dénoncé l’accord de Paris sur le climat, le 1er juin 2017, il dénonce en mai 2018 celui de 2015 sur le programme nucléaire iranien, puis le traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF, Intermediate Nuclear Forces Treaty) en octobre 2018. Il montre ainsi qu’il ne se sent pas lié par la signature de ses prédécesseurs – le traité INF avait pourtant été signé par Ronald Reagan en 1987. Ces décisions sont toujours prises unilatéralement et sans tenir compte des avis contraires, généralement par Tweet. La diplomatie américaine est transformée en une vaste partie de poker, où Donald Trump donne l’impression de faire tapis à chaque partie.
C’est de la même façon qu’a été annoncé le retrait des forces américaines de Syrie, au prétexte que la guerre contre l’organisation Etat islamique (EI) était terminée, et alors que de nombreux services s’inquiètent de la résurgence de l’EI sous forme de guérilla urbaine. La France et le Royaume-Uni, pourtant présents sur place, ont tout juste été prévenus. Quant aux forces kurdes qui ont bataillé contre l’EI tout en tentant de constituer une région autonome en Syrie, elles risquent de se retrouver à la merci de la Turquie, qui a toujours considéré que la lutte contre les alliés syriens du PKK était une priorité par rapport à l’EI.
Cuisante défaite
Erdogan a promis à Trump qu’il finirait le travail avec l’EI. Cela a suffi au président américain, qui lui a répondu : « It’s all yours. We are done » (« C’est à vous, nous avons fini »), aurait-il assuré à son interlocuteur, ravi de voir que les Américains ne seraient plus aux côtés des Kurdes. Comme pour réunir les protagonistes de l’affaire Khashoggi, Donald Trump s’est aussi réjoui que l’Arabie saoudite « dépenserait l’argent nécessaire pour reconstruire la Syrie, au lieu des Etats-Unis ».
La Syrie marque une cuisante défaite pour le camp occidental. Après le refus de Barack Obama d’intervenir après une attaque à l’arme chimique en 2013, les Russes ont pu faire leur retour en force au Proche-Orient. Ils ont maintenu à bout de bras le régime de Bachar Al-Assad, permettant la reconquête de l’ensemble du territoire, avec l’appui déterminant de l’Iran, autre grand vainqueur de la décision de retrait américain, alors que Téhéran faisait figure d’ennemi numéro un de Washington depuis la spectaculaire réconciliation de Donald Trump avec Kim Jung-un en Corée du Nord.
« Le Bilan du monde 2019. Géopolitique, environnement, économie », 218 pages, 12 euros. Vendu en kiosque et sur le site Boutique.lemonde.fr
Le sort de la Syrie et du régime, longtemps objet des négociations pour la paix à Genève, sous l’égide des Nations unies, de Paris et de Washington, se joue désormais entre Moscou, Téhéran et Ankara, trois pays bien éloignés de la conception de gendarme du monde que l’Amérique de Trump ne veut plus jouer. Trois pays qui défendent leurs propres intérêts dans la région sans se soucier de droits de l’homme ou de jugement des crimes du régime contre une partie de son peuple.
Dans le nouveau wargame du XXIe siècle, Xi Jinping joue au go, Poutine aux échecs, Trump au poker, Erdogan à une partie de backgammon dont il ne s’avoue jamais vaincu, MBS à un jeu vidéo un peu brutal, les dirigeants britanniques à un chamboule-tout permanent. Quant aux Européens, ils semblent se contenter de réussites sans fin, alors que le tapis vert sur lequel ils déposent leurs cartes se dérobe sous leurs yeux. Il est décidément bien loin le temps où, au lendemain de la chute de l’Union soviétique, l’essayiste américain Francis Fukuyama prophétisait « l’universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale de tout gouvernement ».
Cet article est tiré du « Bilan du monde 2019. Géopolitique, environnement, économie », 218 pages, 12 euros. Vendu en kiosque et sur le site Boutique.lemonde.fr








