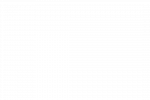Brexit : Theresa May à Bruxelles pour tenter de trouver un nouvel accord
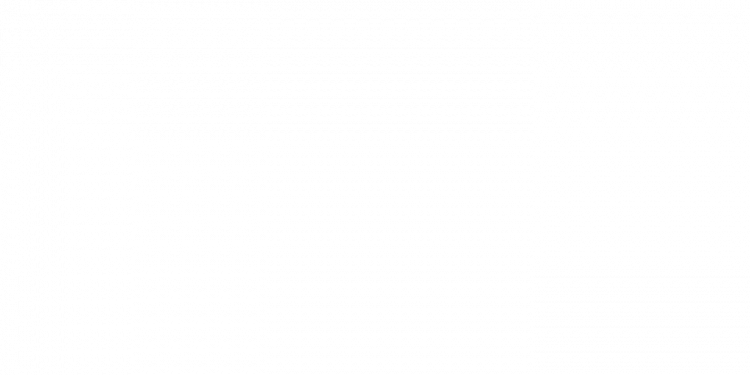
Brexit : Theresa May à Bruxelles pour tenter de trouver un nouvel accord
Le Monde.fr avec AFP et Reuters
La première ministre britannique doit fairedes propositions pour éviter le « backstop » que veut mettre en place l’UE pour éviter le retour d’une frontière physique en Irlande.
Theresa May, la première ministre britannique, à Belfast, en Irlande du Nord, le 5 février. / CLODAGH KILCOYNE / REUTERS
A un mois et demi de la date supposée du Brexit, Theresa May va tenter, encore une fois, de trouver un nouvel accord avec Bruxelles sur la question brûlante de la frontière irlandaise. Une tâche ardue, pour ne pas dire déjà condamnée à l’échec, car les Européens ne cessent de répéter que l’accord de retrait entériné à la fin de novembre – mais que le Parlement britannique a rejeté le 15 janvier – n’était pas ouvert à la renégociation.
La première ministre britannique doit successivement rencontrer jeudi 7 février le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker ; le président du Parlement européen, Antonio Tajani ; ainsi que son référent Brexit, Guy Verhofstadt ; et enfin le président du Conseil européen, Donald Tusk. Ce dernier a provoqué une vive polémique au Royaume-Uni mercredi, en s’interrogeant sur « la place spéciale en enfer » qui attendrait « ceux qui ont fait la promotion du Brexit sans même l’ébauche d’un plan pour le réaliser en toute sécurité ».
Le « backstop » rejeté par le Royaume-Uni
Dans ce climat tendu, Mme May va reconnaître qu’il ne sera « pas facile » d’obtenir des changements et que l’accord de retrait a été « négocié de bonne foi » avec Bruxelles, a expliqué son porte-parole. Mais « le Parlement [britannique] a voté à une majorité significative (…), envoyant un message sans équivoque que le changement est nécessaire », doit argumenter la première ministre, selon des éléments fournis à l’avance par Downing Street. Aussi, « l’objectif du Royaume-Uni est de trouver le moyen de garantir que nous ne pouvons pas être, et ne serons pas, piégés dans le filet de sécurité ».
Ce « filet de sécurité », ou backstop en anglais, a été introduit dans l’accord de retrait comme solution de dernier recours, destinée à éviter le retour d’une frontière physique sur l’île d’Irlande.
Ce dispositif transforme l’Irlande du Nord en « territoire douanier unique », dans lequel la libre circulation des marchandises permise par l’Union européenne restera en vigueur. Il évite toute taxe douanière ou quota entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE, pour les biens industriels et agricoles seulement), mais n’oblige pas Londres à suivre l’évolution des normes réglementaires décidée par Bruxelles.
Mais le backstop est rejeté en bloc par Londres et Theresa May voudrait le remplacer par des mécanismes alternatifs, comme son Parlement lui a donné mandat le 29 janvier.
Vers un « no deal » ?
Selon Downing Street, trois options sont envisagées pour le backstop : une limite dans le temps, une sortie unilatérale du dispositif décidée par le Royaume-Uni, ou un plan proposé par des députés basé notamment sur l’utilisation de technologies pour des contrôles douaniers dématérialisés.
Bruxelles a déjà écarté les deux premières options par le passé et doute de la faisabilité de la troisième. Pour l’Union européenne, il s’agit non seulement de ne pas fragiliser les accords de paix de 1998, qui ont mis fin aux troubles en Irlande du Nord, mais aussi de préserver le principe de base qu’est le marché unique.
L’absence d’alternative claire au backstop menace de plus en plus de précipiter le Royaume-Uni vers une sortie sans accord (ou « no deal ») le 29 mars. Si Theresa May ne parvient pas à obtenir des concessions jeudi, elle reviendra à Londres au point de départ, avec plusieurs scénarios : un Brexit sans accord, un nouveau référendum, des élections anticipées ou pas de Brexit du tout.