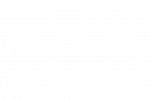Nana Akufo-Addo : « Le Ghana doit fabriquer ce qu’il consomme »

Nana Akufo-Addo : « Le Ghana doit fabriquer ce qu’il consomme »
Propos recueillis par Maryline Baumard
Le président ghanéen n’a pas encore décidé s’il briguera un second mandat fin 2020. En attendant, son programme avance moins vite qu’escompté.
Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, lors de l’entretien accordé à TV5 Monde, en partenariat avec « Le Monde », au palais présidentiel, à Accra, le 17 février 2019. / DR
De l’or et de la bauxite dans son sous-sol, 5 à 7 milliards de barils de réserve de pétrole au large de ses côtes et assez de fèves de cacao pour se classer deuxième producteur mondial. De quoi expliquer que le Ghana se retrouve champion de la croissance avec 6,2 % en 2018. Et pourtant, le pays revient de loin puisqu’il avait dû faire appel au Fonds monétaire international (FMI) en 2015 pour un emprunt frôlant le milliard de dollars.
Or le président Nana Akufo-Addo, arrivé à la tête du pays le 7 janvier 2017, ne veut plus de cette tutelle. Cet Etat de 28 millions d’âmes, situé entre le Togo, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, essaie de trouver une voie pour y développer sa propre industrie.
A mi-mandat, il lui reste beaucoup à faire dans un pays où un quart de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Notamment dans le nord du pays, pas très loin de l’attentat qui a frappé, vendredi 15 février, au Burkina voisin, un prêtre espagnol et quatre douaniers burkinabés. Cet entretien avec Nana Akufo-Addo reprend les moments clés de l’émission « Internationales » de TV5 Monde dont Le Monde est partenaire.
Le Burkina est depuis plusieurs mois déstabilisé et l’ensemble des pays du G5 Sahel viennent de demander une aide accrue à la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme. Quelle est votre analyse de cette menace ?
Nana Akufo-Addo La menace terroriste sur l’Afrique occidentale est le plus gros défi que nous avons dans toute la région. Il faut trouver les moyens sécuritaires, militaires et politiques de réduire cette menace. Je pense que tant que nous ne serons pas parvenus à résoudre la crise libyenne, il sera difficile d’amener les djihadistes basés au Mali et au Nigeria à baisser les armes. L’Union africaine (UA) vient d’annoncer qu’elle lancerait une grande force diplomatique pour tenter de résoudre la crise libyenne, mais c’est très difficile. Ces pays [Mauritanie, Mali Burkina, Niger et Tchad] sont pauvres et n’ont pas les moyens de faire face seuls à la menace sécuritaire, alors le partenariat que nous avons avec la France et plus largement l’Europe est extrêmement important pour essayer de stabiliser cette zone.
Au Ghana, la peine de mort existe encore. L’avocat défenseur des droits humains que vous avez été pense-t-il qu’il faut l’abolir ?
Oui, je le pense. Mais, en temps que leader du pays, président de la République, je dois prendre en compte l’opinion de toute la société. Heureusement, la peine capitale n’existe plus que sur le papier, car elle n’est plus appliquée depuis des dizaines d’années. Il y a d’autres priorités pour les Ghanéens. La lutte contre la pauvreté extrême en est une.
Vous êtes à mi-mandat, quelle partie de votre programme électoral avez-vous mise en œuvre ?
Ma priorité reste toujours la même. Il faut arriver à transformer la structure de l’économie ghanéenne. Jusqu’ici, elle est basée sur la production et l’exportation de ses matières premières. On n’arrivera pas à créer les conditions du développement et de la richesse avec une telle économie. Passer de l’économie agraire à une économie industrialisée est mon objectif prioritaire. Nous sommes lancés, mais n’avons pas encore abouti au résultat recherché.
Durant votre campagne, vous aviez ce slogan « Un district, une usine » ? Où en êtes-vous ?
Depuis mon arrivée, 44 entreprises ont déjà ouvert hors de la sphère de l’Etat. Au Ghana, l’Etat ne construit pas, mais encourage le privé à investir. Si l’on regarde plus spécifiquement mon programme de campagne, 84 usines sont programmées. Je ne sais pas si nous arriverons à 260, soit autant que de districts, mais il nous faut produire de la valeur ajoutée et fabriquer ce que nous consommons.
Vous avez décidé que le Ghana reprendrait sa liberté par rapport au FMI cette année. Pourquoi est-ce aussi important à vos yeux ?
Il est important que notre population ait le sentiment de décider de son avenir sans être dépendant d’une tutelle. Le peuple ghanéen, comme les autres peuples avancés, comme tout le monde, a envie de prendre son destin en main et de créer la société qui lui convient. Si notre politique est rationnelle, disciplinée, nous avancerons comme cela s’est fait en Asie il y a plusieurs décennies. Mais il faut donner confiance au secteur privé, aux investisseurs. Et c’est ce que je voudrais faire.
Quelle marge de manœuvre avez-vous alors que 70 % de la richesse du pays vont au remboursement de la dette ?
Nous sommes en train de faire restructurer notre dette. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, le pays avait un taux d’endettement de 73 % du PNB. Avec la restructuration des années précédentes, on est plutôt aux alentours de 60 % et nous allons continuer dans ce sens. Et, lorsque la confiance sera rétablie, nous emprunterons moins cher.
Le facteur psychologique est donc important ?
Il faut qu’ici les gens ressentent qu’ils sont capables de vivre dans le monde, d’agir dans le monde, de travailler dans le monde et qu’ils ont des structures qui le leur permettent. Etre encore sous la tutelle des Occidentaux, du FMI, soixante ans après l’indépendance, ça n’est pas une situation acceptable.
Ne craignez-vous pas une nouvelle tutelle, celle de la Chine, avec qui vous avez signé plusieurs marchés ?
La Chine prête aussi à la France… et nous regardons au plus près les termes de notre relation. Nous avons signé un contrat de 2 milliards de dollars, mais pour vendre de la bauxite en matière transformée. Il ne s’agit pas de prendre nos matières premières telles quelles.
En mai 2018, vous avez lancé un programme pour donner du travail à 100 000 jeunes diplômés au chômage, en espérant qu’ils deviennent entrepreneurs. Dix mois après, pouvez-vous dresser un premier bilan ?
Pas encore. Ces contrats ont été signés pour trois ans. Pour l’instant, ils accomplissent des taches essentielles. Ils travaillent sur la collecte de la fiscalité, la douane, le monde médical. Ils aident le service public. Nous comptons sur eux pour faire rentrer l’impôt. Nous avons besoin d’eux.
La chancelière allemande, Angela Merkel, est venue en août 2018 et a promis une usine d’assemblage automobile. Ne craignez-vous pas que le Ghana devienne un nouveau marché à bon compte pour les exportations allemandes ?
Les conventions prévoient de commencer par une usine d’assemblage, que nous ferons évoluer vers de la production. Et si ce n’est pas possible, nous reverrons l’accord.
Votre pays compte toujours 24 % de personnes très pauvres… Or vous ne consacrez que 1,4 % de votre richesse à la protection sociale. Moins que vos voisins. La réduction de cette pauvreté est-elle importante pour vous ?
Il est important d’équilibrer les politiques pour que le mouvement national ait une universalité. Si les changements dans le pays ne bénéficient qu’à une petite partie de la population, on n’arrivera pas à rassembler les forces et à s’appuyer sur la puissance de tous. Je suis libéral, car je pense que la créativité, au sens de la capacité à innover, qu’il y a en chacun est extrêmement importante pour le développement de l’être humain. Les sociétés dirigistes gouvernées par des principes très rigides dans la distribution de la richesse – on a vu cela durant le XXe siècle – n’ont pas fonctionné.
Certes, mais vous dépensez moins pour le social que la moyenne des pays africains : 1,4 % contre 2,1 %, comme l’a rappelé en 2018 le rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté…
Ce chiffre est basé sur des données antérieures à mon arrivée. Il faut regarder ce qu’on cherche à faire. Il faut remonter ce budget, c’est important pour la justice sociale. J’aimerais, par exemple, qu’on y comptabilise la gratuité de l’enseignement secondaire que nous avons mise en place. Cela fait partie de la protection sociale. Chaque année, au moins 100 000 jeunes n’arrivaient pas à passer de la primaire au collège et abandonnaient l’école. Avec notre politique, 300 000 jeunes Ghanéens sont entrés dans le secondaire. C’est une politique qui vise à rééquilibrer la société.
Qu’est-ce qui ne démarre pas aussi vite que vous l’escomptiez ?
La structure de l’administration. C’est mon héritage le plus lourd. Elle n’est pas aussi efficace que je le souhaiterais. Nous avons commencé les réformes, en changeant des hommes, des organisations, des structures. Mais il faudra du temps… trois ou quatre ans.
Serez-vous candidat à un second mandat fin 2020 ?
On verra bien si mon parti sera satisfait de mon travail. Et je n’ai pas encore décidé si je le souhaite parce que ce n’est pas facile. Au début de l’année prochaine, cela devra être clair dans mon esprit et aussi pour le parti.
Votre mission est-elle plus difficile que vous ne le pensiez ?
J’ai toujours pensé que ce serait difficile. Je ne sais pas si ce que je fais est unique, mais il est rare dans l’histoire d’utiliser les moyens démocratiques, les valeurs des institutions démocratiques pour faire évoluer et progresser un pays pauvre. Regardez le monde : les valeurs démocratiques ne se sont pas fait une place en France avant le XXe siècle. Au XIXe siècle, la révolution industrielle européenne ne s’est pas faite dans des conditions démocratiques. Même l’évolution des pays asiatiques ne s’est pas faite dans un climat de démocratie.
Rendez-vous est pris pour la mise en place d’une monnaie unique à l’échelle de la région en 2020. Vous pensez la date tenable ?
Cela a déjà été reporté. Mais on doit s’affranchir des conditions structurelles et des relations entre la zone franc et la Banque de France. Une monnaie commune nous aidera tous dans la région, cela aidera au commerce et au développement de nos économies. Je ne dis pas que, dans la zone franc il n’y a pas eu d’évolution, mais si on arrive à élargir un marché à ses quinze pays, il sera beaucoup plus performant pour nous tous.
Ces relations sont-elles un frein ?
J’hésite à utiliser le mot « frein », mais je dis que cela fait partie des problèmes structurels qu’il nous faut dépasser.
Emmanuel Macron a été le premier président français à visiter votre pays en 2018. Trouvez-vous que sa politique change beaucoup de celle de ses prédécesseurs ?
Pas tellement, non. Mais j’ai trouvé qu’Emmanuel Macron cherchait à trouver un bon chemin pour traiter l’avenir entre l’Europe et l’Afrique. C’est de ce sujet dont il a parlé. Il a mis l’accent sur le fait que l’Afrique et l’Europe peuvent coopérer. Et il a raison, car c’est une relation géographique, historique et stratégique très importante. C’est la Méditerranée qui nous sépare.