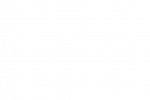En Lorraine, les formations en artisanat d’art attirent de nouveaux profils
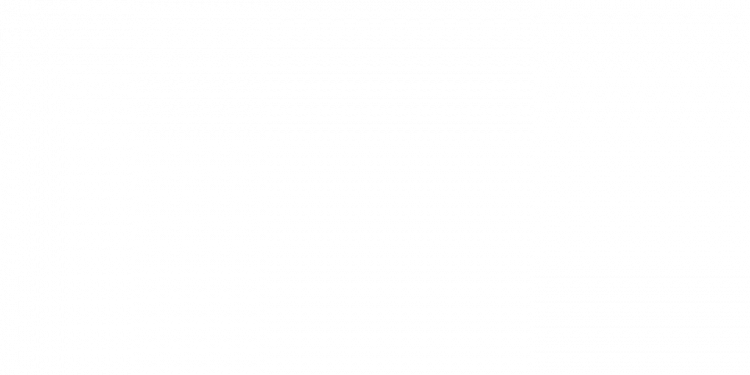
En Lorraine, les formations en artisanat d’art attirent de nouveaux profils
Par Léa Iribarnegaray (Favières, Vannes-le-Châtel, Diarville (Meurthe-et-Moselle) et Mirecourt (Vosges) - envoyée spéciale)
En Lorraine, les savoir-faire autour du verre, de la broderie ou de la lutherie séduisent de nombreux jeunes et adultes en quête de reconversions. Reportage à l’occasion de l’événement O21, organisé par « Le Monde » à Nancy le 28 février.
Lycéens, étudiants, professeurs, parents, jeunes diplômés... « Le Monde » vous donne rendez-vous en 2019 à Nancy le jeudi 28 février, à puis Paris et Nantes, pour de nouvelles éditions des événements O21 /S’orienter au 21e siècle. Des conférences et des rencontres inspirantes pour penser son avenir et trouver sa voie. Plus d’informations ici.
Etape de décalottage du verre, au Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers, à Vannes-le-Châtel (Meurthe-et-Moselle), le 11 février 2019. / Mathieu Cugnot / Divergence pour «Le Monde»
Sur cette terre industrielle de la Lorraine, les métiers d’art traversent les âges tant bien que mal. Oiseaux rares en voie de disparition, ils ont longtemps été synonymes de transmission familiale liée à l’histoire du territoire. Aujourd’hui, ils deviennent des métiers choisis.
Loin de l’image dégradée de l’apprenti de 14 ans, orienté contre son gré, faute d’avoir les notes permettant de poursuivre dans l’enseignement général, le profil de l’artisan d’art est plutôt celui d’un étudiant surmotivé qui multiplie les diplômes.
Diarville, à vingt kilomètres au sud de Nancy. Une discrète bâtisse grisâtre renferme l’un de ces savoir-faire d’excellence et d’exception : la broderie perlée et pailletée de l’entreprise familiale Vuillaume. Dès 1850, les « Lunévilleuses » y manient avec dextérité le crochet pour pratiquer le point de Lunéville, dont raffole la haute couture.
Fort de son succès, le fondateur Constant Vuillaume transmet cet héritage à son fils Louis, qui propose à la fois dentelle et broderie. Jean, le petit-fils, se spécialise dans les sacs à main finement brodés, qu’il exporte aux Etats-Unis. Juste après la guerre, les grandes maisons de couture font leur apparition : l’arrière-petit-fils, Xavier, commence à travailler pour les défilés. Voyant la broderie s’essouffler, Xavier pousse son fils Hubert à faire des études dans la finance. Mais, après un BTS banque et quelques années dans cette voie qu’il n’a pas choisie, le dernier de la lignée reprend à son tour le flambeau à la mort brutale de son père, en 2016.
Si le grand-père d’Hubert comptait plus de mille salariées dans son entreprise, et son père une centaine, Vuillaume n’emploie plus que six brodeuses à temps plein. Comme en 1850, les « filles » dessinent, piquent, poncent, brodent et assemblent dans un petit atelier où elles sont installées en ligne. Aujourd’hui « sous-sous-traitant », Hubert Vuillaume répond aux commandes d’importants ateliers de broderie parisiens, appartenant eux-mêmes à des grandes marques de luxe.
Urgence de la transmission
« Nous sommes plus fragiles, car dépendants des six défilés de mode de l’année. Nous devenons simples exécutants, et non plus créateurs du motif », regrette celui qui a grandi au milieu des boîtes d’échantillons, « nos trésors ». Malgré le déclin de l’activité, Hubert Vuillaume insiste sur l’urgence de la transmission du savoir-faire : trois de ses brodeuses, les meilleures et les plus anciennes, prendront leur retraite prochainement. « Je m’efforce de prendre des stagiaires régulièrement. Je vois mal le coin sans atelier de broderie… », affirme le directeur, tout juste trentenaire.
Evelyne Thouvenin accepte de lâcher les 1 200 strass d’un devant de jupe en tulle pour nous répondre dans la salle des dessins. « Tout a fermé, et nous, on est encore debout. C’est important que ça perdure. J’irai au bout, et même plus. On va me momifier ici ! », plaisante la chef d’atelier, 55 ans, qui fait le lien direct avec les clients et orchestre les commandes. Entrée chez Vuillaume en 1982 à la comptabilité, elle apprend la broderie sur le tas. « Au départ, ce n’était pas du tout mon truc et, finalement, j’ai gravi les échelons », résume-t-elle, fière d’avoir fait l’ensemble de sa carrière chez Vuillaume. En trente-sept ans de métier, les techniques ont évolué : « Ce n’est plus de la pose directe au crochet. L’aiguille intervient de plus en plus, détaille Evelyne Thouvenin. On fait des fleurs, on travaille le plastique, le raphia, le silicone… C’est moderne ! »
En stage à ses côtés, Lucile Garaut, 25 ans, en CAP broderie au lycée Paul-Lapie, à Lunéville : « J’ai choisi une entreprise comme celle-ci pour le geste, la technique, la rapidité. Je trouverais très triste que tout cela disparaisse. C’est trop précieux. » Après un diplôme de design aux Beaux-Arts de Nancy et une année de graphisme en free-lance, elle a hésité entre la plumasserie et la broderie. « Je veux apprendre et respecter une tradition, pour l’appliquer ensuite ailleurs et la mettre à fleur de l’objet. » L’étudiante a bâti tout son diplôme autour des techniques et des matériaux utilisés en haute couture, avec l’idée de les transposer au mobilier, en mêlant différents corps de métiers – par exemple travailler avec un marqueteur de paille sur un objet hors norme, tel un paravent brodé.
Lucile Garaut, 25 ans, stagiaire à la broderie Vuillaume, à Diarville (Meurthe-et-Moselle), le 11 février 2019. / Mathieu Cugnot / Divergence pour «Le Monde»
Le parcours de Lucile Garaut fait de moins en moins figure d’exception dans le domaine de l’artisanat d’art. Désormais, les filières s’alimentent avec davantage de CAP en une année, plus sélectifs, pour des jeunes déjà titulaires du baccalauréat qui ont la possibilité de poursuivre avec un BMA, un brevet des métiers d’art, puis le nouveau DNMADE, le diplôme national des métiers d’art et du design, qui a fait son apparition à la rentrée 2018.
« Il me semble difficile de réussir à s’exprimer aujourd’hui en tant qu’artisan d’art en ayant fait l’impasse sur la culture générale et la philosophie », assure Christophe de Lavenne, le référent « métiers d’art » pour la région Grand-Est, mission unique en son genre. Il estime que 60 % des personnes qui s’installent dans le secteur le font dans le cadre d’une reconversion.
Ainsi, dans une démarche d’introspection, jusqu’à l’ascèse de l’expression, les apprentis chercheraient à maîtriser l’ensemble d’un processus de fabrication pour pouvoir s’en détacher, l’adapter à un mode plus contemporain et créer leur propre signature. Le tout entraînant une atomisation de l’offre, avec, dans les deux tiers des cas, la création d’une « entreprise unipersonnelle, par vocation. Ce ne sont ni des autistes ni des égoïstes, indique le référent métiers d’art, mais des artistes qui ont besoin d’être libres pour exprimer leur créativité. »
En Meurthe-et-Moselle, terre sacrée des arts verriers, aucun jeune ne tente en effet de reproduire l’excellence des verres produits par les très prestigieuses usines Daum ou Baccarat, à l’origine de quelques grands noms de l’Art nouveau. Depuis les siècles derniers, les ouvriers se sont progressivement spécialisés : un verre en cristal représente le fruit du travail d’une bonne dizaine de personnes, chacune exécutant sa tâche avec une absolue perfection. Christophe de Lavenne : « Une personne seule ne peut rivaliser face à douze ouvriers élevés au plus haut rang. Et son travail ne vaudra jamais l’expérience des siècles ni l’effet de marque. »
Lorsque, au début des années 1980, la manufacture Daum perd une grande partie de ses effectifs, la population locale s’organise pour empêcher la disparition de savoir-faire intimement liés à son identité. Ainsi, à la sortie du village de Vannes-le-Châtel, à 400 mètres de l’usine, est née une plate-forme verrière qui a grandi petit à petit pour devenir l’imposant centre européen de recherches et de formation aux arts verriers (Cerfav).
Sous le statut d’association loi 1901, ce lieu hybride symbolise le grand écart permanent entre la technique et l’artistique, avec trois axes tournant autour de la formation, de la recherche et développement, et de la médiation culturelle. Trente-sept salariés permanents y travaillent, englobant toute la magie du verre, de l’atelier traditionnel de soufflage à celui du vitrail, jusqu’au « glass fab lab », labellisé pôle national d’innovation.
Bousculer les traditions
A 44 ans, Antonio Cos, Franco-Italien originaire de Strasbourg, y poursuit son CAP de créateur verrier après une première vie en tant que designer de produits dans une agence à Milan. « Deux années d’études, c’est juste un hors-d’œuvre. Dompter le verre représente le travail de toute une vie !, témoigne-t-il. Le côté historique, c’est un peu la cerise sur le gâteau, mais c’est aussi pesant, car les codes restent difficiles à bouger. Heureusement, le Cerfav réussit à créer un nouvel état d’esprit en acceptant des projets singuliers, qui bousculent des traditions centenaires. »
Installée au milieu de ce village de 580 habitants, parmi les chèvres et les moutons, Clémence Desbois, 23 ans, fait également partie de la trentaine d’apprentis créateurs verriers tombés dans la marmite. Elle a commencé par trois années aux Beaux-Arts de Brest (Finistère) et cherche sans cesse à mêler artisanat et monde de l’art : « Quand je discute avec les anciens de Vannes-le-Châtel, je sais que j’ai de la chance d’utiliser le verre pour mes créations artistiques. Pour eux, c’était un travail à la chaîne à l’usine. »
Tous revendiquent l’importance de mixer les populations dans un village où le verre constitue, depuis des siècles, et comme nulle part ailleurs, l’unique dénominateur commun. De la même façon, le politique revendique la volonté de faire des métiers d’art un possible ciment entre les territoires. Valérie Debord, vice-présidente de la région Grand-Est en charge de la formation et de l’emploi : « Notre nouvelle région est issue de trois anciennes régions administratives. Les métiers d’art permettent de raconter une histoire commune, de créer un sentiment d’appartenance : ils sont liés à une identité, un terroir, un savoir-faire qui a traversé les âges. »
A dix kilomètres de là, au bout d’une route plus dense en sangliers qu’en réseau 4G, cinq jeunes femmes, toutes passées par le Cerfav, ont bien compris que l’union fait la force. Elles ont entre 29 et 32 ans et ont monté Kaléidosco en 2016, un atelier de création verrière qui fonctionne sous forme de coopérative. La commune de Favières, 600 âmes au compteur, connue pour sa tradition de céramique, met à leur disposition les locaux de l’ancienne maison de la poterie.
« A cinq, nous cumulons toutes les qualifications liées aux différents métiers du verre. Nous gardons chacune du temps pour nos créations personnelles, tout en répondant à des projets communs pour des prescripteurs », explique l’une d’entre elles. Si certaines se disent plus artistes qu’artisans, Angèle Paris, après un passage par le vitrail, a finalement choisi le soufflage du verre : « J’aime cette intensité qu’il faut mettre à un moment très précis. Dans un milieu aride et tendu, on a une pièce qui bouge en permanence au bout de la canne. Il faut tout de suite donner le bon geste, car le verre le garde en mémoire. »
Fière d’être un « artisan de la lumière », capable d’éclaircir ou d’obscurcir son objet à l’envi, Angèle Paris souligne aussi l’exigence de son métier : « Etre souffleur, c’est tellement dur que ça fait ressortir de la rage. Moi, je voulais être dans l’artisanat parce que j’avais besoin de défis et de liberté. Contrairement aux générations précédentes, nos parents ne nous ont pas transmis le savoir-faire. On est seules au monde. Alors on mutualise les machines et l’énergie, on profite du réseau très fourni d’artisans d’art en Lorraine pour, à terme, essayer de se placer entre la grosse manufacture et l’artisan indépendant. Et, un jour, proposer des petites séries originales. »
Antoine Carbonare, luthier à l'Atelier Carbenare, à Mirecourt (Vosges), le 11 Février 2019. / Mathieu Cugnot/Divergence pour «Le Monde»
Aux antipodes du discours d’Angèle Paris, Antoine Carbonare perpétue un autre savoir-faire typique de la région, la lutherie. Lui est « fils de... » et ne s’en cache pas : « Je suis un vrai privilégié. Je n’ai pas hérité que de la technique de mon père, qui fabrique ses instruments depuis 1986. J’ai aussi la matière première, l’atelier, les outils… J’ai l’impression d’être un nain sur des épaules de géant ! » Installé à Mirecourt, dans les Vosges, l’artisan de 31 ans connaît bien l’histoire de cette ancienne cité ouvrière de luthiers, dont l’âge d’or a perduré jusqu’en 1930.
Après un bac ES, un bref passage en fac d’économie et une école de musiques actuelles à Nancy, Antoine Carbonare réalise qu’il a « la vocation à portée de main. Je voulais être guitariste professionnel, ou vivre de la musique de toute façon ». Il commence à travailler avec son père à 20 ans – fabriquant pour lui toutes ses têtes et ses ébauches d’instruments. « On n’apprend qu’en répétant ! J’ai eu la chance d’avoir un prof particulier à domicile, j’ai reçu une formation accélérée par rapport à mes amis qui sont passés par l’Ecole nationale de lutherie de Mirecourt », admet-il.
Depuis 2012, il signe ses propres violons, altos et violoncelles. A la différence des luthiers des villes, ce luthier des champs ne fait ni revente ni réparation. « A Mirecourt, on ne peut survivre qu’en étant fabricant, et moi, c’est ce que j’aime. Ici, il n’y a plus de clientèle pour l’entretien des instruments, les gens vont à Nancy. » Pour réaliser un alto ou un violon de qualité, Antoine Carbonare compte un minimum de six semaines de travail. Une goutte d’eau à l’échelle du temps lorrain des métiers d’art.
Retrouvez le programme de la journée de conférences O21 à Nancy