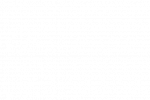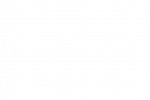Dans le sud algérien, Ouargla la contestataire

Dans le sud algérien, Ouargla la contestataire
Par Zahra Chenaoui (Ouargla (Algérie), envoyée spéciale)
Dans une région riche en hydrocarbures, la ville se sent oubliée par Alger. Sans infrastructures suffisantes ni perspectives d’avenir, les habitants sont en colère contre l’Etat, et le font savoir depuis mars 2013.
Dans le sud de l’Algérie, en avril 2016. / HABIB KAKI / CREATIVE COMMONS / CC-BY-SA-4.0
Le vent de sable les a malmenés, mais ils sont toujours là, suspendus entre les colonnes des tonnelles, flottant au-dessus des bancs désertés. De longs draps blancs barrés de slogans inscrits en lettres rouges. « Travailler est un droit », « Nous ne sommes pas la main de l’étranger, nous sommes des chômeurs souffrant de la marginalisation. » Présents dans le paysage depuis des semaines, les tissus sont devenus quasi invisibles pour les automobilistes bloqués dans les embouteillages ou l’agent de police chargé de la circulation.
Bienvenue à Ouargla. A 750 km d’Alger, la capitale du sud algérien a poussé au milieu du Sahara. Vers l’ouest, la route nationale 49 mène à Ghardaïa ; vers l’est, à Hassi Messaoud. Entre les deux, des dunes, des palmeraies, des petits lacs et des champs pétrolifères. La ville a beau être au cœur de la zone des hydrocarbures, qui constituent la principale ressource de l’Etat algérien, c’est une cité martyre du chômage, oubliée des services publics et des loisirs.
En 2017, elle comptait 130 000 habitants, dont 55 000 chômeurs inscrits à l’agence locale des demandeurs d’emploi. Pas étonnant que depuis mars 2013, elle soit devenue « Ouargla la contestataire », théâtre d’un des plus importants mouvements sociaux qu’ait connus le pays ces dernières années. Comme un prélude à la contestation qui secoue aujourd’hui l’Algérie, elle cristallise dans ses rues et ses maisons la frustration d’un pays potentiellement riche, qui aurait pu écrire son histoire autrement.
Une économie en berne
En 2013, Ouargla est l’une des rares villes à oser crier sa colère. Dans un pays où toute manifestation est systématiquement réprimée, la Coordination nationale de défense des droits des chômeurs (CNDDC) réussit le coup de force de rassembler des milliers de personnes dans le centre-ville, le 14 mars.
Prises de court, les autorités savent que la répression ne suffira pas à faire taire la colère et elles lancent une série de mesures pour lutter contre le fléau majeur : l’absence d’emplois. Prêts à taux zéro, ouverture d’un centre de formation professionnelle, amélioration de la transparence dans l’attribution des postes, préférence locale dans le recrutement… Toute la panoplie est déployée et « il y a eu des améliorations, reconnaît Tahar Belabbès, l’ancien leader de la CNDDC, même si le chômage n’a pas disparu ».
Si Ouargla s’est rapidement crispée, c’est parce que là, au milieu du Sahara, les champs d’hydrocarbures semblent narguer la pauvreté. La ville concentre un des grands reproches que font les Algériens à leur classe dirigeante : la mauvaise gestion de la manne pétrolière et les pansements bricolés sur une économie en berne.
Tahar Belabbès a certes été recruté par l’Entreprise nationale des services aux puits (ENSP) en 2014, après huit ans de chômage. Mais l’année suivante, il a été licencié après avoir créé un syndicat à l’intérieur de l’entreprise et après s’être mobilisé contre le gaz de schiste. Aujourd’hui, à 38 ans, son visage est fatigué. Il est obligé d’habiter avec sa mère et sa sœur et, pour vivre, la famille ne dispose que de 19 000 dinars par mois (environ 140 euros), tirés en grande partie de la pension de retraite du père, décédé.
L’ancien militant a bien monté un projet d’entreprise de sablage grâce à un dispositif de soutien à l’emploi pour les chômeurs de 30 à 50 ans, mais obtenir des chantiers est difficile. « La loi stipule que 20 % des projets publics doivent être attribués à des entreprises issues des dispositifs pour les chômeurs, mais en réalité les contrats vont à ceux qui sont proches de l’administration ou qui ont des relations », soupire-t-il.
Tahar est toujours prêt à militer. « Dès qu’on aura les noms des candidats à l’élection présidentielle, on leur enverra un communiqué », dit-il. Mais la CNDDC, elle aussi, a réduit ses activités : « Il y a eu des menaces, des pressions et des divisions au sein des leaders du mouvement », raconte le militant, qui reçoit ce jour-là une nouvelle convocation au tribunal pour « incitation au regroupement ». Malgré tout, Tahar Belabbès n’a aucun regret : « Notre mouvement a changé la manière dont les autorités regardent le Sud. »
Dynamisme de la jeunesse
La frustration est d’autant plus importante que la ville ne manque pas de compétences. Adel Amalou, 28 ans, fondateur d’IncubeMe, un incubateur d’entreprises privé d’Alger, a été contacté par le wali (« préfet ») de Ouargla, Abdelkader Djellaoui, il y a six mois. L’entrepreneur a expliqué qu’un incubateur doit être une structure dynamique et flexible. Alors les autorités ont décidé de soutenir une initiative privée dans la ville.
« Pour nous, un jeune de Ouargla était un jeune qui veut entrer dans une entreprise pétrolière. En réalité, on avait face à nous des jeunes très bien formés, anglophones, ouverts à l’international et avec des projets très techniques orientés vers les énergies renouvelables », se réjouit Adel Amalou, surpris par le dynamisme de la jeunesse locale. Convaincus qu’il y a à Ouargla un potentiel pour créer des entreprises innovantes, lui et son équipe s’apprêtent à lancer un appel à candidatures et ouvriront une antenne d’IncubeMe avant l’été 2019.
Créer de la richesse et du lien, c’est ce que les habitants espèrent le plus. Dans le stade municipal quasi vide, Ismaël, 23 ans, jeans, pull blanc et baskets Converse aux lacets jaunes, s’entraîne à la course, comme plusieurs fois par semaine. En journée, bien sûr, puisqu’il n’y a pas d’éclairage. C’est le sport et les réseaux sociaux qui ont changé la vie de cet étudiant en deuxième année de géologie. « C’est comme si je n’habitais pas à Ouargla, dit-il en riant. J’ai rencontré des gens formidables sur Instagram. On parle de santé, de sport, d’entraînement. Alors qu’ici, on n’a pas de loisirs. Le quotidien, c’est fac-maison-maison-fac, avec parfois quand même une sortie dans le Sahara. » Pour le sport, il y a juste le foot, un peu de basket ou de volley, mais les compétitions sont rares, « un semi-marathon dans l’année ». « A Ouargla, il est difficile de se développer personnellement, regrette Ismaël. Il faut un contact avec le nord du pays. Mes yeux se sont ouverts quand j’ai rencontré des gens qui vivent à Alger. »
Ismaël fait pourtant partie de la classe moyenne. Père ingénieur, mère au foyer, et sa sœur prépare un doctorat en architecture. Lui maîtrise l’anglais, grâce à l’ambassade des Etats-Unis qui a ouvert un centre de langue gratuit accessible à tous les étudiants de l’université de Ouargla. « Notre université est de bon niveau, il n’existe que cinq filières comme la nôtre [géologie pétrolière] dans le pays, nous avons des stages garantis à l’issue du cursus. » Et pourtant, répète-t-il, « pour mes enfants, je quitterai la ville, afin qu’ils aient de meilleures opportunités ».
Ouargla, dans le sud de l’Algérie, en janvier 2016. / HABIB KAKI /CREATIVE COMMONS / CC-BY-SA-4.0
« Deux poids, deux mesures »
Partir ou protester. C’est l’éternel dilemme. Début décembre 2018, dans trois quartiers, au sud et en périphérie de Ouargla, des chômeurs ont bloqué les routes en incendiant des pneus et immobilisé des camions-citernes. Les autorités venaient d’annoncer que 1 500 emplois allaient être ouverts au sein de la Sonatrach, l’entreprise nationale d’hydrocarbures. Les protestataires voulaient rappeler aux autorités qu’ils seraient « vigilants » quant aux conditions d’attribution des postes.
Avec le temps et l’expérience, la contestation évolue et milite désormais pour un développement global de Ouargla et de sa région. Une plate-forme de 47 revendications a été mise sur pied par le collectif Koulna Ouargla (« nous sommes tous Ouargla »).
« Nous avons essayé d’écrire aux autorités. Je suis allé à Alger pour informer les responsables. Ils n’écoutent pas. Alors on continuera comme ça pendant trois, quatre ans, et si ça ne marche pas on passera à autre chose », prévient Riad Souici, un militant de 33 ans employé à l’Entreprise nationale de forage (Enafor).
« Avant, j’étais contre les manifestations, explique-t-il. J’ai un diplôme, je préfère discuter. Mais Ahmed Ouyahia [le premier ministre] a dit que nous étions des émeutiers. Maintenant je vais dans la rue. Ce qu’on demande, ce sont nos droits, c’est le respect de la Constitution. On voit bien le deux poids, deux mesures avec les autres régions. » Le militant, figure de cette société civile dynamique et moderne, a du mal à cacher son amertume : « Ils disent que nous sommes égaux, mais ce n’est pas vrai. Où est l’argent du gaz et du pétrole ? S’il y avait une meilleure redistribution, Ouargla, ce serait comme Dubaï ! »
Services publics défaillants
Ce sentiment d’être oublié par Alger, Ismaël le ressent profondément depuis la mort de son neveu, le fils de sa sœur, après la pose d’implants auditifs réalisée à Alger. « Comme on est loin, il était suivi là bas seulement toutes les deux semaines. Il y a eu une erreur de diagnostic et il est décédé », explique-t-il dans un souffle.
C’est le secteur de la santé qui illustre sans doute le mieux le manque d’accès aux services publics. « Lorsque quelqu’un est gravement malade, les gens se cotisent pour l’envoyer à l’étranger, explique Riad Souici. Tous les jours, il y a des véhicules qui partent pour Tunis. Impossible d’avoir un rendez-vous à l’hôpital Mustapha-Pacha à Alger. Alors qu’en Tunisie, on paie et on a un rendez-vous sans problème. » Cheveux bruns courts, veste en cuir marron qui a déjà bien vécu, Riad Souici montre une vidéo Facebook Live montrant une salle de soins fermée : « Sans les réseaux sociaux, on ne nous écouterait pas », soupire-t-il.
En septembre 2018, c’est le décès d’une jeune universitaire piquée par un scorpion qui a provoqué un choc et relancé la mobilisation pour la construction du centre universitaire hospitalier (CHU). Le projet existait, mais il était gelé pour cause de chute des revenus pétroliers. La société civile a obtenu son déblocage. Pour l’instant, « le CHU le plus proche, c’est à Batna [à 500 km au nord]. L’été, pouvoir consulter un gynécologue relève du miracle. Quand ma femme accouche, si je veux qu’elle ait une chance de survivre en cas de problème, je l’emmène à Ghardaïa [à 190 km]. Dans le quartier, sept personnes sont décédées rien que du paludisme », explique Bachir Bousmaha, 38 ans, employé à l’ENSP.
Il reçoit chez lui, dans un salon décoré de tapis et meublé d’une table basse en bois. Sa maison n’est pas raccordée au réseau d’assainissement. Dans son quartier, il n’y a pas de route goudronnée, pas de transport scolaire, et la salle de soins est fermée. « Des enfants doivent faire presque 20 km pour aller à l’école. Et elle est tellement surchargée qu’ils font étudier la moitié des élèves de 8 heures à 11 heures et l’autre moitié de 12 heures à 15 heures. On a l’impression que nos parents vivaient mieux dans les années 1970 », regrette-t-il.
Un goût d’inachevé
Sur place, quand même, les mobilisations ont entraîné des améliorations. Même si, toujours, pointe derrière elles un petit goût d’inachevé. Dans le quartier de Haï Ennasr, à l’ouest de la ville, Houria, mère de deux enfants, sort plus tôt de son travail pour aller faire des courses dans le grand supermarché Acila qui a ouvert à l’autre bout de la ville, à une vingtaine de kilomètres. Dans ces immenses rayons où les familles se pressent, elle vient chercher des « produits de qualité » : du bon café et du fromage en promotion. « Avant, il fallait faire 80 km pour avoir ces produits-là », explique-t-elle, contente « d’avoir un peu plus le choix ». Au quotidien, elle fait ses courses chez le grossiste, mais « les légumes sont tous à plus de 100 dinars [0,70 euro] le kilo, alors je fais attention. »
Elle et son mari, cadre dans l’administration, ont acheté un terrain et fait construire leur maison. Le chantier n’est pas terminé. En attendant, ils vivent au rez-de-chaussée. Dans le salon, un immense écran de télévision, un congélateur, un tapis de course et une grande fontaine d’eau minérale. A Ouargla, l’eau courante est salée et, à terme, dangereuse pour la santé. Pendant des années, les autorités ont promis des stations de déminéralisation. « Quand elles ont enfin été mises en place, elles n’avaient pas la capacité d’alimenter le réseau 24 heures sur 24, explique Houria. Alors les habitants ont dit : on préfère avoir de l’eau toute la journée, redonnez-nous l’eau salée. »
L’autre symbole de ces projets qui pourraient changer la vie s’ils étaient mieux pensés, c’est le tramway. Un bel investissement, adapté aux conditions climatiques du Sahara. Le projet, d’un budget de 40 milliards de dinars, réalisé par un groupe espagnol et exploité par le français Alstom, a été inauguré le 28 mars 2018. Mais là encore, comme pour l’eau, il manque un maillon – et ça agace. Comme si le citoyen du Sahara était de seconde zone, son réseau de tramway est moins long qu’ailleurs. « Les autres lignes du pays, à Alger, Oran, Constantine, Sidi Bel Abbès et Sétif, dépassent les quinze kilomètres, tandis que la ligne de Ouargla en fait un peu moins de dix », se plaint un passager. « Il ne traverse même pas toute la ville », déplore un autre, qui a la malchance d’habiter un quartier non desservi.
Le tramway de Ouargla, en décembre 2018. / ACHMDRD / CREATIVE COMMONS / CC BY-SA-4.0
Sentiment d’injustice
De toute façon, la liste des lieux où aller n’est pas bien longue. D’abord, il y a un seul marché, celui du ksar, la vieille ville, où, comme dans le quartier historique de la Casbah d’Alger, les habitations s’écroulent, faute d’entretien. Pas la peine de miser sur le cinéma Sedrata, qui est en rénovation, les grosses lettres rouges de sa façade décrochées. Une salle de 800 places devrait ouvrir « prochainement », dit-on.
Tout ce qu’il reste ici à réaliser continue de nourrir la fibre combattante de Ouargla. Depuis 2013, elle est régulièrement secouée par les protestations des chômeurs, parfois radicales. En 2016, certains se sont mutilés et cousu les lèvres face au bâtiment de la wilaya (« préfecture »). La même année, un vaste mouvement de contestation a défilé dans les rues pour s’opposer à l’augmentation des tarifs de l’électricité.
Au cœur du Sahara, la plainte domine dans cette ville qui n’en finit pas de souffrir de son isolement. Certes, le manque d’infrastructures et de perspectives est assez semblable à celui de nombreuses villes du nord, mais l’éloignement et les conditions climatiques extrêmes aggravent le sentiment d’injustice. Terre de paradoxe avec son or noir juste là, dessous. Mais de cette richesse, les Ouarglis ne voient pas vraiment la couleur.