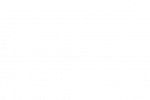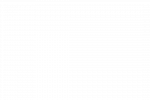La musique des séries, entre emprunts et sur-mesure

La musique des séries, entre emprunts et sur-mesure
Par Renaud Machart
Les séries sont souvent habillées d’un fond sonore très formaté. Pourtant, certaines sortent du lot en offrant aux bandes-son un rôle à part entière. Quelques exemples à l’occasion du festival Séries mania, qui se tient à Lille du 22 au 30 mars.
Jude Law incarne le pape Lenny Belardo dans « The Young Pope » (Canal+), de Paolo Sorrentino, avec, en fond sonore, du Arvo Pärt, du John Tavener et du John Adams. / CANAL+
Comme les films de cinéma, les séries utilisent la musique selon deux grands principes : l’emprunt à des répertoires et œuvres préexistants (chansons, jazz, pop, morceaux classiques, etc.) ou la commande d’une bande-son originale à un ou plusieurs compositeurs. Ces deux principes ne sont d’ailleurs pas forcément exclusifs l’un de l’autre.
Au chapitre des emprunts, nombreuses sont les séries à citer des chansons, qui donnent une couleur d’époque – celles, par exemple, de la chanteuse de jazz Blossom Dearie dans The Marvelous Mrs. Maisel (2017-2018), d’Amy Sherman-Palladino – ou soulignent une situation, par le sens des paroles ou par le climat musical – entre autres, dans Better Things (2016-2019), de Pamela Adlon.
Le cinéaste Paolo Sorrentino, à l’oreille très musicale, use de chansons populaires et de pop music. Et témoigne d’une étonnante culture en matière de musique savante contemporaine néotonale et consonante. Dans sa série The Young Pope (2016), le finale du quatrième Quatuor à cordes du Letton Pēteris Vasks revient dans plusieurs épisodes comme un leitmotiv désolé. On entend aussi du Arvo Pärt, du John Tavener, mais il faut surtout distinguer le final de la série, au moment où le jeune pape (Jude Law), décide de montrer pour la première fois son visage en public. Sorrentino accompagne cette longue scène – treize minutes – de la quasi-intégralité de l’envoûtante élégie avec guitare électrique de John Adams, « Mother of the Man », extraite de Naive and Sentimental Music (1999).
Emprunts et citations
Il est très rare qu’on entende une aussi longue citation dans le cadre d’une série, et il est plus étonnant encore qu’elle donne l’impression que les images ont été conçues pour l’accompagner plutôt que l’inverse. Dans American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace (2018), de Ryan Murphy et Brad Falchuk, le premier épisode fait entendre, dans son intégralité, l’Adagio d’Albinoni.
Cette scie musicale, qu’on prend pour un original du compositeur baroque alors qu’elle est un faux inventé en 1958 par le musicologue Remo Giazotto, occupe les sept premières minutes du prologue. Mais sa présence fait mieux que souligner l’italianité du couturier et les circonstances tragiques de sa mort : par ce choix, Murphy et ses conseillers musicaux moquent subtilement l’univers clinquant et facticement antique de la villa du couturier à Miami, en Floride.
Un cas très singulier d’emprunt a été illustré par Homecoming (2018), d’Eli Horowitz et Micah Bloomberg (la série fera l’objet d’une séance spéciale lors de Séries mania, les 25 et 28 mars). L’habillage sonore est entièrement fait de musiques de films parfois très connues. La couture des divers morceaux est remarquable même si, parfois, les musiques sont fortement connotées par les films dont elles proviennent.
A mi-chemin de l’emprunt et d’une musique fraîchement composée, David Buckley fait, pour le générique de The Good Fight (2017-2018), créée par Robert et Michelle King et Phil Alden Robinson, un subtil arrangement d’un intermède instrumental extrait de l’opéra Orfeo (1607), de Claudio Monteverdi.
Ce grand crescendo – sur fond d’images d’explosions – sert de souche aux pastilles musicales qui vont faire office de fond sonore ou ponctuer l’action. Déjà inventive par ses nombreux pastiches, dans The Good Wife (2009-2016) – dont The Good Fight est le spin-off (« série dérivée ») –, la partition de David Buckley monte ici d’un cran le jeu des emprunts et citations.
Un vrai personnage sonore
Au chapitre des partitions commandées spécialement, on pourra citer celle conçue par Mark Isham – dans un style minimal et élégiaque, qui la situe entre Philip Glass et Henryk Gorecki – pour la remarquable série anthologique American Crime (2015-2017), de John Ridley. Elle est d’une discrétion et d’une finesse qui participent à la beauté, parfois esthétisante et silencieuse, de cette trilogie au ton sociopolitique.
David Lynch, musicien lui-même, fait, dans Twin Peaks (1990-1991 et 2017), du concert sur la scène du Bang Bang Bar un rituel musical presque déconnecté du reste de l’action – colorée par le synthétiseur d’Angelo Badalamenti qui, par son humeur de profonde angoisse, donne des sueurs froides à l’oreille. Dans Empire (2015-2019), de Lee Daniels et Danny Strong, des interprètes de la série fournissent et interprètent aussi des musiques originales.
L’un des plus singuliers exemples de musique dont on peut dire quelle incarne un vrai personnage sonore, taillé sur mesure, qui se présente et se développe de diverses manières, est celle de la délicate et poétique série australienne Please Like Me (2013-2016), créée par Josh Thomas. Elle est signée par la compositrice australienne Bryony Marks et fait l’usage d’une multitude d’emprunts stylistiques. Ceux-ci vont de la langueur mélancolique d’Erik Satie au rythme pulsé de la musique pop, en passant par une danse populaire revisitée. Mais un moment tranche nettement avec le reste de la partition de Bryony Marks : on entend, d’abord sous la forme d’une musique d’attente téléphonique, un duo de voix d’alto qui, au fil de ses métamorphoses entre styles néobaroque, alla Rossini, et postmoderne, va se glisser subrepticement dans les interstices du récit.
Le génie singulier de ce cas assez unique – à notre connaissance – est qu’il n’agit pas comme une illustration directe, une pastille intercalaire, un exhausteur d’atmosphère ou une redondance expressive, mais qu’il semble suivre son cheminement propre d’une manière subtilement irrésistible, bien dans le ton fantasque mais maîtrisé de la série de Josh Thomas.
Cet article fait partie d’un dossier réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le festival Séries mania, du 22 au 30 mars à Lille. Seriesmania.com