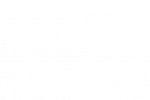« Il est illusoire d’envisager une dépolitisation immédiate de l’armée en Algérie»

« Il est illusoire d’envisager une dépolitisation immédiate de l’armée en Algérie»
Propos recueillis par Frédéric Bobin (Tunis, correspondant)
Sans la pression populaire, l’armée n’aurait jamais brisé l’alliance qui la liait à Bouteflika, rappelle la chercheuse Louisa Dris-Aït Hamadouche.
Que retenir des vingt ans de règne d’Abdelaziz Bouteflika ?
Durée : 05:06
Louisa Dris-Aït Hamadouche est maître de conférences à la faculté de sciences politiques et de relations internationales d’Alger 3. Ses recherches portent sur le système politique algérien et la place de l’Algérie dans son environnement régional.
La démission du président Abdelaziz Bouteflika, le 2 avril, a été précipitée par l’armée. Comment voyez-vous le rôle de l’armée dans la nouvelle séquence qui s’ouvre en Algérie ?
Louisa Dris-Aït Hamadouche Il faut commencer par rappeler que l’armée ne s’est en fait jamais désengagée du système politique algérien. Les différentes élections et réélections du président Bouteflika ont été obtenues principalement grâce au soutien de l’une ou de l’autre des structures de l’institution militaire. L’intervention du 2 avril n’est donc pas inédite. Si vous regardez la façon dont les différents présidents algériens ont quitté le pouvoir depuis 1962, hormis ceux qui sont décédés [Houari Boumédiène en 1978 et Mohamed Boudiaf, assassiné en 1992], tous ont terminé leur mandat en raison d’une intervention directe du chef d’état-major [Ahmed Ben Bella en 1965, Chadli Bendjedid en 1992 et Liamine Zeroual en 1998]. On est donc dans une logique structurelle. Mais la différence importante dans la situation actuelle, c’est le rôle de la contestation populaire. C’est la première fois que la population est à l’origine d’une décision de l’état-major contre un président.
Ce rôle de l’armée dans l’éviction de Bouteflika est-il un cadeau empoisonné pour la contestation ?
Pour le moment, je n’ai pas l’impression que la population considère qu’il s’agisse d’ un « cadeau ». Il y a un surtout un sentiment de satisfaction, de fierté même, d’avoir obtenu un résultat totalement inédit. Ceci dit, il est vrai que M. Bouteflika n’aurait pas démissionné si une fracture ne s’était pas ouverte entre lui et le chef d’état-major. Il y a donc eu un rôle prépondérant de l’armée.
Comment peut évoluer ce rôle de l’armée ces prochains mois ?
Il y a deux scénarios. Le premier consiste dans l’application des procédures prévues par l’article 102 de la Constitution [relatif à l’empêchement ou à la démission du chef de l’Etat], avec le président du Conseil de la nation [Sénat] assurant l’intérim pendant trois mois, le temps d’organiser de nouvelles élections. C’est un scénario bien huilé, parfaitement constitutionnel. Je doute toutefois qu’il réponde aux aspirations de la population, dans la mesure où c’est la meilleure façon de garantir l’absence de changement profond du système politique. Dans ce cas de figure, l’institution militaire continuera d’être un acteur fondamental dans la vie politique, même si ce rôle n’est pas joué de façon apparente. On peut imaginer un retrait de la scène du chef d’état-major, sans pour autant que son influence recule.
L’autre scénario, qui est tout aussi possible, serait que la contestation et des partis politiques en appellent à une transition remettant en cause les procédures prévues par l’article 102. On serait alors dans une logique totalement différente. Il pourrait y avoir la nomination d’un collège présidentiel constitué de personnalités faisant consensus au sein de la population, ainsi que celle d’un gouvernement réellement technocratique dont les membres n’auraient pas pris part aux différents gouvernements désignés par Bouteflika.
On évoque aussi une très forte possibilité de réformer la Constitution, parce que l’actuelle loi fondamentale, telle qu’elle a été révisée en 2016, établit un régime présidentialiste qui ne fait pas du tout consensus, bien au contraire. Il y a une forte demande de revoir les équilibres de pouvoir. Les magistrats se sont aussi mobilisés dans la contestation pour une réforme de la justice. On est donc face à des demandes très précises, mais qui demanderont du temps pour être satisfaites. Ce scénario serait celui d’une transition pactée, négociée, qui prévoirait le retrait progressif des tenants du pouvoir actuel en échange d’une véritable dépolitisation de l’armée in fine.
Un manifestant demande le départ du chef d’état-major de l’armée algérienne, à ALger, le 29 mars 2019. / RYAD KRAMDI / AFP
Comment l’armée est-elle perçue par la population ?
Le comportement de l’ensemble des forces de sécurité – l’armée, la gendarmerie et la police – a été marqué par le professionnalisme durant la contestation. De toutes les institutions existantes, les institutions sécuritaires, et plus particulièrement l’armée, font partie des structures dans lesquelles les Algériens ont le plus confiance. Ils ont même plus confiance en l’Armée nationale populaire (ANP) que dans le Parlement, les partis politiques ou la justice. Et puis il y a aussi cette idée que l’ANP demeure une armée de conscription, proche de la population. Bien sûr, cela ne signifie en aucun cas que la population se sente proche de sa hiérarchie. Durant les différentes manifestations du vendredi, les slogans lancés exprimaient une « fraternité » entre la population et l’armée. Par contre, son chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah, a, lui, été souvent critiqué. Dans la conscience collective des Algériens, il y a donc une vraie différence entre l’armée en tant qu’institution et sa hiérarchie en tant que partie prenante du pouvoir politique.
Jusqu’à quel point l’armée peut-elle faire droit aux revendications du mouvement populaire de tourner la page du « système », dans la mesure où sa hiérarchie en est partie prenante ? N’y a-t-il pas là une contradiction en germe ?
C’est pour cela que je parlais d’une transition négociée. Effectivement, il serait illusoire d’envisager un retrait immédiat et total de l’armée de la sphère politique, une dépolitisation immédiate de la hiérarchie militaire algérienne. Je pense que cette dépolitisation peut se faire de façon progressive, de façon négociée, de façon à rassurer les différents protagonistes. Quoi qu’il en soit, ce que l’Algérie vient de vivre ces dernières semaines ne peut pas ne pas laisser de traces. Sans la pression populaire, le chef d’état-major n’aurait jamais lâché, il n’aurait jamais brisé l’alliance qui le liait au président. Il ne l’a pas fait parce qu’il avait le choix, mais parce qu’il sentait qu’il n’avait plus le choix. Même si la transition peut s’avérer difficile, il y a quand même un tournant. Il y a un « avant » et un « après » 2 avril en Algérie.
RAMZI BOUDINA / REUTERS
Le mouvement de contestation a jusqu’à présent refusé de se structurer sur un mode vertical. Est-ce durable ?
Jusqu’au 2 avril, il n’avait obtenu aucune concession concrète de la part du pouvoir politique. Les animateurs du mouvement n’avaient donc pas jugé utile de passer à une forme de représentation. Aujourd’hui, la logique est différente. Va-t-on assister à l’accélération de la représentation du mouvement ? Je pense que c’est inévitable, à un moment ou à un autre, d’autant plus si, pour une raison ou une autre, les Algériens sont poussés à des élections rapides.
Mais il y a pour l’instant, j’ai l’impression, une véritable phobie quant à l’émergence d’une représentation. Elle a des raisons assez objectives. Ces vingt dernières années, le pouvoir politique a su, à de très nombreuses reprises, récupérer les leaderships de différentes contestations. Cela a été le cas en Kabylie en 2001 : le mouvement s’est terminé parce que le pouvoir politique a réussi à coopter le leadership. Aujourd’hui, la crainte est que des représentants du mouvement ne soient pas assez solides face aux pressions ou aux tentatives de récupération venant du pouvoir politique.
Enfin, dernier élément, historique : il y a en Algérie un vrai problème avec le leadership. Ça remonte à très loin, au mouvement national, à l’indépendance. De tout temps, il y a eu une espèce de schizophrénie, en tout cas un vrai malaise, entre la nécessité d’une direction et le refus du « zaïmisme », c’est-à-dire l’émergence d’un zaïm [chef].
Des millions d’Algériens sont descendus dans la rue depuis le 22 février. Certains parlent d’une nouvelle « indépendance » et font un parallèle avec 1962. L’analogie est-elle fondée ?
Ce sont les personnes qui ont vécu les deux événements, 1962 et 2019, qui évoquent le mouvement populaire en ces termes. A mon sens, le point commun entre les deux événements, c’est la dignité. L’indépendance, c’est le recouvrement de la liberté, de la souveraineté, mais c’est aussi et surtout, pour la population, le recouvrement de sa dignité. Or durant les dernières années de Bouteflika, c’est précisément dans leur dignité que les Algériens ont été le plus meurtris. Les images du président malade diffusées sur les chaînes algériennes ou étrangères ont eu un impact très violent sur la psyché des Algériens. Je n’ai pas ressenti cela par rapport à la violence des années 1990 ou la répression de 1988. Jamais les Algériens n’ont évoqué leur dignité comme ces dernières années. Je pense que la comparaison avec l’indépendance vient de là.
Notre sélection d’articles pour comprendre la contestation en Algérie
La démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika, le 2 avril, est une humiliante capitulation face à une population en révolte depuis la fin février. Le mouvement de protestation le plus important des deux dernières décennies en Algérie a poussé des dizaines de milliers de personnes dans les rues pour exprimer leur opposition à un cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika.
Retrouvez ci-dessous les contenus de référence publiés par Le Monde pour comprendre la crise que traverse le pays :
- Les six semaines qui ont ébranlé l’Algérie : pour les Algériens, l’annonce de la démission de Bouteflika n’est qu’une étape
- Les mille et une vies d’Abdelaziz Bouteflika : celui qui a passé vingt années à la tête de l’Algérie a fait toute sa carrière dans les sphères du pouvoir
- Quelle opposition à Bouteflika ? Tour d’horizon des formations politiques qui contestent le maintien au pouvoir du président algérien
- La tribune de l’écrivain Kamel Daoud : « En Algérie, l’humiliation de trop »
Suivez toute l’actualité de l’Algérie dans notre rubrique spéciale ainsi qu’avec l’édition WhatsApp du « Monde Afrique ».