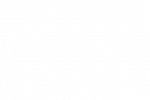« Ray & Liz » : la folie intérieure du « Pays noir » , cité ouvrière près de Birmingham

« Ray & Liz » : la folie intérieure du « Pays noir » , cité ouvrière près de Birmingham
Par Mathieu Macheret
Pour son premier long-métrage, le photographe Richard Billingham met en scène ses parents, Raymond et Elizabeth, dans une étrange fiction sous forme de sketches.
Richard Billingham s’est fait connaître depuis la fin des années 1990 pour ses photographies controversées, décrivant crûment les frasques quotidiennes de sa propre famille, prolétaires dans le besoin de Cradley Heath, cité ouvrière du « Pays noir » à proximité de Birmingham, dans les Midlands. Son père Raymond, ivrogne, et sa mère Elizabeth, matrone fumant cigarette sur cigarette, en étaient les personnages récurrents, photographiés dans leur intérieur décati et dans des postures rarement flatteuses. Ces séries brutes et féroces n’en ont pas moins constitué un document de première main sur les années du gouvernement de Margaret Thatcher et ses effets concrets sur les conditions de vie des classes les plus défavorisées.
Pour son premier long-métrage, Billingham met en scène les mêmes personnages, cette fois incarnés par des acteurs, dans le cadre d’une étrange fiction relatant quelques bribes de vie sous forme de sketches. Au début du film, Ray, alors vieil homme, regarde les mouches voler dans son petit appartement crasseux, où il passe ses journées seul, à boire et à se remémorer le passé des années 1980, quand il vivait auprès de Liz et de leurs deux enfants.
Par deux fois, Jason, leur benjamin, s’est retrouvé en mauvaise posture : une fois confié à la surveillance faillible d’un oncle simplet ; une seconde fois contraint à passer une nuit dehors, dans un cabanon de jardin. Episodes d’une négligence aussi terrible que banale, venant de personnes que le chômage et des indemnités au compte-gouttes réduisent à une misère sordide, les rendant oublieux de tout le reste.
Regard à la fois tendre et cruel
En ne dissimulant rien des errements de ses parents, Billingham pose sur eux un regard paradoxal, à la fois tendre et cruel, aimant et impitoyable, qui lui permet d’approcher l’âpreté même de l’indigence sociale, sans avoir à verser dans les écueils répandus du misérabilisme ou de l’édulcoration. Si le film perturbe avant d’émouvoir, c’est parce qu’il orchestre d’abord les absences à répétition des parents, avant de les retrouver à chaque histoire plus démunis.
Frappe surtout la façon dont Billingham s’intéresse aux « intérieurs », dans un sens domestique tout autant qu’intime : les demeures successives de Ray et Liz, maison et appartements, se composent comme des mondes en soi, refermés sur eux-mêmes, ouvrant sur un chaos de détails qui traduit aussi la folie des parents. Mondes de bibelots poussiéreux, d’objets de récupération, de papiers peints lépreux, de mégots écrasés, de matières souvent viles, mais aussi d’animaux et d’insectes, sans que le décompte en soit jamais sinistre – mais d’une poésie noire.
Les quelques virées de Jason au-dehors dévoilent un pays sombre et brumeux, semé de tristes bâtisses, de friches où tout semble petit à petit regagné par la végétation. L’intérieur et l’extérieur se renvoient la balle d’une même claustration, dessinant un monde uniformément froid, face auquel la seule réponse possible n’est peut-être que la folie douce et autodestructrice qui unit Ray et Liz. C’est cette folie-là, dans sa pulsation branque et syncopée, que Billingham ne cesse de scruter, les blessures de l’âme se reflétant partout et à chaque instant dans le grand délabrement de leur univers matériel.
Film anglais de Richard Billingham. Avec Ella Smith, Justin Salinger, Patrick Romer, Deirdre Kelly (1 h 48). Sur le Web : www.potemkine.fr/Potemkine-film/Ray-liz-ray-liz/pa61m4f354.html