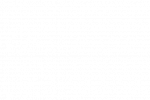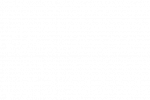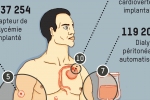« J’ai longtemps eu honte de mon manque de culture »
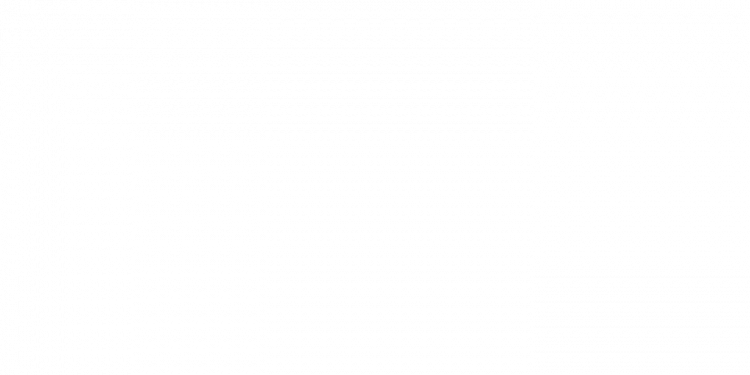
« J’ai longtemps eu honte de mon manque de culture »
Par Adrien Naselli
Face à des jeunes issus de milieux bien plus favorisés que le sien, Abdelilah Laloui, étudiant à Sciences Po, s’est senti complexé par son « manque de bagage culturel ». Il a créé une association pour donner des clés aux jeunes qui ressentent ce « malaise ».
Quand j’étais en classe de seconde au lycée Gutenberg de Créteil (Val-de-Marne), je n’avais qu’un projet : devenir frigoriste, comme mon père. Ma mère, elle, était à la maison, dans notre petit pavillon. J’avais des résultats scolaires plutôt bons, et mes profs m’ont poussé dès la seconde à intégrer une grande école. Mais j’étais persuadé que les grandes écoles, c’était pour les gens cultivés, pas pour moi.
En classe de première, je suis tombé sur une interview d’Amélie Nothomb à la télévision. Elle parlait des lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke comme d’un livre qui avait « changé sa vie ». Je me suis demandé : « C’est quoi ce concept ? Comment un truc entassé sur une étagère peut-il changer une vie ? Est-ce qu’il y a un truc magique dans ce bouquin ? » Alors, j’ai eu la curiosité d’aller chercher le livre au CDI. Je l’ouvre et là, grosse claque : je ne comprends rien du tout. J’ai demandé conseil à mon prof de français qui m’a dit de chercher les mots que je ne comprenais pas dans le dictionnaire. Je sentais, en tout cas, qu’il y avait là un discours que je n’avais jamais entendu. Rilke dit au « jeune poète » : on s’en fiche de mon avis, ce qui compte, c’est ce que tu as au fond de toi.
« Vous n’avez pas de bagage culturel »
Quand j’ai intégré le programme d’aide aux concours de Sciences Po avec une dizaine de lycéens, ça a été un nouveau choc. Je me suis dit que je n’étais pas cultivé, comme mec. Je me sentais totalement illégitime, incapable, bête. Nos profs nous ont dit : « vous n’avez pas de bagage culturel, on va remédier à cela. » C’était étrange comme programme. Mais je m’y suis attelé. Pour acquérir cette « culture », j’ai lu énormément de bouquins, à l’école mais aussi pour moi, dans ma chambre. J’étais fasciné par tout ce que je lisais : Flaubert, Camus, Yasmina Khadra, Philippe Sollers… J’ai aussi énormément écouté de musique. Tous les styles, mais surtout la musique classique. Elle me touche énormément. Pendant la période du bac, j’allais très mal et le classique a toujours été une délivrance pour moi.
Ces nouvelles expériences culturelles m’ont donné envie d’agir pour tous ces mecs et ces filles de banlieue qui me ressemblaient, et qui se moquaient totalement de tout ça. Avec ma meilleure amie, Alia Ismail, nous avons créé une association en 2017. L’idée était simple : désacraliser le rapport des jeunes à la culture et se l’approprier sans avoir honte de quoi que ce soit. Lors des séances, un élève partage son coup de cœur et nous, les bénévoles, on est là pour les faire réfléchir et les décomplexer.
En intégrant Sciences Po, j’ai reçu une nouvelle claque en m’inscrivant à un cours d’opéra. J’étais complètement largué, contrairement à beaucoup de mes camarades. Moi qui pensais m’y connaître un peu, la réalité m’a rattrapé. Forcément, je n’avais jamais joué d’un instrument, jamais vu de concert. A Sciences Po, j’ai parfois mal vécu la confrontation avec les élèves issus de milieux plus favorisés. En première année, j’ai eu souvent honte de mon manque de bagage culturel, à cause de certains qui l’étalaient. Quand tu arrives à Saint-Germain-des-Prés, tu te rends compte que des tas de gens vont au cinéma, voyagent et lisent depuis tout petits… Je suis passé d’un quasi-désert culturel à une montagne de culture. C’est une sensation qui m’a presque conduit à arrêter.
Imposer la « culture légitime » ?
Un jour, j’ai eu une dispute assez sévère avec des camarades : on me reprochait « d’imposer la culture légitime » aux jeunes des quartiers avec mon association. J’étais furieux. Eux sont dans leur bulle depuis toujours, ils peuvent se permettre de jongler d’une forme de culture à une autre avec détachement, s’en moquer, mélanger les références. Et ensuite, ils viennent dire à un mec de banlieue qui veut aider des gens comme lui d’imposer une culture. J’ai trouvé ce discours très dangereux. Ils n’ont pas conscience de l’autocensure sociale, de la honte que peuvent ressentir les gens. Me taxer de paternalisme, ça m’a blessé.
Les rapports avec ma famille sont complexes. Par gêne, on va se moquer de moi gentiment. On prend, par exemple, un air pompeux en disant que j’écoute France Culture, que je regarde Arte. Avant d’aller à Sciences Po, j’avais exactement cette attitude : je me moquais de la culture légitime. Cela traduisait un malaise social, qu’on peut facilement comprendre. Lorsque quelque chose nous dépasse, on ironise, on prend le dessus comme ça.
Aujourd’hui, je suis en deuxième année à Sciences Po. Je n’ai toujours pas l’impression d’être « cultivé ». Je déteste ce mot, qui renvoie à une accumulation de savoirs. J’utilise les termes « curieux », « passionné ». Mais aujourd’hui, quand je me retrouve face à une œuvre que je ne connais pas, je ne rougis plus. Le fantasme du gars supercultivé qui sait tout sur tout, je ne l’ai plus.
L’association, rebaptisée « Tous Curieux », fonctionne très bien. Nous avons une centaine de bénévoles et cinq antennes (l’école du Louvre, la Sorbonne, Sciences Po, L’UPEC et l’Institut de mode français). Nous avons même des parrains et marraines, que je suis allé solliciter, comme Jack Lang ou Sandrine Treiner, la directrice de France Culture. Nous intervenons dans des collèges en zone d’éducation prioritaire sur le théâtre, la littérature, le cinéma, la musique… Pour l’instant, nous sommes en contact avec 400 élèves. En référence à mon déclic, un atelier s’appelle : « Un livre peut-il changer une vie ? »