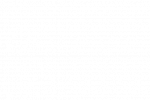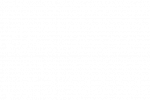Pour augmenter leurs effectifs, les écoles d’ingénieurs en quête de nouveaux leviers

Pour augmenter leurs effectifs, les écoles d’ingénieurs en quête de nouveaux leviers
Par Eric Nunès
Hausse des frais de scolarité, apprentissage et réforme du baccalauréat sont les trois pistes explorées par les établissements.
Dans l’atelier de l’Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile. / Eric Nunès / Le Monde
Les directeurs des écoles d’ingénieurs français ne sont pas des Cassandre. Pourtant, depuis près d’une décennie, ils ont signalé, rappelé puis alerté sur le déficit chronique d’ingénieurs dont souffre l’économie française. La fédération des syndicats spécialisés dans les professions de l’ingénierie (Syntec) et l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) estiment que l’économie française a besoin de 50 000 nouveaux diplômés ingénieurs par an. Or, les écoles françaises en forment 33 000, selon la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI).
« Chaque année qui passe, le trou se creuse », constate Jacques Fayolle, président de la CDEFI et directeur de Télécom Saint-Etienne. Pourtant, les écoles poussent les murs : entre 2009 et 2016, l’ensemble des établissements ont lancé leurs machines à former à plein régime pour obtenir une hausse de 18,6 % des diplômés. Ce sont les écoles privées qui répondent le plus vite à la demande avec une hausse de 31,1 % sur la même période.
Cette boulimie de nouveaux ingénieurs est corrélée aux multiples mutations liées au numérique. « La transformation digitale apporte un énorme bouleversement, analyse Christophe Baujault, directeur de l’école d’ingénieurs ECE Paris. Il faut appréhender dans la majorité des secteurs industriels traditionnels une rupture technologique ainsi qu’un changement radical de modèle économique. » Le secteur automobile, où la France conserve plusieurs de ses fleurons, en est un exemple.
Alors que les constructeurs vendent, depuis un siècle, des véhicules individuels dotés d’un moteur à explosion, la route intelligente de demain pourrait n’être fréquentée que par des véhicules électriques et partagés. Les voitures ? Plutôt des « smartphones sur roues qui vous déplacent d’un point A à un point B en proposant des services embarqués », résume M. Baujault. Une révolution à mettre en marche pour laquelle les industriels ont besoin, à très haute dose, d’experts en énergie, intelligence artificielle, développement informatique, cybersécurité…
Et ce, dans un marché mondialisé sur lequel les ingénieurs « fabriqués en France » s’exportent bien. Selon l’enquête annuelle de la société des ingénieurs et scientifiques de France (IESF), en 2018, 133 000 jeunes ingénieurs français travaillaient à l’étranger et près de 18 % des moins de 30 ans font le choix de l’expatriation dans les premières années qui suivent leur sortie d’école. L’urgence à former s’aiguise encore.
Privé, public : deux modèles
Pour former les ingénieurs de demain, la France s’appuie sur trois types d’écoles : 112 établissements qui dépendent du ministère de l’enseignement supérieur et qui fournissent près de 19 000 diplômés par an, 35 qui sont sous la tutelle d’un autre ministère, comme celui des armées, et, enfin, 54 privés.
En 2016, les établissements privés ont diplômé 9 092 étudiants, soit 2 156 de plus qu’en 2009 : la plus grosse progression. « Nous avons, entre 2012 et 2017, fait progresser notre offre de formation de 65 % », s’enorgueillit Jean-Louis Allard, directeur du CESI, une école d’ingénieurs privée. La raison est simple : ces écoles, dont le modèle économique dépend essentiellement des frais de scolarité payés par les familles, peuvent augmenter la voilure bien plus facilement que les écoles publiques, financées par l’Etat. Et comme la demande suit…
« Nous sommes maîtres de notre modèle économique, dit Jean-Louis Allard pour expliquer cette réactivité. Notre processus de décision est rapide et nous ne sommes pas contraints par un financement public incertain. » Cette école, dont les frais de scolarité se montent à 7 500 euros par an, adapte la taille de ses promotions au nombre de candidats qualifiées. Elle peut aussi proposer des salaires attractifs aux enseignants. La Commission des titres d’ingénieurs, qui veille à la qualité de la formation, demande « un enseignant pour dix à quinze élèves », explique Jean-Louis Allard. « Lorsque nous sommes dans une dynamique de croissance, nous pouvons nous adapter et recruter des enseignants au prix du marché, ce qui est plus compliqué dans un établissement public, où le niveau de rémunération des intervenants est fixé par le ministère », explique Jean-Michel Nicolle, président de l’Union des grandes écoles indépendantes et directeur d’EPF Ecole d’ingénieur-e-s.
Le dilemme de la hausse des frais de scolarité
Les écoles publiques, elles aussi, demandent aux familles de mettre davantage la main au portefeuille, sachant qu’elles pratiquent des tarifs bien inférieurs à ceux de leurs consœurs privées – à titre d’exemple, dans les six écoles INSA, les jeunes paient 601 euros par an. Cette option a déjà été prise depuis cinq ans par quelques écoles publiques, comme l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées (Ensta), sous tutelle du ministère de la défense, ou l’Institut Mines-Télécom (IMT), rattaché au ministère de l’industrie. Une année de scolarité à l’IMT d’Albi est facturée désormais 2 150 euros à l’étudiant – sachant que le coût annuel estimé d’un élève ingénieur est supérieur à 10 000 euros. « En France, on aime cacher le coût de tout et on perd la mesure de ce que l’Etat investit, regrette Narendra Jussion, directeur de l’établissement. 2 150 euros, c’est peu par rapport à l’investissement réel porté sur chaque étudiant et ce que chacun d’eux pourra en tirer tout au long de sa carrière. »
Elargir à d’autres établissements publics une hausse des frais ? « La question est compliquée. Il ne faut pas que les grandes écoles perdent leur ouverture sociale et leur qualité de recrutement », souligne Claude Maranges, directeur pédagogique du groupe INSA. « Aucune école publique ne veut aller vers un système où les droits d’inscription sont la première ressource financière qui fait tourner la boutique », convient Jacques Fayolle, directeur de Télécom Saint-Etienne et président de la CDEFI. Tout est donc une affaire d’équilibre.
Recruter de nouveaux profils
Le second levier qui permet de former plus d’ingénieurs sans avoir à attendre plus d’investissements de l’Etat, c’est l’apprentissage. Depuis 2006, le nombre de jeunes formés par cette voie ne cesse d’augmenter pour parvenir à 15,5 % d’élèves ingénieurs en 2017, selon la CDEFI, aussi bien dans des établissements privés que publics. Les frais de scolarité sont alors payés par l’employeur. Un vrai levier d’ouverture sociale, notamment pour les écoles privées aux frais de scolarité élevés – mais pas uniquement. « Cela permet de modifier le spectre des diplômés et d’intégrer dans un cursus d’ingénieur des élèves en provenance d’IUT ou de BTS. Pour augmenter le flux d’étudiants, c’est une partie de la solution », observe Claude Maranges, du groupe INSA.
Enfin, la réforme du baccalauréat pourrait permettre, à partir de 2021, d’attirer plus de jeunes vers les métiers de l’ingénierie. Alors que le bac scientifique est très souvent la première étape vers le titre d’ingénieur, la disparition prochaine de cette filière est, pour les écoles d’ingénieurs et les classes préparatoires, une opportunité pour créer de « nouveaux dispositifs pédagogiques et d’attirer plus de profils différents, notamment féminins », projette Jacques Fayolle. Aujourd’hui, la part de femmes dans ces écoles plafonne à 27 %.