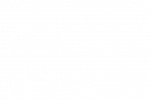1er-Mai : un dialogue social à rebâtir
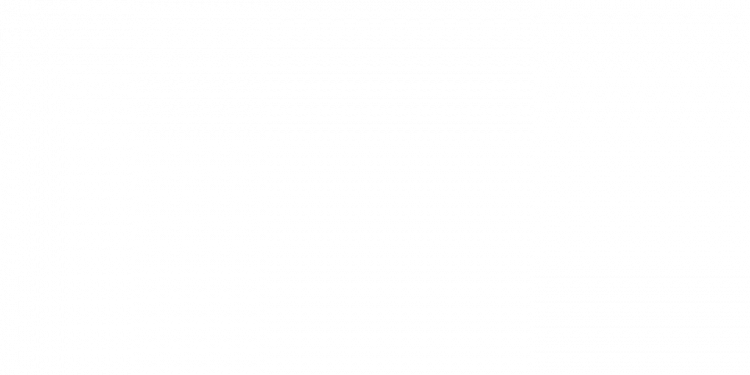
1er-Mai : un dialogue social à rebâtir
Editorial. En affaiblissant un peu plus des corps intermédiaires, qui ont trop peu de grain à moudre pour espérer réhabiliter la négociation collective, Emmanuel Macron s’est mis en danger.
Défilé du 1er-Mai, à Paris. / GONZALO FUENTES / REUTERS
Editorial du « Monde ». Les annonces présidentielles du 25 avril n’ont pas fondamentalement changé la donne : la situation sociale reste explosive. Emmanuel Macron a pu le mesurer, mercredi 1er mai, en constatant que, pour la deuxième année d’affilée, les syndicats s’étaient fait voler leur journée.
Certes, les scènes de violence sont restées contenues en comparaison des épisodes « gilets jaunes » de décembre et du 1er-Mai 2018, lorsque plus d’un millier de black blocs s’étaient installés par surprise en tête du cortège syndical. Mais si la situation est, globalement, demeurée sous contrôle, c’est au prix d’un dispositif de maintien de l’ordre hors normes. Ce n’est pas la nature des slogans syndicaux qui a focalisé l’attention, en cette journée internationale des travailleurs, mais la stratégie policière définie, au sommet du ministère de l’intérieur, par le trio Castaner-Nunez-Lallement pour contenir les risques de débordement liés à la coexistence de trois couleurs de contestation : noire, jaune, rouge.
« On apprend à se connaître »
Mêlant interpellations préventives et charges policières rapides dès le démarrage du cortège, cette stratégie, a fonctionné. Quoique expéditive : coincé dans des affrontements entre black blocs et forces de l’ordre, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a dû être brièvement exfiltré de son propre cortège. Du jamais-vu. Cela lui a donné l’occasion de dénoncer « une répression inouïe et sans discernement », mais n’a pas masqué l’essentiel : le syndicat de combat ne contrôle plus grand-chose, ni sur le plan du service d’ordre ni sur celui des luttes sociales.
Les « gilets jaunes » et « rouges » ont eu beau défiler côte à côte, la tentative de la CGT de les marier pour donner au mouvement un débouché syndical n’a rien donné. « On apprend à se connaître », a modestement reconnu Philippe Martinez, comme si les premiers appartenaient au nouveau monde, les seconds à l’ancien.
Quelques heures plus tôt, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, avait choisi de tenir un rassemblement distinct, place de l’Odéon, sous l’égide de l’Europe, en prenant ses distances avec la contestation actuelle et en réitérant ses offres de dialogue au gouvernement. Las, les troupes étaient maigres, découragées par l’ambiance plombée et les risques de violence.
Qu’ils soient réformistes ou contestataires, les syndicats sont à la peine. Le mouvement des « gilets jaunes » les concerne au premier chef, parce qu’il met en scène des travailleurs aux fins de mois difficiles qui devraient être leurs adhérents. Mais cette contestation qui a démarré sans eux se poursuit sans eux, autour des plus radicaux. La raison en est simple : en moins de cinq mois, le mouvement, pourtant sans leaders, a arraché au gouvernement 17 milliards d’euros de mesures nouvelles. Du point de vue de l’efficacité, les syndicats sont battus à plate couture. Ils doivent remonter à Mai 1968 pour prouver qu’eux aussi pouvaient. Cette époque est révolue.
Aujourd’hui, ils sont, comme l’ensemble des corps intermédiaires, discrédités, avec trop peu de grain à moudre pour espérer réhabiliter la négociation collective. La situation ne date pas d’aujourd’hui mais, en les affaiblissant un peu plus, Emmanuel Macron s’est mis en danger. La rue en profite. Elle le défie, assume la violence qui non seulement paie mais sape la cohésion du pays en le fracturant en deux camps : l’un, exaspéré que la contestation perdure, l’autre scandalisé que la police riposte. Il faut d’urgence rebâtir le dialogue social.