Le désarroi et la colère des « déguerpis » d’Abidjan
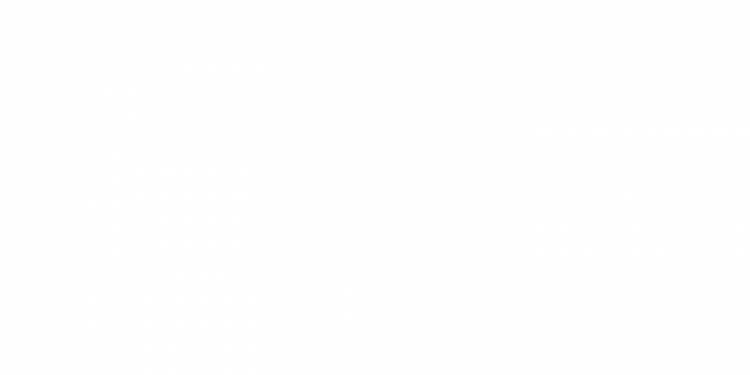
Le désarroi et la colère des « déguerpis » d’Abidjan
Par Youenn Gourlay (Abidjan, correspondance)
Dans la capitale économique ivoirienne, de nombreux quartiers précaires sont rasés sans ménagement avant la saison des pluies.
Moribé Doumbia, sur les décombres de son ancien atelier de meubles, à Yopougon, détruit par les buldozers fin avril 2019. / Youenn Gourlay
Ibrahima Keita prie. Entouré de gravats, il reste plusieurs minutes prostré sur l’une des dernières dalles de béton encore intacte. Peut-être en appelle-t-il à Allah pour que le ciel ne lui tombe pas une nouvelle fois sur la tête. Deux semaines plus tôt, à la mi-avril, cet habitant du Groupement, quartier de la commune populaire abidjanaise de Yopougon, a tout perdu, comme des centaines d’autres. « La mairie est d’abord venue nous demander de reculer nos commerces de 5 mètres, on l’a fait. Puis ils nous ont convoqués pour discuter des modalités et, pendant ce temps, les bulldozers ont rasé nos maisons alors qu’il y avait toutes nos affaires dedans. Ce sont des méthodes de bandits ! », s’insurge Moribé Doumbia, un vendeur de meubles désormais sans travail.
A Abidjan, les « déguerpissements » ne sont pas nouveaux, mais, avant la saison des pluies, le rythme s’accélère. Le ministre ivoirien de la construction, Bruno Koné, a prévenu au mois de mars que 132 quartiers précaires situés sur des zones inondables seraient rasés et ne feraient pas l’objet de réhabilitation. Officiellement, l’opération, qui se poursuit tout le mois de mai, vise à assainir les voies et les caniveaux sur lesquels des « logements anarchiques » se sont construits pour éviter de revivre les inondations de juin 2018 qui avaient fait 20 morts. Au total, ce sont au moins 1,2 million de personnes qui devront bouger, soit un cinquième de la ville.
Comme un ouragan
Ces jours derniers, les images des déguerpissements se répandent donc sur les réseaux sociaux et alimentent les commentaires. Les plus compatissants estiment que, « s’ils ont cassé les maisons des gens, qu’ils en construisent d’autres pour prouver leur volonté d’aider le peuple ! ». Les plus virulents, eux, préfèrent rappeler que « la loi, c’est la loi, s’il faut ça pour avoir un cadre de vie sain et éviter de tout risque alors on soutient ».
« Ils sont dans leur droit, on ne peut pas leur en vouloir, lance Léontine Ouehi, pourtant dépitée devant ce qui reste de son petit studio. Avec son fils de 19 ans et sa fille enceinte de 22 ans, la vendeuse de saucisses est aujourd’hui chichement accueillie par sa propriétaire sur un petit matelas ou à même le sol en attendant un geste de l’Etat. « Tant que l’Etat ne rembourse pas notre propriétaire, on n’aura pas notre caution et on dormira ici. Les studios coûtent au moins 70 000 francs CFA [105 euros] et il faut avancer six mois de caution, on fait comment ? C’est trop cher ! »
Derrière les commerces de canapés, de pneus et les salons de coiffure, des logements abritant parfois plus de dix personnes ont été détruits. Seuls le mur du fond et quelques briques sur les côtés permettent d’imaginer l’ancien décor. Et, au milieu de ces ruines à ciel ouvert, qui laissent penser au passage d’un ouragan, des dizaines d’enfants dansent au son d’une radio. Comme pour oublier. « Nous avons si peu de choses, mais même ça, les “microbes” [enfants délinquants] viennent nous le prendre la nuit. On a peur ! Ils ont même rasé les toilettes et les douches, y a plus rien ici. On est en colère », crie Amy, la plus âgée. A côté, leurs « tontons » Idrissa, Sahibou, Ali et Ibrahim partagent un verre d’eau, protégés sous un abri d’infortune fabriqué avec les portes des maisons rasées.
Lassina Keita est le propriétaire de tous ces anciens commerces. L’homme est en colère. Sous un arbre en bordure de route, il assure qu’il était « en règle ». Quant aux « inondations » redoutées par les autorités, il enrage : « Y en a jamais eu ici ! Ils rasent pour revendre aux Marocains. Ils veulent nous détruire pour ceux qui ont déjà des milliards, quand tu es milliardaire, tu ne dois pas chasser les pauvres ! »
« L’Etat doit planifier ! »
Pour l’heure, les habitants n’ont pas grand monde vers qui se tourner, hormis l’ONG Colombe Ivoire, qui tente ce qu’elle peut. Soutien de la première heure d’Alassane Ouattara, Sylla Sekou avait pris la présidence de l’organisation en 2013 dans le but d’appuyer le chef de l’Etat dans ses actions auprès de la population. Aujourd’hui, il se dit « déçu par certains collaborateurs » du gouvernement. « On entend les ministres dire qu’il faut compter sur la solidarité africaine : si on vous déguerpit, vous n’avez qu’à aller chez votre frère. Mais ce n’est pas normal, l’Etat doit planifier ! Ils ont une stratégie d’expropriation pour donner les terrains aux plus riches, il y a encore trop de corruption et d’abus de pouvoir », estime-t-il, dégoûté. Sollicités à de maintes reprises par Le Monde, les ministères comme les mairies concernés n’ont pas souhaité évoquer la question du relogement.
Le pasteur Emmanuel Elicha montre l’ampleur des dégâts à un voisin dans le quartier Inch’Allah à Koumassi détruit par les buldozers fin avril 2019. / Youenn Gourlay
A Koumassi, le maire Cissé Bacongo, élu en octobre 2018, avait lancé sa « campagne d’assainissement » dès le mois de février suivant. « Toux ceux qui ont été déguerpis vont être relogés », avait-il alors assuré. Mais, dans les quartiers Inch’Allah et Trois Ampoules, les expulsés attendent toujours. Dans son temple quasiment détruit, le pasteur Emmanuel Elicha fait les cent pas et ne décolère pas : « Vers 23 heures, ils m’ont appelé : “Viens vider ton temple, on vient le casser.” A mon arrivée, ils étaient en train de raser. On n’est pas indemnisés et on n’a pas l’argent pour reconstruire ailleurs. Koumassi est devenu cher. »
Avec les mille membres de son ONG, M. Sylla tente de « faire entendre la voix des pauvres ». Ce jour-là, il s’adresse aux veuves du quartier de Boribana, à Attécoubé, qui sera bientôt rasé pour la construction du quatrième pont d’Abidjan : « On a réussi à repousser le déguerpissement plusieurs fois. Il nous faut du temps pour recaser tout le monde en fonction du statut, du logement, de la famille. Ce que l’Etat ne fait pas. » Sa principale victoire est un accord passé avec le ministère de l’éducation pour réaffecter tous les élèves des écoles rasées : « Sans nous, ils seraient tous à la rue. » Cet accord n’est qu’un premier pas institutionnel, et M. Sylla ne compte pas s’arrêter là.








