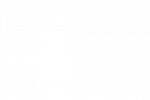Jobs du clic : qui sont ces micro-travailleurs « invisibles » ?
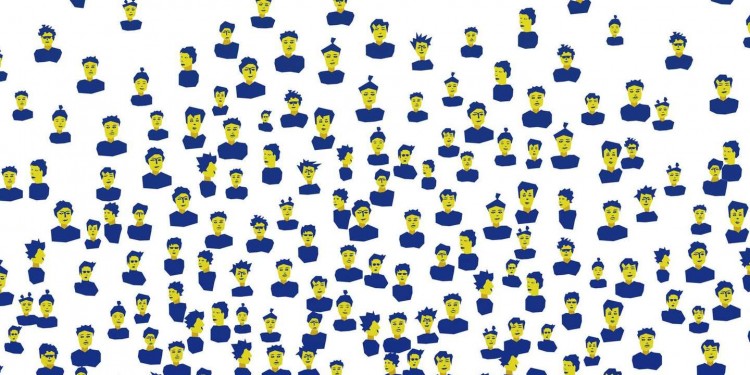
Jobs du clic : qui sont ces micro-travailleurs « invisibles » ?
Par Morgane Tual
La première étude approfondie sur les micro-travailleurs français dépeint une activité précaire, où, isolés, ils n’ont aucune prise sur leur environnement de travail.
Effectuer une recherche sur le Web. Retranscrire une phrase. Légender une photo. Répondre à un questionnaire. Détourer une image. Et cetera, Et cetera, Et cetera. Ces tâches, qui ne nécessitent qu’une poignée de secondes ou de minutes, effectuées sur ordinateur ou smartphone, rapportent quelques centimes, voire quelques euros à ceux qui les exécutent. Eux, ce sont les « micro-travailleurs », selon la terminologie utilisée par les auteurs de la première grande étude française à leur être consacrée, publiée vendredi 24 mai.
Dirigée par Antonio Casilli et Paola Tubaro, respectivement chercheurs à Télécom ParisTech et au CNRS, cette enquête dresse le profil d’une activité professionnelle encore méconnue, « moins visible que les chauffeurs Uber ou les livreurs de Deliveroo » et pourtant grandissante.
Des micro-tâches pendant le footing
Ni freelances ni travailleurs « uberisés », ces travailleurs du clic, comme on les surnomme parfois, se connectent à des plates-formes spécialisées dans le micro-travail, qui leur fournissent des tâches à effectuer, commandées par un client. Ils seraient, selon les auteurs de cette étude, plus de 260 000 en France, plus ou moins actifs – un chiffre jugé exagéré par d’autres chercheurs.
Quel est leur profil ? Des femmes, en majorité : 56,1 %, selon un questionnaire auquel ont répondu un millier de micro-travailleurs de la plate-forme Foule Factory. Une partie considérable a entre 25 et 44 ans (63,4 %), alors que les moins de 25 ans sont assez peu présents. Le micro-travail « semble propre à une population en âge actif, qui a fini ses études », notent les chercheurs. « Il est étonnant de constater la part importante de micro-travailleurs qui ont un emploi stable en parallèle », poursuivent-il. « 40 % des personnes enquêtées sur la plate-forme Foule Factory ont un CDI, et 71 % d’entre elles travaillent à temps plein ». 51 % des personnes interrogées appartiennent aux catégories populaires (selon la définition de l’Observatoire des inégalités) et 22 % vivent sous le seuil de pauvreté.
Les motivations et les pratiques diffèrent d’un micro-travailleur à l’autre. Les chercheurs évoquent l’exemple d’une femme micro-travaillant le soir devant la télévision ou pendant sa pause déjeuner au travail, pour espérer toucher jusqu’à 100 euros les bons mois (les chercheurs évoquent une « triple journée » pour les femmes qui travaillent, micro-travaillent et s’occupent des tâches ménagères).
Ou celui d’un homme en situation de handicap, en invalidité professionnelle, qui complète ainsi sa pension. Un autre homme raconte quant à lui effectuer ces micro-tâches dans le but de financer une activité à son enfant. Lui trouve le temps de les faire pendant son footing : les plates-formes demandent parfois de se rendre dans un commerce précis, pour prendre des produits en photo par exemple. Les missions qui lui sont attribuées influent sur le parcours de sa course.
Combien de temps cela leur prend-il ? La moitié des personnes interrogées consacrent moins de 3 heures par semaine au micro-travail. Mais cela peut monter à 20, voire 60 heures par semaine pour d’autres, ce qui explique l’énorme disparité des revenus mensuels : « entre quelques centimes et, dans des cas vraiment exceptionnels, 2 000 euros ». La moyenne reste toutefois très faible avec 21 euros par mois.
Interrogation sur l’éthique de certaines tâches
Les conditions entourant ce travail n’ont rien à voir avec celles d’un emploi traditionnel, expliquent les auteurs de l’étude :
« Le micro-travail a la particularité d’être, de façon générale, invisible, effectué à la maison, et régi par des formes de contrats diverses : un simple “accord de participation”, voire la seule adhésion aux conditions générales d’utilisation de la plate-forme peuvent faire office de contrat. »
Le tout, dans une grande opacité : en général, les travailleurs ne savent pas pour le compte de qui ils travaillent, ni même quelle est la finalité des micro-tâches qu’ils effectuent. « Ceux-ci s’interrogent parfois sur l’éthique de certaines tâches qu’ils effectuent. » L’étude donne l’exemple d’une tâche surprenante citée par plusieurs micro-travailleurs interrogés, consistant à jouer à une sorte de jeu vidéo :
« Dans ce jeu, les micro-travailleurs doivent se diriger “vers les personnages aux prénoms d’origine FRANÇAISE en appuyant sur la touche AVANCER” et s’éloigner de ceux “aux prénoms d’origine MAGHREBINE en appuyant sur la touche RECULER” (sic). La tâche se présente comme une étude universitaire, mais provoque la méfiance de certains travailleurs : est-ce une expérience psychologique pour mesurer les préjugés des Français, ou bien la simulation d’un jeu vidéo de propagande anti-immigrés ? »
Par ailleurs, même si elles ne sont pas toujours présentées comme telles, beaucoup de micro-tâches contribuent en fait à améliorer des systèmes d’intelligence artificielle (IA). Car pour fonctionner, ces technologies doivent être « nourries » par d’énormes bases de données conçues par des humains, à partir desquelles elles « apprennent ».
« [Les micro-travailleurs ] enseignent aux dispositifs de reconnaissance vocale ou visuelle à interpréter des sons et des images. Ils nettoient les données et les enrichissent pour qu’elles puissent être utilisées dans l’apprentissage profond. Ils retranscrivent des textes à partir d’images floues ou de mauvaise qualité. »
Les auteurs du rapport précisent que dans certains cas, il arrive même que des humains soient payés… pour se faire passer pour un système d’intelligence artificielle. Des entreprises proposant par exemple des IA censées effectuer des prises de rendez-vous emploient en fait des humains pour faire ce travail, et ainsi nourrir des bases de données, afin qu’une machine soit par la suite capable de les imiter.
Des travailleurs isolés
S’ils représentent « un atout essentiel pour innover », ces travailleurs sont souvent « invisibles pour les clients, pour la plate-forme et bien souvent pour les autres micro-travailleurs », expliquent les chercheurs. Ils sont régulièrement dans l’incapacité de communiquer avec les clients pour qui ils effectuent les tâches, et sont parfois sanctionnés sans explication. Par exemple, si un client ne valide pas la micro-tâche, le travailleur n’est pas rémunéré, et ne peut pas contester. D’autres se voient bannis sans justification.
Les micro-travailleurs sont aussi mis en concurrence les uns avec les autres, poussés à se jeter les premiers sur une tâche rentable avant que les autres ne s’en emparent, et souvent comparés sur les plates-formes par un score. Par ailleurs, ces travailleurs sont souvent isolés. Si certaines plates-formes offrent des lieux d’échange, relativement limités, ce n’est pas le cas de toutes. Or, expliquent les chercheurs, « l’isolement empêche, entre autres choses, le partage d’expériences communes, ainsi qu’une réflexion conjointe sur ce qui pourrait, ou devrait être, le micro-travail : l’individu n’a aucune prise sur son environnement de travail ».
Les auteurs exhortent donc les pouvoirs publics, les syndicats et les entreprises à se pencher sur le micro-travail, et « son système de rémunération peu ou pas normé et contrôlé ».
« Comment réguler cette nouvelle force de travail et renforcer sa protection sociale parfois inexistante ? (…) La protection de l’emploi est une caractéristique des politiques publiques françaises et s’inscrit dans une tradition de longue date. A rebours de ces dispositifs qui protègent les salariés, le micro-travail se situe à la marge de l’emploi formel, alors même qu’il est au cœur des processus d’innovation dans de nombreuses industries et secteurs d’activités. »