Au Guatemala, la candidate de centre gauche en tête du premier tour de la présidentielle
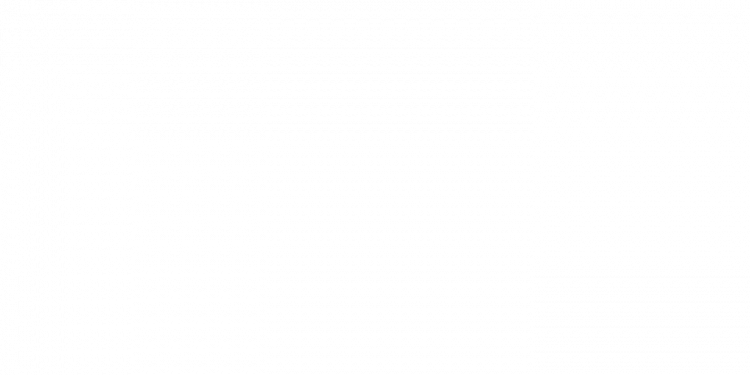
Au Guatemala, la candidate de centre gauche en tête du premier tour de la présidentielle
Par Angeline Montoya
Aucune candidature ne soulevait l’enthousiasme des électeurs de ce pays gangrené par la corruption, la pauvreté et la violence.
Sandra Torres, de l’Union nationale de l’espoir (UNE, centre gauche), après les résultats du premier tour de la présidentielle guatémaltèque, dont elle sort première selon des résultats partiels, à Guatemala City, le 17 juin. / LUIS ECHEVERRIA / REUTERS
Les Guatémaltèques n’attendaient pas grand-chose des élections générales organisées dimanche 16 juin. Si les huit millions d’électeurs étaient appelés à élire 160 députés, 340 maires et 20 représentants au Parlement centraméricain, c’est l’élection du chef de l’Etat qui avait focalisé l’attention.
Dans un pays miné par la corruption, la pauvreté et la violence, où la seule candidate présidentielle à présenter un programme réformiste, l’ex-procureure générale Thelma Aldana, a été écartée de la course sous des motifs plus ou moins fallacieux, aucune candidature ne soulevait l’enthousiasme des électeurs. C’est sans surprise que la favorite, Sandra Torres, de l’Union nationale de l’espoir (UNE, centre gauche), est en tête du premier tour avec 24 % des voix, selon des résultats encore partiels.
Cette femme de 63 ans n’est pas novice en politique. Sous le gouvernement de son ex-mari, Alvaro Colom (2008-2011), c’était elle qui, de fait, exerçait le pouvoir. Elle avait cependant dû s’incliner au second tour de l’élection de 2015 face au comique de télévision Jimmy Morales, élu sur la promesse d’en finir avec la corruption, alors que le président de l’époque, Otto Pérez Molina, avait été contraint à la démission après de graves accusations de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (Cicig).
Un référence dans la région
Malgré ses diatribes virulentes contre M. Morales, Sandra Torres est vue comme une candidate proche du pouvoir et dont la présidence, si elle était confirmée au second tour le 11 août, signifierait une continuité du régime actuel. Tout comme, d’ailleurs, le serait une présidence d’Alejandro Giamattei, du parti Vamos (droite), qui arrivait en seconde position dimanche soir, avec 15 % des voix (c’est la quatrième fois qu’il aspire à la présidence).
Sandra Torres est elle-même accusée par la Cicig de financement électoral illégal. Ni elle ni Alejandro Giamattei n’ont l’intention de renouveler son mandat, qui prend officiellement fin le 3 septembre. Cette commission, mise en place par un accord entre l’ONU et le Congrès guatémaltèque en 2007, avait pour but de lutter contre les structures criminelles héritées de la guerre civile (1960-1996). Forte de ses résultats probants, de ses 680 mises en examen, des 34 réformes judiciaires qu’elle a contribué à mettre en place, elle était devenue une référence dans toute la région.
Depuis douze ans, avec la Cicig, le pays avait toutes les cartes en main pour sortir de l’enfer de la corruption et de la violence. Créditée de 70 % d’opinions favorables, la Commission avait redonné foi aux Guatémaltèques en leurs institutions. Mais elle a signé son arrêt de mort lorsqu’elle s’en est prise à l’élite politique et économique qui tient le pays (une quinzaine de membres de la puissante organisation patronale, la Cacif, ont été mis en examen) et, surtout, au président Jimmy Morales lui-même, pour financement illégal de campagne. La réaction ne s’est pas fait attendre. Le chef de l’Etat a expulsé le chef de la commission, le Colombien Ivan Velasquez, remplacé Thelma Aldana – qui, lorsqu’elle était à la tête du ministère public, menait les enquêtes aux côtés de la Cicig –, et annulé le mandat de la Cicig. Une décision invalidée par la Cour constitutionnelle, mais qui a, de fait, sensiblement ralenti les enquêtes.
Permanence du « pacte de corrompus »
Après la mise à l’écart de Thelma Aldana, une seule parmi les 19 candidats aurait pu faire la différence : Thelma Cabrera, dirigeante indigène du Mouvement pour la libération des peuples. Dans un pays machiste et raciste, où 79 % des pauvres sont indigènes, sa montée dans les sondages, ces dernières semaines, avait de quoi inquiéter l’establishment. Selon les résultats partiels, Mme Cabrera a remporté 10 % des suffrages, arrivant en quatrième position.
Toutes les possibilités de changement ayant été écartées, le Guatemala et ses 16 millions d’habitants n’auront pas grand-chose à attendre du second tour, qui ne fera que confirmer la permanence du « pacte de corrompus » dénoncé sans relâche par Thelma Aldana et Ivan Velasquez. Quatre ans après le « printemps guatémaltèque » de 2015 qui a vu descendre dans la rue des milliers de personnes pour exiger – et obtenir – la démission d’Otto Pérez Molina, c’est donc aux vieilles pratiques que le pays s’apprête à revenir.
Un parfum de violence politique a d’ailleurs entouré cette élection : Thelma Aldana, menacée de mort, a dû quitter le pays en mars. Et quatre jours à peine avant le scrutin, c’est le procureur du tribunal électoral, Oscar Schaad, qui a fui le Guatemala, après avoir reçu « des menaces précises ». Entre la lutte contre la corruption et l’affaiblissement de la démocratie, la messe a été dite. Dans trois mois, la Cicig ne sera plus.







