Les Africains s’exposeront (quand même) à Arles
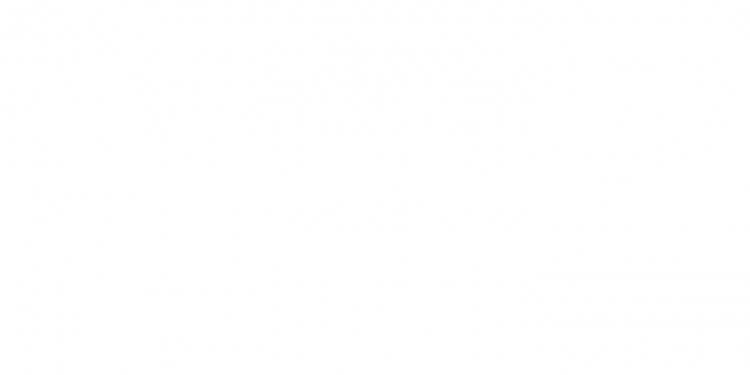
Les Africains s’exposeront (quand même) à Arles
Par Amaëlle Brignoli
Le galeriste Olivier Sultan, choqué par l’absence des photographes du continent au cinquantenaire des Rencontres d’Arles, a décidé d’organiser une exposition parallèle.
« L'enfer du cuivre », de Nyaba Ouédraogo, 2008, décharge d’Agbogbloshie, Accra, Ghana. / Nyaba Ouédraogo
« Les photographes africains, grands absents des Rencontres d’Arles ». Publié le 10 mai sur le site du « Monde Afrique », cet article de Roxana Azimi a été un « électrochoc » pour Olivier Sultan. Ce Parisien possède une galerie dédiée aux arts africains dans le 11e arrondissement, où il expose actuellement l’artiste ivoirien Mounou Désiré Koffi. En « fan » des Rencontres, il a tellement peu goûté l’idée qu’aucun photographe africain ne soit à l’affiche du cinquantenaire du festival de photographie contemporaine qu’il a décidé de monter une exposition parallèle à… Arles.
La Grande Vitrine, galerie arlésienne qui doit ouvrir ses portes en juin, accueillera donc « L’Afrique vue par elle-même » durant tout le mois d’août, mettant dans la lumière neuf photographes du continent. Parmi eux, Lassy King Massassy, Robert Nzaou, Malick Sidibé, Oumar Ly, Jürgen Schadeberg, mais aussi Nyaba Ouedraogo, N’Krumah Lawson Daku et Mabeye Deme, qui font partie de la nouvelle génération.
« Conquérir le monde »
Si tous sont ravis de l’initiative, ils estiment « dommage » l’omission de leur continent dans la programmation officielle des Rencontres d’Arles, visibles du 1erjuillet au 22 septembre. N’Krumah Lawson Daku parle même du « goût bizarre » laissé par cet oubli qu’il n’arrive toujours pas à s’expliquer. « C’est vraiment surprenant parce que ce festival expose régulièrement des artistes de la diaspora », pondère le photographe togolais. Même si c’était parfois « par de petites fenêtres », ils avaient l’impression d’y avoir une entrée, alors qu’« une partie du monde de la photo n’est pas intéressée par ce que font les Africains ou ceux de la diaspora ». Le Franco-Sénégalais Mabeye Deme, s’étonne lui aussi de cette absence « pour les 50 ans du festival. Ça aurait été bien d’y être, d’autant que cette édition aura une grande visibilité ».
Certains, à l’instar du photographe burkinabé Nyaba Ouedraogo sont plus radicaux, estimant que « le problème est ailleurs » et dénonçant l’absence de politique culturelle des pays africains. « Bien sûr que sur la scène internationale nous ne sommes pas connus. Mais est-ce que c’est la faute des Européens ? Non ! », insiste cet ancien athlète de haut niveau qui s’est initié à la photo auprès d’un amateur. D’après lui, la priorité est d’abord d’ancrer la photographie dans les mentalités africaines, avant de prétendre à une visibilité internationale. « Tant que le travail n’est pas fait au niveau national, il est très difficile de conquérir le monde », conclut-il.
« En position », de Malick Sidibé, 1974, Bamako, Mali. / Malick Sidibé
En attendant, Olivier Sultan, veille. Son intérêt pour l’art et la culture venus du continent africain ne date pas d’hier. « Depuis trente ans, je suis constamment interpellé par cette distorsion du regard qui ne s’applique qu’envers l’Afrique. » Selon lui, l’histoire du colonialisme et les relations politico-économiques encore déséquilibrées à ce jour sont autant de filtres qui empêchent les Européens de porter un regard neutre sur l’art africain. Il a même sa propre théorie, estimant qu’« on pourrait faire un parallèle statistique entre le PIB d’un pays et sa représentation dans les foires d’art contemporain ». Chaque pays y défend ses artistes à la hauteur de ses moyens, « et l’Afrique n’en a malheureusement pas beaucoup ».
« Discours paternaliste »
Son histoire avec l’Afrique est déjà longue. Elle commence en 1987 au Zimbabwe, où il passe deux ans en coopération au Centre culturel français de Harare, puis y ouvre une galerie d’art qu’il tiendra pendant dix ans. « Là-bas, j’ai découvert une richesse culturelle que je ne soupçonnais pas », se souvient-il. En discutant avec les artistes zimbabwéens, il se rend compte qu’il existe un décalage entre leurs créations et le « discours occidental paternaliste » qui a tendance à définir leur art comme « exotique, artisanal et traditionnel ». « Ils revendiquaient eux-mêmes d’être contemporains, et c’était très douloureux pour eux d’être amalgamés, désignés dans de gros blocs, sortes de groupes ethniques, sans différenciation. » Depuis, l’approche a changé. Et de citer des foires dédiées à l’art contemporain africain comme AKAA, à Paris, ou 1:54, dont la cinquième édition se tiendra à New York.
Et comme à Arles les années se suivent mais ne se ressemblent pas, les organisateurs des Rencontres ont d’ores et déjà annoncé une programmation à large présence africaine pour l’édition 2020, à l’occasion de la saison « Africa 2020 ». Mais Olivier Sultan reste dubitatif. « En 2020, tout le monde se mettra au diapason, lance-t-il. Mais quand l’année de l’Afrique sera terminée, il n’y aura plus grand-chose. Ce n’est pas ça qui va permettre une présence durable des artistes africains sur la scène internationale ». A suivre.
« L’Afrique vue par elle-même », du 1er au 31 août 2019 à la galerie La Grande Vitrine, 12, rue Jouvène, 13200 Arles.








