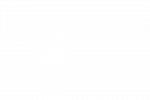Le dessinateur de BD Guillermo Mordillo est mort

Le dessinateur de BD Guillermo Mordillo est mort
Par Frédéric Potet
Mort à l’âge de 86 ans, Mordillo avait mis au point un humour universel, accessible à tous, hermétique au bouillonnement du monde extérieur.
Qu’elles aient l’aspect de posters, de puzzles ou d’albums cartonnés, les illustrations de Guillermo Mordillo ont impressionné durablement d’innombrables rétines dans les années 1970 et 1980, quand le dessinateur argentin était au sommet de sa gloire. Ses girafes au cou interminable, ses éléphants obèses, ses amoureux à la tendresse désarmante, ses footballeurs au nez aussi rond que leur ballon ont façonné un petit théâtre poétique sous le signe du rire et de l’absurde, qu’il est impossible d’oublier.
La disparition de l’humoriste, samedi 29 juin à son domicile de Majorque (Espagne), à l’âge de 86 ans, plonge dans une profonde nostalgie tous ceux et celles qui, un jour ou l’autre, dans leur chambre d’ado, ont souri aux situations rocambolesques sorties de son crayon.
« J’adorais ses livres quand j’étais petit, ses images fourmillantes de millions de détails m’ont beaucoup influencé », a commenté l’auteur de BD Boulet, sur son compte Twitter.
Mordillo est mort, tristesse… J'adorais ses livres quand j'étais petit, ses images fourmillantes de millions de dét… https://t.co/0JIBIpr1Gc
— Bouletcorp (@-Boulet-) Définir le style Mordillo est assez simple. Il se caractérise par une ligne claire d’une rondeur et d’une souplesse toujours égales, jamais altérées par l’usure du temps ou le changement de techniques. Par l’usage du blanc comme couleur principale donnée à ses personnages, ce afin de les faire mieux ressortir au milieu de décors chatoyants. Par l’absence de parole, enfin. Voir un phylactère s’échapper de la bouche d’un de ses protagonistes aurait été impensable. Mordillo avait mis au point un humour universel, accessible à tous, hermétique au bouillonnement du monde extérieur. Cela explique pourquoi on trouvait ses réalisations aussi bien dans les magasins de jouets de Tokyo que dans les librairies de Saint-Germain-des-Prés.
Aucun vainqueur aucun vaincu, seul le rire compte les points
La principale marque distinctive de son humour reste néanmoins cet art du décalage permanent, où la forme est souvent mise au service du gag. Un groupe de cyclistes s’avance sur une route coupée en deux par un fossé ? Allongée horizontalement, une girafe déploiera son cou à la manière d’un pont. Sur l’échafaud, un condamné à mort s’apprête à être pendu ? Il a le temps de se prendre en selfie. Un torero réclame l’ovation du public après plusieurs passes ? Le taureau lui botte les fesses en retour. Chez Mordillo, aucun vainqueur aucun vaincu, seul le rire compte les points. Ses dessins aux accents de pantalonnade rudoient sans distinction les tares du genre humain, de la vanité à l’arrogance.
Pour atemporel qu’il paraisse, l’humour mordillesque a mis un certain temps avant de s’élaborer et de se figer dans une esthétique familière. Né le 4 août 1932 à Buenos Aires, Guillermo Mordillo Menéndez travaillera d’abord dans la publicité avant de créer un studio de dessins animés, le studio Calas, alors qu’il a tout juste 20 ans. Comme de nombreux dessinateurs argentins à l’époque, il fuit la dictature pour s’installer à l’étranger, d’abord à Lima, en 1955, puis à New York et à Paris, où il arrive en 1963.
La publicité est alors encore son principal gagne-pain, ce qui ne l’empêche pas de placer quelques gags dans des magazines tels que Lui, Paris Match, Marie Claire ou encore Pif Gadget – un éclectisme qui témoigne, très tôt, de l’œcuménisme d’un auteur qui, à l’image d’un Sempé ou d’un Quino (son compatriote, créateur de Mafalda), va bientôt conquérir le monde avec ses bonshommes à gros nez et ses girafes lunatiques.