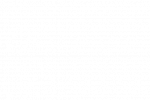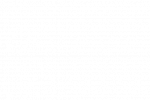Vélosophes et soutiers du Tour de France : la bicyclette, petite reine des librairies

Vélosophes et soutiers du Tour de France : la bicyclette, petite reine des librairies
Par Clément Guillou
Trois ouvrages, signés Olivier Haralambon, Guillaume Martin et Grégory Nicolas, racontent, chacun à sa manière, l’univers de la Grande Boucle et des courses cyclistes.
Sur une étape alpine de la Grande Boucle, en 2007. / BAS CZERWINSKI / AP
Livres. Il faut le lire, ce recueil de portraits de coureurs cyclistes, mais aussi y jouer. Le lire d’abord pour retrouver la langue exigeante d’Olivier Haralambon qui, il y a deux ans, racontait si bien l’exaltation de l’effort cycliste et le frisson de la course dans Le Coureur et son ombre (Premier parallèle, 2017). Y jouer ensuite pour identifier ces 12 portraiturés que l’auteur aime avec leurs tourments et qu’il ne nomme jamais, persuadé que cela pourrait lui nuire.
Car il révèle, dans ces courts essais, le moins beau, le calcul, les motivations perverses ou tout à fait nobles que les cyclistes trouvent à l’effort – précisément ce que la communication, qui les vend comme une bonne soupe, veut faire taire. On préservera le plaisir de la devinette au lecteur. Quel est ce célèbre « Jésus jardinier » à la chevelure nazaréenne, enfermé dans ses pitreries ? Et cet autre, pris de honte après l’envoi sur Instagram d’une locution latine qui le fera paraître cuistre, lui l’obsessionnel enfermé dans son jeu ? De quelle contrée vient-il, cet ancien champion qui vend désormais une bière « du nom d’un lieu où se tinrent ses plus beaux exploits » et retrouve les maillots de sa gloire aux murs des cafés où il vend sa brune ?
D’autres sont plus anonymes ou nous ont échappés. On a cru reconnaître l’auteur lui-même dans ce portrait d’un cycliste débutant, soucieux de ne jamais oublier, jusque dans l’attitude altruiste en course, son aïeul silencieux qui tuait des rats pour survivre. « Chaque fois qu’il rentre avec les doigts tellement bleuis qu’il les enveloppe dans les torchons à vaisselle de sa mère, qu’il retire les chaussettes qu’il a fourrées dans son cuissard autour de son prépuce violacé par janvier, il se sent moins traître à ses racines. Il s’entraîne donc, c’est son premier hiver, la révélation de son chemin prolétaire et ascétique. »
Culture de l’échec
Olivier Haralambon fut cycliste amateur ; c’est une peau dont il ne se débarrasse pas maintenant que le voilà écrivain et philosophe. Sa vision du cyclisme se lit dans cette suite de portraits : vive la « pure dépense », sus aux « gains marginaux » et à l’accumulation économe des watts. « Cette façon de faire est à l’effort ce que les pixels sont à la peinture à l’huile. » C’est un livre sur le corps que l’on torture et refaçonne, sur la religion qui n’est jamais loin, et sur l’échec, car il n’est aucun sport où l’on perde aussi souvent.
Guillaume Martin le sait bien : l’un des dix meilleurs coureurs français, perd pourtant 98 % des courses qu’il dispute. De lui, le grand public sait mieux qu’il est, outre son don pour le cyclisme, diplômé de philosophie et auteur de théâtre – ainsi que de chroniques sur le Tour de France pour Le Monde, depuis trois ans. Il s’amuse de son image de « vélosophe », en joue même puisqu’il publie Socrate à vélo. La fantaisie s’inspire d’un sketch des Monty Python, qui, en 1972, imaginaient l’opposition sur un terrain de football entre le onze allemand mené par Friedrich Hegel et l’équipe grecque et son attaquant Archimède.
International philosophical football
Durée : 03:56
Cette fois, sous la plume de Guillaume Martin – engagé sur son troisième Tour de France avec l’équipe belge Wanty-Groupe Gobert –, c’est à la conquête du maillot jaune que s’attellent les philosophes : Marx plaide pour une répartition égalitaire des primes ; Marc Aurèle s’applique à s’abstenir en suivant les préceptes stoïciens de son directeur sportif Epictète ; Nietzsche lutte contre ses doutes en prenant un plaisir masochiste sur la table de massage, jusqu’à dire « oui » à l’épreuve du Tour. Le récit est un manuel de philosophie à l’adresse des cyclistes, ou une initiation à la vie de coureur cycliste pour les philosophes.
La roue tourne
Le grimpeur normand dit avoir préféré le cyclisme à la philosophie, car « le risque du sérieux y est limité », lui qui y met pourtant tant d’application lorsqu’il part rouler sous la pluie en écoutant les podcasts de France Culture. « A l’instar des Grecs, qui accordaient créance à leurs mythes sans pour autant être dupes, nous faisons mine de croire au sport, sans oublier qu’il n’est, au fond, rien de plus qu’une construction humaine. (…) Le vélo invente des histoires dont je suis à la fois acteur et spectateur, et que d’autres regardent comme une série télévisée. »
Dans cette série, il est des seconds rôles qui existent à peine, ceux qui pédalent les mêmes 3 460 kilomètres sans passer, pour certains, une seule seconde à l’écran. C’est à eux que le jeune romancier Grégory Nicolas s’intéresse dans Equipiers, un voyage en France à la rencontre de ceux qui, par leurs limites physiques – parfois – ou psychologiques – souvent –, ont préféré se mettre au service des autres.
Avec beaucoup de second degré et en assumant son côté « fan de », l’auteur se met en scène au mariage de Pierre Rolland, chez un caviste avec Clément Chevrier ou aux championnats du monde avec Rudy Molard. Et ça marche : difficile de ne pas les aimer, ces soutiers qui gagnent par procuration jusqu’à ce qu’un jour, la gloire leur tombe dessus comme la foudre.
« Mes coureurs imaginaires », d’Olivier Haralambon (Premier parallèle, 160 pages, 16 €).
« Socrate à vélo », de Guillaume Martin (Grasset, 192 pages, 17 €).
« Equipiers », de Grégory Nicolas (Hugo Sport, 280 pages, 17,50 €).
Signalons également la parution, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la première victoire d’Eddy Merckx et du départ du Tour de France à Bruxelles, la parution de trois ouvrages consacrés au champion belge : « 1969. L’Année d’Eddy Merckx », de Johny Vansevenant (Racine, 432 pages, 49,99 €); « On m’appelait le Cannibale », d’Eddy Merckx, avec Stéphane Thirion (La Boîte à Pandore, 256 pages, 18,90 €); « Eddy Merckx, analyse d’une légende », de Jean Cléder (Mareuil, 224 pages, 22 €).