Le malaise de l’Alliance atlantique après la livraison des S-400 russes
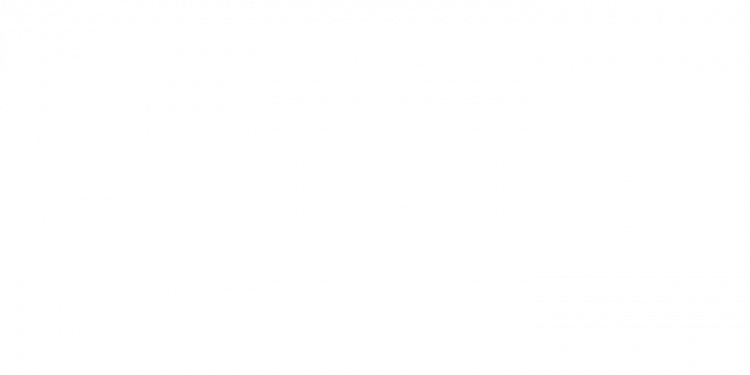
Le malaise de l’Alliance atlantique après la livraison des S-400 russes
Par Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, bureau européen)
En l’absence de mécanisme de sanctions au sein de l’OTAN, les Etats-Unis pourraient prendre des mesures de rétorsion contre Ankara.
Au siège de l’OTAN, le 19 avril, à Bruxelles. / Yves Herman / REUTERS
L’OTAN a beau vouloir limiter au maximum l’affaire à une question de relations bilatérales entre Washington et Ankara, l’annonce de la livraison, par la Russie, d’une première volée de missiles et radars S-400 à la Turquie porte à leur paroxysme des difficultés déjà alimentées, au sein de l’Alliance atlantique, par les questions syrienne et kurde, ou le coup d’Etat manqué de 2016, qui avait entraîné l’éviction d’une bonne partie des interlocuteurs habituels des dirigeants otaniens.
Le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg, soucieux de maintenir un canal de dialogue avec le président Recep Tayyip Erdogan, joue depuis longtemps la carte de la prudence et, de toute manière, sa marge de manœuvre est réduite : le traité fondateur de l’organisation ne prévoit aucun mécanisme de sanctions contre un membre, et il n’existe pas, à l’OTAN, de règlement d’ordre intérieur qui pourrait permettre de les envisager. C’est, dès lors, des Etats-Unis que viendront d’éventuelles mesures de rétorsion.
A Bruxelles, l’Alliance se disait toutefois « préoccupée », vendredi 12 juillet. Un groupe de travail constitué pour tenter de dénouer la crise qui couvait n’a servi à rien. Pas plus que les rappels à l’ordre réguliers sur le thème de l’indispensable interopérabilité entre les équipements de tous les alliés, condition sine qua non pour les missions qu’ils peuvent effectuer ensemble.
Ankara « pas autorisé » à disposer des S-400 et des F-35
Fin juin, le nouveau secrétaire américain à la défense, Mark Esper, a rencontré son homologue turc, Hulusi Akar, en marge d’une réunion ministérielle à Bruxelles. Il s’agissait d’une ultime tentative de conciliation, permettant de rappeler « plusieurs décennies de collaboration entre partenaires stratégiques ». Celle-ci était toutefois assortie d’une nouvelle mise en garde du Pentagone, qui rappelait « l’incompatibilité » entre le programme de l’avion furtif américain F-35 et les S-400, en indiquant qu’Ankara ne serait de toute façon « pas autorisé » à disposer des deux équipements.
La Turquie projette d’acquérir 116 exemplaires du F-35, et de contribuer à son développement, avec un investissement actuel de 1,4 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros). Quelques centaines d’exemplaires de l’avion ont été livrées, mais il est encore en phase de test. En raison de problèmes techniques, aucun exemplaire n’est aujourd’hui entièrement opérationnel. Les dirigeants du Pentagone affirment que, via le système S-400, la Russie pourrait disposer d’informations lui permettant d’abattre le F-35.
Jusqu’à il y a quelques semaines, la diplomatie américaine ne semblait toutefois pas convaincue que les dirigeants turcs iraient au bout de leur projet d’acquisition du S-400, qui était pourtant un vaste sujet de polémique depuis deux ans. Le scepticisme de Washington était encouragé par le fait qu’en 2015, la Turquie avait renoncé à un projet d’achat de missiles antiaériens chinois.
« Rupture stratégique »
A l’OTAN, sous le calme apparent, de nombreuses questions couvent, admet un officiel, sur la gestion d’un dossier qui concerne la deuxième armée de l’Alliance en termes d’effectifs, et sur la décision du président Erdogan d’affirmer son indépendance à l’égard des Etats-Unis et de l’OTAN. « La Turquie a décidé que les Etats-Unis n’étaient plus [pour elle] un partenaire indispensable », juge Soli Özel, professeur à l’université Kadir Has d’Istanbul, interrogé par l’agence Bloomberg. Il évoque une « rupture stratégique », pas imputable uniquement à une décision présidentielle, selon lui.
Washington est, « en théorie », désormais « obligé » de réagir fermement, juge quant à lui un diplomate européen. « Pour éviter que des données stratégiques tombent entre les mains des Russes, pour lancer un avertissement fort à Erdogan, pour éviter que de futures missions soient rendues plus complexes, pour mettre en garde d’autres pays qui seraient tentés d’acquérir du matériel russe. » Il reste, souligne cet expert, que le rôle joué par la Turquie, tant sur le plan sécuritaire, crucial pour les Etats-Unis – qui disposent de missiles et d’une base OTAN pour leurs avions à Incirlik, dans le sud du pays –, que dans le contrôle de l’immigration, un sujet-clé pour les Européens, pourrait amener les uns et les autres à réagir de manière modérée.
Les tensions actuelles présentent « le risque que les deux parties, arrivées à un point d’incompréhension mutuelle systématique, réagissent à la crise en la compliquant davantage encore », diagnostique le chercheur Nicholas Danforth dans une étude récente du German Marshall Fund of the United States, une organisation qui œuvre à l’approfondissement de la relation transatlantique. M. Danforth met aussi en évidence le risque que cette hostilité « transforme une alliance brisée en une confrontation durable ».







