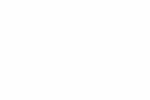Baisse des taux de la Fed : une décision confuse et risquée
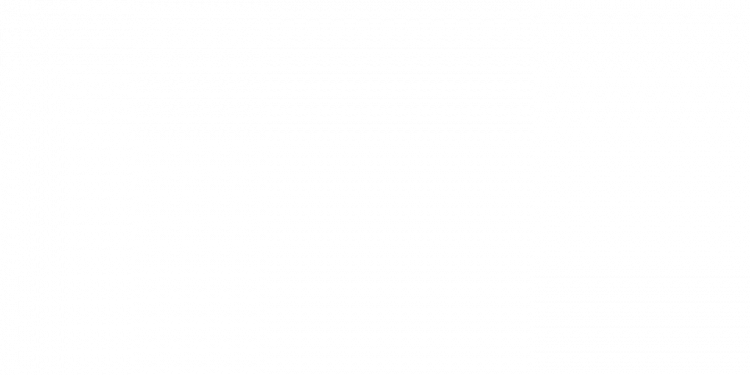
Baisse des taux de la Fed : une décision confuse et risquée
Editorial. Sous la pression des marchés et de Donald Trump, la banque centrale américaine a réduit, mercredi, son taux directeur de 0,25 point. Un choix qui n’est pas sans risque pour l’économie mondiale.
Le patron de la Reserve fédérale, Jerome Powell, le 31 juillet, à Washington. / SARAH SILBIGER / REUTERS
Editorial du « Monde ». La dernière fois que la Réserve fédérale (Fed) avait baissé ses taux directeurs, c’était le 16 décembre 2008. La crise financière battait son plein : les Etats-Unis étaient en déflation et le PIB avait chuté de 6,2 %. Il avait fallu attendre sept ans pour que le loyer de l’argent, après avoir été ramené à zéro, reparte à la hausse. En le baissant de nouveau, mercredi 31 juillet, la banque centrale américaine referme une parenthèse de normalisation de sa politique monétaire de seulement quarante-trois mois. Une décision qui entretient davantage les doutes qu’elle ne résout les problèmes.
Cette baisse des taux vise à soutenir l’activité économique des Etats-Unis et à tenter de prolonger la plus longue période de croissance de leur histoire contemporaine. Pourquoi redonner du tonus à une économie qui n’en manque pas ? Le PIB des Etats-Unis a encore progressé de 2,1 % au deuxième trimestre, le taux de chômage est tombé à 3,7 %, la consommation, qui représente 70 % de l’activité aux Etats-Unis, est dynamique et les salaires progressent à un rythme honorable.
Seul point noir : l’inflation reste atone. Malgré l’apport de tombereaux de liquidités, la surchauffe n’est toujours pas en vue. Plus d’assouplissement monétaire aura-t-il un effet différent ? On peut en douter.
En fait, la Fed se trouve sous la double injonction de Donald Trump et des marchés financiers pour prolonger coûte que coûte un cycle de croissance qui n’en finit plus. Le président y voit le meilleur moyen de se faire réélire. La Bourse y puise son principal carburant pour poursuivre son incroyable progression. L’un comme l’autre n’ont aucun intérêt à voir l’euphorie s’arrêter. Mais jouer les prolongations n’a pas que des vertus.
Bulles spéculatives en cours de formation
A force de laxisme monétaire pour prévenir une récession qui interviendra tôt ou tard, on est en train de créer les conditions d’une crise qui peut se révéler encore plus dévastatrice que la précédente. En rendant l’argent gratuit pour éteindre l’incendie de 2008, le système financier a fini par donner l’illusion que le risque est devenu marginal et a provoqué une hausse artificielle de la valeur des actifs, à commencer par l’immobilier et les actions. Des bulles spéculatives sont en cours de formation. Les agents économiques s’endettent de façon inconsidérée. La déconnexion avec l’économie réelle se généralise.
La situation est d’autant plus perverse que la pression des investisseurs devient autoréalisatrice. Ils envoient en permanence le signal que tout renoncement à continuer à assouplir la politique monétaire reviendrait à créer un choc sur les marchés financiers dont l’économie aurait du mal à se remettre. Mercredi, il a suffi que le président de la Fed, Jerome Powell, reste prudent sur la poursuite de la baisse des taux pour que Wall Street chute.
Quant aux interpellations du président américain pour que la Fed baisse ses taux, elles participent d’un climat malsain. « Comme d’habitude, Powell nous a laissé tomber », a lâché Donald Trump, déçu de l’ampleur de la baisse. Son but : faire de la banque centrale un supplétif de sa politique économique, qui génère ses propres fragilités. Mais la guerre commerciale qu’il a déclarée et le déficit budgétaire abyssal qu’il a amplifié ne sont-ils pas des périls autrement plus dangereux pour la croissance mondiale que des taux d’intérêt qui seraient trop élevés ?
A court terme, la performance de Wall Street et la prolongation de la croissance américaine sont sauves, mais, comme lors de la dernière crise, c’est le reste du monde qui risque d’en payer le prix.