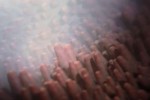Après l’excision, un long chemin pour se réapproprier son corps
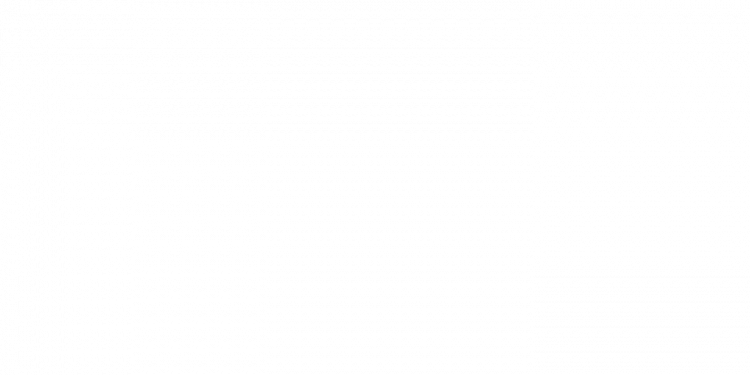
Après l’excision, un long chemin pour se réapproprier son corps
Par Anahit Miridzhanian
Plus de 120 000 femmes vivant en France ont subi une mutilation sexuelle. Pour les aider à se reconstruire, physiquement et mentalement, des unités de soins pluridisciplinaires voient le jour.
Capture d’écran d’une vidéo de la campagne « Alerte Excision » menée par l’association Excision, parlons-en ! / Excision, parlons-en !
Au cœur du XXe arrondissement de Paris, dans la bruyante rue d’Avron, une nouvelle unité du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon a ouvert ses portes pour soigner les femmes excisées. Dans ce bâtiment moderne et sobre, une petite équipe de professionnels accueille les victimes de mutilations sexuelles. Ce mardi 6 août au matin, quelques patientes assises sur une rangée de chaises attendent calmement leur tour. L’odeur du café flotte dans l’air. Tout juste rentré de vacances, Cyril Raiffort présente sa nouvelle unité.
Cela fait huit ans que ce gynécologue obstétricien vient en aide aux femmes désireuses de « retrouver leur identité féminine » après avoir subi des mutilations génitales. Une expérience qui l’a « profondément marqué » ; alors, à son arrivée au sein du groupe hospitalier, en février, il a souhaité poursuivre ce travail. Ce nouveau lieu d’accueil propose une prise en charge pluridisciplinaire réalisée par deux sages-femmes, un psychologue, un sexologue et un chirurgien.
« Les patientes se rendent à l’hôpital pour obtenir des informations sur les soins qui pourraient les aider », explique le docteur Raiffort. Chacune vit la mutilation génitale de façon unique et nécessite donc un traitement individualisé. Elles prennent rendez-vous pour des raisons différentes : certaines ont des douleurs et aimeraient améliorer leur vie sexuelle, d’autres pensent « avoir perdu leur féminité ». Pour toutes, l’enjeu est de trouver des professionnels avec lesquels partager leur histoire et obtenir de l’aide. « Les patientes sont souvent très isolées. Elles ont peur de parler de ce sujet avec leurs conjoints ou leur famille », souligne le gynécologue.
Ce fut le cas de Ramata Kapo, aujourd’hui militante contre les mutilations sexuelles. Originaire du Mali, arrivée en France très jeune, elle découvre son excision à l’âge de 16 ans, lors de sa première consultation chez un gynécologue. A l’époque, la jeune fille ne comprend pas tout mais n’ose pas évoquer la question avec ses parents. « Comme dans beaucoup de familles, la sexualité était un sujet tabou », se souvient-elle. Elle en parlera avec sa mère seulement à l’âge adulte, afin de connaître son histoire : Ramata avait un an et demi quand sa grand-mère paternelle l’a faite exciser au Mali, où la pratique est répandue.
Des solutions pas seulement chirurgicales
Les victimes d’excision se sentent souvent démunies. Certaines vont chercher des renseignements sur Internet, mais « les forums contiennent des informations assez contradictoires », regrette Isabelle Gillette-Faye, sociologue et directrice du Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines (GAMS). D’autres contactent des associations qui les orientent vers des unités de soins.
Une fois à l’hôpital, ces femmes pourront parler de leur expérience avec un psychologue spécialisé. Certaines gardent le souvenir d’images et de bruits de leur excision, qu’elles revivent dans leurs cauchemars. D’autres ne se rappellent plus ce moment douloureux de leur enfance mais éprouvent un traumatisme lié à la perte d’une partie de soi.
Lorsque les femmes excisées apprennent qu’elles possèdent toujours une partie de leur clitoris, cela peut les soulager. C’est à elles, à ce moment-là, de prendre la décision de le faire réparer ou non. « Il y a de moins en moins de femmes qui vont jusqu’au bout de la chirurgie, assure Isabelle Gillette-Faye. Cela est dû à l’approche pluridisciplinaire proposée par les unités de soins. » « Il y a une dizaine d’années, on se disait que la solution était purement chirurgicale, alors que ce n’est pas le cas pour toutes », souligne le docteur Raiffort.
La technique de réparation des mutilations sexuelles a été inventée dans les années 1980 par l’urologue Pierre Foldès, qui opérait des femmes excisées pendant ses missions humanitaires en Afrique. « Depuis, on a compris que la chirurgie ne suffisait pas », explique Sarah Abramowicz, chirurgienne à la maternité André-Grégoire, à Montreuil.
La réparation chirurgicale reste néanmoins une bonne solution pour celles qui veulent « retrouver leur corps de femmes » ou se débarrasser de certaines douleurs. L’opération ne dure que vingt à trente minutes. Les patientes devront ensuite s’appliquer une crème. « En retouchant la zone excisée, les femmes pourront se réapproprier leur clitoris, qu’elles évitaient jusque-là de toucher ou de regarder », selon Cyril Raiffort.
Ramata Kapo a choisi de se faire opérer pour redevenir « une femme à part entière ». Il lui a fallu du temps pour prendre cette décision. Son questionnement a débuté à l’âge de 21 ans, lorsqu’elle est tombée enceinte. « Mon gynécologue m’a dit que je risquais d’avoir des complications lors de mon accouchement », se rappelle la militante. Même si tout s’est bien passé, l’événement a déclenché une réflexion.
« Le fait de devenir maman, c’est aussi se projeter dans ce qui s’est passé dans l’enfance », analyse Cyril Raiffort. Le traumatisme peut alors ressurgir. Pour beaucoup de femmes, c’est aussi le moment où elles apprennent qu’elles ont subi des mutilations. « On leur propose d’être prises en charge après l’accouchement », ajoute le gynécologue.
Une quinzaine d’unités de soins en France
Selon les dernières estimations publiées dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 124 355 femmes adultes vivant en France ont subi une mutilation génitale. La précédente étude, réalisée au milieu des années 2000 par les mêmes chercheuses, Armelle Andro et Marie Lesclingand, comptabilisait seulement 62 000 victimes. « C’était un chiffre assez ancien et imprécis, qu’on avait besoin de réévaluer », souligne Cyril Raiffort.
L’étude prend cette fois en compte les migrantes de deuxième génération, nées sur le sol français. Selon la publication, « la France est l’un des pays les plus concernés au niveau européen ». La population féminine adulte excisée vivant en France a doublé en l’espace de dix ans, alors que la pratique y a pourtant quasiment disparu depuis une quinzaine d’années. « L’augmentation s’explique par l’arrivée en France de nouvelles femmes migrantes en provenance des pays à risque et par le passage à l’âge adulte des jeunes filles mineures qui n’étaient pas comptabilisées lors de la précédente estimation », poursuit l’étude.
Pour sensibiliser le public concerné, les associations qui luttent contre l’excision lancent des campagnes de prévention et organisent des conférences dans les établissements scolaires. « En France, il y a des femmes excisées qui viennent de Somalie, de Côte d’Ivoire, du Mali, de Guinée, de Mauritanie et qui ne parlent pas les mêmes langues, explique Isabelle Gillette-Faye. Cela complique la diffusion de l’information parmi les migrantes. » Pour cibler les mères des enfants à risque, les associations organisent des causeries autour d’un hôpital, d’une maternité ou d’un centre de protection maternelle et infantile.
Mais le danger ne vient pas forcément des parents les plus proches. « Les mères, ou parfois les deux parents, viennent nous voir pour nous demander comment protéger leur enfant de l’excision », raconte la directrice du GAMS. Ceux qui se trouvent dans une situation administrative compliquée s’interrogent sur la possibilité de demander l’asile pour garantir la protection de l’enfant. Ceux qui possèdent un titre de séjour ou la nationalité française cherchent des moyens de s’opposer aux membres de la famille qui pourraient profiter d’un séjour de l’enfant dans leur pays d’origine pour le faire exciser.
Selon l’association Excision, parlons-en !, « trois filles sur dix dont les parents sont originaires des pays qui pratiquent l’excision sont à risque d’être excisées pendant les vacances scolaires, au cours d’un voyage dans les pays d’origine de leurs parents ». Pour protéger les protéger, les parents peuvent faire un signalement au procureur. « De cette façon, l’enfant ne pourra pas quitter le territoire français », explique le docteur Raiffort.
Les unités de soins pour femmes excisées sont une quinzaine en France : en Ile-de-France, mais aussi en Bretagne, en Provence-Alpes-Côte d’Azur. « Sur à peu près tout le territoire, on retrouve des hôpitaux pluridisciplinaires », constate Isabelle Gillette-Faye. Grâce aux progrès réalisés dans la prise en charge, les victimes peuvent se reconstruire physiquement et mentalement, mais le processus prend du temps. « Pour aider ces femmes-là, il faut surtout les écouter », conclut Cyril Raiffort.