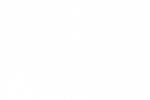Alexandre Adler : « Le mélange des cultures et des civilisations est producteur de sens »

Alexandre Adler : « Le mélange des cultures et des civilisations est producteur de sens »
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO
Journaliste et essayiste à l’écoute des sociétés contemporaines, Alexandre Adler, parrain de la collection du « Monde » baptisée « Histoire & civilisations », porte un regard érudit sur des héritages universels qui marquent le monde contemporain.
Alexandre Adler, le 24 juin, à Paris. / Edouard Caupeil pour « Le Monde ”
Collection « Histoire & civilisations ». Découvrir une civilisation, en saisir l’essence, la culture, les langages comme les élans, revient à s’aventurer sur une terra incognita dont l’histoire serait la porte. C’est, comme le prône Alexandre Adler, dans un conscient aller-retour entre passé et présent, en opérant rapprochements, comparaisons et analyses, qu’une réalité géopolitique révèle ses racines affleurantes ou profondes, tinte de résonances immédiates ou lointaines. En étudiant les rapports entre civilisations, en mesurant impérialismes et assimilations, en dévoilant des faits leur part d’inconnue, à la lumière des dernières recherches et découvertes, les mémoires dialoguent et s’éclairent. Spécialiste des relations internationales, Alexandre Adler explore les influences d’une culture sur une autre et s’empare du temps long qui habite l’histoire pour mieux l’interroger.
La perception que nous avons d’une civilisation évolue-t-elle à mesure que l’histoire s’écrit ?
Chez les historiens, la question a fait l’objet de nombreux débats à partir du moment où ils ont découvert la pluralité du monde. L’idée qu’il existe des civilisations, unies par leurs traits distinctifs, nous a été transmise à la faveur des grandes découvertes. Il faut probablement remonter à la controverse de Valladolid (1550-1551), ce moment où, en pleine colonisation espagnole de l’Amérique centrale et du Sud, une majorité de clercs a pris position pour l’humanité des Indiens, exprimant du même coup le désir et le projet de les évangéliser. De là est née une société mixte mexicaine qui, dans un syncrétisme progressiste, a su marier, sous le règne de Charles Quint, la mythologie de Quetzalcoatl au culte de la Vierge de Guadalupe. Ainsi a-t-on pris conscience, à cette époque, de la pluralité du monde et des atouts qu’offre la féconde diversité des civilisations, des anciens empires précolombiens jusqu’aux confins de la Chine.
Quel distinguo faites-vous entre culture et civilisation ?
Les cultures produisent et répandent des connaissances de manière non hiérarchique. La civilisation cristallise des cultures aléatoires. L’historien Fernand Braudel évoquait une grammaire des cultures. Pour lui, chacune est génératrice d’un sens commun, procurant aux hommes une parenté de pensée.
Si les savoirs se heurtent à la puissance des événements, l’écrit reste-t-il une « preuve de l’histoire », un vecteur privilégié ?
Ce que l’on nommait la lectio divina, cette lecture obstinée et critique est un moyen d’investigation sans équivalent. A force de confrontations critiques, de lectures contradictoires, de mises en regard approfondies – comme le permet la collection « Histoire et Civilisations » –, on peut faire rendre raison à nombre d’énigmes de la période contemporaine. Mais si, dans l’expérience française, l’écrit reste un outil privilégié, d’autres sociétés usent d’autres media. Par exemple, on comprendra beaucoup mieux la véritable révolution culturelle qui a saisi l’Allemagne à la fin du XVIIIe siècle à partir des Lumières allemandes (Aufklärung) jusqu’aux années 1920 grâce au patrimoine musical transmis par Mozart, Beethoven, Wagner et Richard Strauss qui nous offre la « lecture » d’une sorte de texte continu constituant l’essentiel du message culturel de la société allemande.
L’oralité a-t-elle joué un rôle crucial dans la connaissance de civilisations anciennes ?
Spinoza considérait qu’il n’y a pas d’erreur dans le monde mais des genres de connaissance. La tradition orale en serait l’un des premiers. Les œuvres d’Homère L’Iliade et L’Odyssée, tout comme les Upanishad de l’Inde, forment d’éloquents et vivants vestiges transmis oralement. Ces récits cultivent à travers les âges un art de la mémoire complètement sous-estimé, avant que de grands esprits telle l’historienne britannique Frances Yates ne nous le fasse connaître. Nous comprenons dès lors le pouvoir que peut avoir l’oralité et sa mission quasi pédagogique. Car, en confrontant la parole au faux, au vrai, au vite, les sociétés traditionnelles sont capables, comme dans le processus darwinien de l’évolution, de sélectionner, de corriger, pour fixer et transmettre. L’oralité joue donc le rôle civilisateur d’un passeur.
Certaines découvertes ont dynamisé le goût public pour l’histoire. Portent-elles une part d’éternité qui parle à chacun ?
Au tournant de 1870, la découverte des tombes de Mycènes et des ruines de Troie par l’archéologue allemand Heinrich Schliemann insuffle un élan dans la recherche des monuments authentiques. Puis, en 1922, la révélation par Howard Carter du tombeau de Toutankhamon, servie par la malédiction du pharaon, fait faire un bond à l’égyptologie de Champollion et Maspero, suscitant un engouement pour la discipline. Soudain cette tombe du jeune roi recèle le mystère, sa révélation et récompense l’inventivité des archéologues qui se sont fondés sur des raisonnements écrits et une exploration permanente.
Plus tard l’Unesco sauvera les temples d’Assouan convainquant, avec la communauté internationale, Nasser malgré son nationalisme intransigeant. Grâce à ce sursaut, toute une génération d’égyptologues arabophones va se former. Pour comprendre l’Egypte ancienne, nous disposons aujourd’hui de matériaux exceptionnels, du Livre des morts à la pierre de Rosette. Nous sommes en mesure de suivre une généalogie pharaonique jusqu’à trois mille ans avant notre ère qui nous rappelle l’importance de cette civilisation.
Quant à la notion d’éternité, lorsque Kant s’interrogeait sur la capacité des princes de l’Antiquité à insuffler toujours les mêmes idées à travers la philosophie grecque, il se trompait ! Tous ensemble, les vestiges excavés, les noms retrouvés des grands pharaons que nous connaissions partiellement nourrissent un véritable substrat de connaissances sans cesse augmentées, faisant que notre désir de comprendre dépasse de beaucoup les sociétés anciennes.
Du patrimoine écrit aux œuvres d’art, les sources de nos connaissances véhiculent-elles une vision occidentale du monde ?
De nos jours, tous les types de patrimoine sont magnifiés par une culture de masse croissante, par notre capacité à reproduire et à diffuser les images des œuvres et à concevoir des expériences où la virtualité ouvre de nouveaux champs. La volonté de collecter les traces de notre histoire – des traités de science aux pièces archéologiques, des descriptions de paysages aux statues emblématiques de l’Antiquité – est animée par l’envie et le besoin de comprendre et d’embrasser nos racines. La collection des princes est l’origine de l’idée même du musée, elle-même bien antérieure au fameux décret Chaptal, au lendemain de la Révolution, qui dota les provinces de musées à vocation universelle. Car dès l’époque de la Renaissance, la découverte d’un certain nombre de monuments romains antiques a façonné les goûts. Les papes, poussés par des érudits comme Alberti, ont constitué les vastes collections d’un « musée imaginaire » au Vatican – le prestige de Rome faisant de ces musées, avant la lettre, des moyens d’édification et de culture pour l’ensemble de l’Europe civilisée. Des grandes familles italiennes à l’instar des Médicis au Grand Tour prisé des Britanniques, collections et vestiges font office de musées.
Après la révolution française, la représentation imaginaire de ce que fut une certaine grandeur de la France s’incarnera dans un projet muséologique destiné au plus grand nombre. Louis-Philippe fait de Versailles un palais national. Notre-Dame devient un manifeste de l’architecture gothique – car l’idée que nous nous faisons aujourd’hui des cathédrales médiévales est largement due à l’approche néogothique de Viollet-le-Duc.
De son côté, le Louvre lui-même participe d’un projet culturel de divulgation et d’éducation populaire. L’installation des salles égyptiennes, puis grecques, en témoigne. A l’unisson, dans une rivalité européenne des capitales et des nations, Londres transforme le British Museum en écrin pour des fleurons de l’architecture grecque, tandis que Berlin, dans l’île aux Musées, présente en majesté l’autel et les frises de Pergame magnifiant violence et barbarie. A la veille de la première guerre mondiale, l’apogée du colonialisme et de l’impérialisme européen habite nos musées.
Notre approche des civilisations est-elle liée, voire soumise, au passé colonial des anciens empires européens ?
Elle l’a été. Elle ne l’est plus. Mais elle ne l’a jamais été complètement. Sur le sol africain, la France a introduit les idées de la IIIe République sur la citoyenneté considérant très tôt le statut colonial comme devant être provisoire. J’ai lu sous la plume même de Patrice Lumumba, premier ministre du Congo en 1960, assassiné en 1961, sa surprise de découvrir, à Brazzaville, respect et courtoisie de la part des Français. Si son témoignage n’efface ni les erreurs ni les atrocités coloniales, il traduit les rapports complexes qu’engendre la colonisation.
Une civilisation peut-elle jamais faire l’économie de Dieu, du temple, du rite et de la croyance ?
Jusqu’à nos jours, on peut dire que ce ne fut pas le cas. On a vu sous l’emprise communiste des formes laïcisées de pratiques. La Russie stalinienne, la Corée du Nord ont instauré au XXe siècle des rites qui s’apparentent davantage à une régression qu’à un progrès. Mais aujourd’hui, le mouvement semble s’inverser. A Moscou on a restauré les églises jadis dynamitées comme celle du Christ-Sauveur. Redonner sa place non pas à Dieu mais au témoignage de Dieu est accueilli en Russie comme un progrès apaisant.
De même, on a rétabli à Berlin-Est nombre d’édifices religieux détruits. En Espagne, à Cordoue, grâce à sa phénoménale restauration, la cathédrale-mosquée s’ouvre simultanément aux cultes catholique et musulman. La tolérance de l’Espagne moderne me paraît le signe tangible d’une réappropriation par l’histoire. Je ne minore pas les délires fanatiques qui fleurissent d’Egypte à Jérusalem, mais en restaurant des lieux on « ouvre la fenêtre », on sert une tolérance réciproque. D’ailleurs, le revers d’Erdogan à la mairie d’Istanbul met fin à son projet dément de retransformer en mosquée la basilique Sainte-Sophie : l’exact contraire de ce que souhaitait Atatürk en l’ouvrant à toutes les confessions.
La montée des populismes est-elle le signe d’un déclin ou le reflet de mutations quasi mécaniques ?
C’est une question de patience. Il faut laisser son temps à l’histoire pour que les mouvements de société s’affirment et il faut aussi la fermeté intellectuelle et morale pour refuser l’irrecevable. Si la peur et la dévalorisation de l’islam chez les populistes italiens ou français restent inacceptables, nous savons très bien les legs en manuscrits et en diffusion des savoirs que l’Occident et la chrétienté doivent à l’expansion arabe. Le nier tient du révisionnisme et de l’offense.
L’idée de choc des civilisations est-elle pour vous un leurre ou une réalité ?
Le choc est toujours douloureux mais les capacités des sociétés humaines à se comporter dans un même élan sont, à mon avis, plus fortes. Ce n’est qu’une question de temps. Au XVIe siècle, la conquête du Pérou s’est faite dans la violence et le sang. Mais comme une réponse, deux siècles plus tard, l’évangélisation du Guarani suivie de la création de la République du Paraguay devient un modèle de développement.
On pourrait également évoquer les invasions mongoles sur le sol russe des lieutenants de Gengis Khan. Or non seulement les Mongols se sont conduits avec tolérance, mais finalement ils ont abrité et protégé l’Eglise orthodoxe russe. Ils ont également poussé à convertir les musulmans mongols à l’orthodoxie, dont les noms témoignent aujourd’hui. La poétesse Anna Akhmatova aimait rappeler qu’elle descendait d’Akhmet Khan (seigneur Akhmet), l’un des chefs de la Horde d’or. Ainsi la capacité des sociétés une fois dominées à assimiler les connaissances nouvelles et à se transformer est considérable. Les grands progrès de l’astronomie que l’on constate en Asie centrale datent exactement de l’époque où Gengis-Khan a envahi la région. Si les Mongols ont fait table rase des cités, ils ont bâti notamment des observatoires et diffusé des connaissances qui leur venaient du Moyen-Orient.
Ce phénomène est déjà présent dans l’Antiquité lors de la rencontre de la Grèce avec l’Orient qui produit la culture hellénistique. Elle sera à l’origine de la diffusion de la pensée grecque mais aussi de son infléchissement. Enfin, tout récemment, pouvait-on imaginer que le féminisme radical américain ferait naître un féminisme musulman dont jamais les Occidentaux n’auraient été capables de provoquer l’émergence ni en Afrique ni en Inde ?
En 2002 vous écriviez « J’ai vu finir le monde ancien » et en 2018 vous publiez « Le Temps des apocalypses » (Grasset). Vivons-nous les derniers feux de la civilisation occidentale ?
Incontestablement, la civilisation occidentale telle qu’elle se définissait s’achève. On peut le vérifier notamment aux Etats-Unis où la réalité de la société américaine et son dialogue permanent avec la Chine la confrontent, de manière plus radicale qu’en Europe, à la fin de l’autre. Un monde nouveau a commencé avec le 11-Septembre. Il n’est ni américain ni chinois même s’il est les deux à la fois. Il sera également européen si l’Europe se repense.
Nous vivons le temps des apocalypses – étymologiquement, les révélations – d’une Amérique métissée, d’une Chine technologique. Nous observons la caducité d’une pertinence révolutionnaire qui a duré deux siècles. Cela passe par la dissolution du communisme. Les partis politiques homogènes semblent devenus inutiles. Mais cela ne signifie pas que les masses soient incapables de se mobiliser pour de grandes causes ni qu’elles puissent devenir porteuses d’idées de société. Nous sommes précipités par un mouvement messianique dans lequel une force nous dépasse : les apocalypses. Elles nous bombardent de révélations et de transformations de notre conscience à un rythme effréné. Je n’en ai pas d’explication.
La relecture du passé offre-t-elle le recul nécessaire sur le temps, la mondialisation et sa genèse ?
Si nous considérons brutalement des sociétés émergentes, nous ne pouvons rien en saisir. Or plus nous comprenons le plus ancien et ce qui résiste le plus à l’analyse et mieux nous approchons des éléments importants et formateurs. Les grandes migrations en cours de l’Amérique centrale vers les Etats-Unis, auxquelles Donald Trump s’oppose farouchement – mais finalement avec impuissance – démontrent pour le moins qu’il existe une composante hispanique et indienne d’origine mexicaine venant se fondre dans le melting-pot noir et blanc américain. S’y ajoutent des touches d’émigration japonaise et chinoise que l’on ne considère plus désormais comme de simples visiteurs de passage.
De même, en supposant que l’Europe parvienne à absorber la masse de migrants venus essentiellement d’Afrique, il me paraît évident que cette composante s’enracine. Les Européens vivent la migration comme une catastrophe et une menace alors qu’elle est un levier de transformation. Si nous revenons aux origines de l’humanité, le même processus est à l’œuvre. On a longtemps cru que l’Homo sapiens avait supplanté et remplacé l’homme de Neandertal. Or, en observant l’évolution du génome humain, le biologiste suédois Svante Pääbo a démontré le métissage de différentes espèces humaines que l’on ne croyait pas contemporaines. L’hybridation des ADN participe du même mouvement de l’histoire que la migration des peuples et leur adaptation à l’environnement. Il en va de même des sociétés : le mélange des civilisations et des cultures est producteur de sens et de développement. Jacques Le Goff écrivait : « Il n’y a pas de sens à l’histoire mais l’histoire donne un sens au présent », je fais mienne son intuition, qui me paraît si juste.