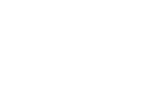Au Kenya, le gigantesque camp de réfugiés de Dadaab est loin d’avoir fermé ses portes

Au Kenya, le gigantesque camp de réfugiés de Dadaab est loin d’avoir fermé ses portes
Par Marion Douet (Nairobi, correspondance)
Peu après l’attentat meurtrier du complexe hôtelier Dusit en janvier, la fermeture du camp avait été annoncée pour mi-août. Rien, ou presque, n’a été fait.
Le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, en avril 2011. / Thomas Mukoya / REUTERS
On aurait presque pu s’y attendre. Mi-février, quelques semaines après l’attentat du complexe hôtelier Dusit, où vingt et une personnes avaient été tuées à Nairobi, le gouvernement kényan annonçait dans une lettre adressée au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) son intention de fermer sous six mois l’immense camp de Dadaab. Quatre ans plus tôt, déjà, l’Etat avait eu la même réaction après l’attaque de l’université de Garissa (148 morts), en avril 2015.
Ce camp de réfugiés, le plus grand du monde il y a encore quelques années, est régulièrement accusé par le pouvoir d’être un foyer du terrorisme. Situé au nord-est du Kenya, près de la frontière somalienne, il accueille quelque 211 000 réfugiés, à 94 % Somaliens. « A cause d’Al-Chabab, il y a ce préjugé que les Somaliens sont les auteurs des attaques terroristes, observe Yunia Atieno, de l’association Kituo Cha Sheria, qui offre du conseil juridique, notamment aux réfugiés. Or les terroristes peuvent venir de partout. Il y a aussi des Kényans impliqués dans les attentats. » Le cerveau de l’attentat du Dusit, Ali Salim Gichunge, venait ainsi d’une famille de soldats kényans au patronyme kikuyu, la première communauté du pays.
Quoi qu’il en soit, l’annonce de la fermeture fut reprise partout au Kenya, et à travers le monde. Mais six mois plus tard, rien n’a bougé ou presque sur ce chantier colossal. Ouvert il y a près de trente ans, Dadaab, qui en population côtoie les grandes villes kényanes, compte nombre d’écoles, d’entreprises, d’échoppes… Sur le terrain, les programmes humanitaires suivent leur cours, tandis qu’à Nairobi les organisations impliquées à Dadaab répondent toutes, un peu perplexes, attendre plus de détails. « Il y a une grande incertitude », glisse une source au fait du dossier. « Il ne se passe pas grand-chose. Peut-être que nous n’en entendrons plus jamais vraiment reparler. » Contactées, les autorités n’ont pas donné suite à nos demandes d’interview.
« Trois options pour les réfugiés »
Après l’attaque de l’université de Garissa, rappelle Yunia Atieno, « une directive officielle avait été publiée en mai pour une fermeture en novembre 2016. C’est sur cette base légale que nous avions pu aller devant la justice. » Kituo Cha Sheria et d’autres associations, soutenues par Amnesty International, avaient attaqué la décision de fermer le camp, finalement bloquée par la Haute Cour de justice en février 2017, en raison notamment des obligations du Kenya, signataire des conventions internationales sur la protection des réfugiés. « Ce fut un jugement très fort, se souvient Victor Nyamori, en charge du dossier au bureau local d’Amnesty International. Le gouvernement avait annoncé qu’il ferait appel, mais il ne l’a jamais fait. » Une jurisprudence qui explique certainement la discrétion des autorités, car chacun sait bien que le contexte n’a pas changé.
Le gouvernement fait aussi face à d’autres défis. « Il n’existe que trois options pour les réfugiés, et la première est le retour volontaire », détaille Yvonne Ndege, porte-parole du HCR au Kenya. Un programme existe déjà en ce sens depuis 2014. Dans ce cadre, quelque 80 000 Somaliens sont repartis. Or, non seulement certains sont revenus, mais le « vivier » des candidats au retour s’est épuisé, estime Neil Turner, directeur local du Norvegian Refugee Council (NRC), qui opère dans le camp : « Aujourd’hui, la majorité des gens ne veulent pas rentrer, notamment parmi ceux qui sont nés à Dadaab. Ceux qui l’ont fait appartenaient principalement à une vague de réfugiés venus en 2010-2011. Ils avaient des liens plus étroits avec la Somalie. »
« La deuxième option est le transfert dans un autre camp, poursuit Yvonne Ndege, du HCR. Nous sommes actuellement en discussion avec le gouvernement pour étudier la réinstallation d’environ 5 000 personnes au camp de Kakuma. » Ce transfert vers l’autre camp kényan, accueillant déjà 180 000 personnes à l’autre bout du pays, apparaît comme l’unique initiative concrète en cours. Or, non seulement elle ne réglera pas le sort de la grande majorité, mais elle se destine principalement selon nos sources aux 6 % de réfugiés non-Somaliens.
Présence de citoyens kényans dans le camp
« La troisième option, c’est l’accueil dans les pays tiers. Or les Etats-Unis sont historiquement le premier pays d’accueil pour les réfugiés et ce débouché est bloqué pour les Somaliens depuis le “muslim ban” [décision de Donald Trump d’interdire le territoire aux ressortissants de certains pays musulmans] », souligne Yvonne Ndege, ajoutant que le HCR démarche actuellement d’autres pays comme le Canada ou l’Australie. « Mais dans tous les cas, l’accueil est un processus qui prend deux à sept ans », précise-t-elle.
Face à cette situation inextricable, le HCR et d’autres organisations comme le NRC plaident pour développer une approche nouvelle : l’intégration. Puisque les réfugiés n’ont nulle part où aller et que Dadaab, qui n’est pas clôturé mais très isolé, est déjà une ville générant sa propre économie, pourquoi ne pas ouvrir ses portes, même symboliquement, disent-ils. « Nous disons au gouvernement (…) : “Prenez cela comme une opportunité pour explorer l’intégration”, insiste Neil Turner, du NRC. Les gens veulent majoritairement rester. Donc une partie de la solution est de leur donner des papiers, un accès à une vie normale, à une activité, et de réduire les restrictions [ils ne peuvent se déplacer sans autorisation]. »
Une démarche qui, au passage, obligerait à régler un quasi-tabou : la présence de citoyens kényans dans le camp. Ils pourraient être plusieurs dizaines de milliers, selon des estimations, informelles et très incertaines. Des enfants nés sur place qui pourraient obtenir la nationalité, mais aussi des « Kényans somalis » (l’une des communautés kényanes) qui ont un jour abandonné leurs papiers pour accéder, dans cette région très pauvre, au statut de réfugiés, et donc à la nourriture, aux médicaments, à l’éducation… Les comptabiliser pourrait « peut-être changer complètement la donne » sur l’avenir de Dadaab, estime une source. Mais la décision s’avère éminemment politique dans un pays où les rivalités communautaires sont fortes. Et où une élection présidentielle avec d’énormes enjeux s’annonce en 2022.